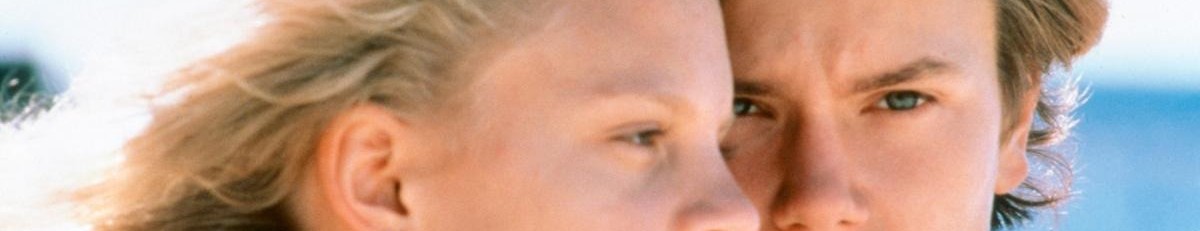La Fureur de vivre de Nicholas Ray (1955)
La Fureur de vivre est le film le plus célèbre de Nicholas Ray, et il est aussi l’un des plus intemporels sur le sujet de l’adolescence. Ce titre est devenu culte grâce à l’intensité du jeu de James Dean et au lyrisme flamboyant de sa mise en scène. Cette séquence intervient après la course de voitures qui a opposé Jim à son rival occasionnant la mort de ce dernier. Moralement affecté, le jeune homme se confie à ses parents, auprès desquels il ne parvient pas à trouver le réconfort nécessaire ni la compréhension espérée.
Autant que par les dialogues, le conflit générationnel s’exprime à travers des choix de mise en scène particulièrement expressifs. Au début de la séquence, les parents sont placés bord cadre, dans les coins inférieurs de l’image, tandis que Jim occupe le centre du plan, filmé en contre-plongée. Le jeune homme porte son blouson d’un rouge très vif, symbolisant la fougue, l’énergie vitale et les passions propres à la jeunesse. Le vêtement de Jim fait ainsi office de foyer chromatique principal durant tout le déroulement de la scène.
Lorsque le jeune homme s’avance vers la fenêtre située à l’arrière-plan en tournant le dos à la caméra, il se retrouve pris en tenaille par ses deux parents, qui verrouillent l’espace autour de lui, générant de la sorte une atmosphère étouffante, soulignée par un panoramique vertical dirigé vers le bas. Le conflit entre le père et la mère, dont Jim est le sujet, en vient même parfois à oblitérer la présence de l’adolescent, lequel reste pourtant au centre de l’écran pendant plusieurs secondes, le dos tourné et la tête appuyée contre la fenêtre, en signe d’accablement et dans une configuration spatiale qui redouble le sentiment d’incompréhension.
Quand Jim s’oppose directement à son père, le découpage procède alors à un brutal changement d’axe plaçant le personnage devant l’escalier qui mène à l’étage. Le caractère abrupt de ce raccord anticipe ainsi l’intensification du conflit. Puis la caméra se met subitement à pencher au moment où la mère fait retour sur le ring familial. Ce décadrage spectaculaire exprime la tension extrême de la scène, anticipant la dislocation du foyer tiraillé entre les points de vue irréconciliables des deux générations.
Autour de Jim, l’espace se réduit à mesure que s’amplifie la stratégie de coercition parentale. Le point de non-retour est atteint lorsque les arguments de l’adolescent se précisent : conscient d’être souvent utilisé pour désamorcer le conflit conjugal larvé à l’origine du déséquilibre relationnel, Jim met en cause l’autoritarisme de sa mère et à la lâcheté de son père. La violence visuelle se transforme alors en violence factuelle, lorsque Jim s’en prend physiquement à son père. Avant de s’enfuir de la maison, l’adolescent décharge le reste de sa colère sur un portrait de famille, substitut symbolique de sa mère, qu’il éventre à coups de pied.







American Beauty de Sam Mendes (1999)
En apparence, les Burnham incarnent le modèle de la famille américaine prospère et équilibrée. Mais derrière cette image soigneusement construite se dissimule un profond malaise : l’absence de dialogue et la frustration minent peu à peu les relations, jusqu’à provoquer la désagrégation du foyer. Le père, Lester (Kevin Spacey), tombe amoureux d’Angela la jeune et jolie copine de sa fille Jane; Carolyn (Annette Bening), la mère, trompe son époux avec un collègue et concurrent qu’elle admire ; tandis que de son côté, Jane se rapproche de Ricky (Wes Bentley), l’étrange fils des nouveaux voisins.
La scène de repas familial commence par un plan-séquence filmé en travelling avant, où la caméra s’approche très lentement des trois membres de la famille Burnham, réunis à table pour introduire le spectateur dans l’intimité de cette famille qui semble figée dans un protocole rigide accentué par la composition symétrique de l’image. Cette séquence s’ouvre sur un effet de leurre sonore aussi rapide qu’ironique : la mélodie doucereuse que l’on entend au début est d’abord identifiée par le spectateur comme une musique off, avant que l’intervention de Jane en dénonce le caractère intradiégétique, dans une contestation discrète de l’ordre familial. La dimension de la table de la salle à manger accuse la distance qui sépare les deux parents. Jane trône au centre, entourée de quatre bougies et d’un vase rempli de roses rouges, la désignant comme une sorte de trophée qu’il faut absolument mettre en valeur. L’ambiance est néanmoins lugubre, et tout concourt à faire de ce repas familial une sorte de veillée funèbre : les échanges sont outrancièrement artificiels, les regards affichent une désapprobation réciproque, et lorsque le père tente une intervention sincère au sujet de sa situation professionnelle préoccupante, cette dernière se solde par la sortie de Jane qui marque la fin du plan-séquence.
Lester se retrouve alors seul face à Carolyn pour engager un dialogue acrimonieux sur leurs déficiences parentales respectives. Le caractère moribond de la relation conjugale est souligné par le recours au champ contrechamp, qui isole les deux personnages dans des cadres séparés, jusqu’à ce que Lester décide à son tour de quitter l’espace d’un conflit conjugale stérile.
Dans la cuisine, il retrouve sa fille avec laquelle il essaye de renouer le contact. L’échec de cette tentative est comme préfiguré par la fenêtre à croisillons située à l’arrière-plan, qui souligne le cloisonnement entre les personnages. Pendant ce temps, depuis la maison d’en face, le nouveau voisin enregistre ce dialogue impossible à l’aide de sa caméra vidéo. L’effet de zoom qui s’ensuit souligne la barrière qui sépare Jane de son père. Lorsque le cadre du vidéaste amateur se resserre encore, les lignes verticales de la fenêtre s’écartent des bords de l’image, tout en continuant malgré tout de formaliser l’éloignement filial, ceci en dépit de la proximité spatiale. À la fin de la scène, tous les membres de la famille se retrouvent séparés. Il ne subsiste que le regard du jeune voisin, voyeur par caméscope interposé, qui perçoit sans doute l’étendue de la problématique existentielle cachée derrière le paravent idéalisé – une problématique qui résonne avec sa propre situation personnelle.
La séquence s’achève sur une photo de famille, pauvre cliché en noir et blanc témoignant d’un bonheur familial disparu à côté d’une corbeille de fruits bien composée , l’associant à une nature morte.




Fish Tank d’Andrea Arnold (2009)
Fish Tank suit la trajectoire de Mia (Katie Jarvis), une jeune adolescente sauvage et réfractaire issue d’une terne banlieue de l’Est Londonien. Mia n’a qu’une seule et unique passion dans la vie : la danse Hip-Hop, à laquelle elle s’exerce en solitaire dans un appartement vacant, à l’abri des regards. Juste avant cette séquence, Mia vient de casser le nez d’un coup de têtes rageur à l’une des amies de sa meilleure copine.
Lorsqu’elle rentre chez elle, Mia caresse brièvement le chien, geste rare qui laisse entrevoir l’affection qu’elle exprime difficilement ailleurs. Ce moment de calme est aussitôt brisé par une gifle qui surgit dans le champ avant même que la mère n’apparaisse. La violence du geste précède ainsi le corps, dans une démonstration spectaculaire de brutalité arbitraire. Son surgissement depuis l’hors-champ, sans avertissement, accentue la dimension imprévisible et routinière de la violence domestique. Le couloir étroit, qui enferme les personnages dans un espace sans échappatoire, renforce encore le caractère inévitable de cette confrontation.
La mise en scène accompagne ensuite Mia vers sa chambre. Le passage du couloir sombre à la clarté pastel de la pièce crée un contraste marqué : c’est l’un des rares espaces du film où la jeune fille peut momentanément se reposer et retrouver quelque chose de son enfance. Andrea Arnold insère à ce moment trois courts plans sur des photos et des bibelots, traces d’une intimité ancienne, presque effacée. Mais ce répit est de courte durée : la mère, absorbée par ses ongles dans le salon, laisse Mia s’éclipser discrètement.
À l’extérieur, Mia assiste à une scène étrange : un jeune homme exécute des acrobaties contre un pilier de béton. Le plan est flou, ralenti, éclairé à contre-jour ; la bande-son étouffe les bruits du quartier. Le réalisme du film se fissure le temps d’une parenthèse contemplative. Ce garçon qui se cogne aux parois tout en jouant avec la verticalité des murs devient une sorte d’écho physique de Mia : lui aussi se heurte à l’environnement, mais il parvient à s’en détacher momentanément, à « décoller » du sol. La métaphore est subtile : il transforme la contrainte spatiale en mouvement, comme si l’énergie pouvait devenir un élan. L’arrivée du garçon que Mia attendait interrompt cette vision. Par un échange silencieux, on comprend que Mia n’est pas majeure et qu’elle fait livrer du cidre qu’elle ne peut pas acheter elle-même.
Dans la scène suivante, Mia franchit une nouvelle grille et force l’accès à un appartement vacant, espace clandestin où elle danse. Plusieurs coups d’épaule successifs, filmés frontalement, soulignent sa détermination autant que son enfermement : même pour atteindre son lieu de liberté, elle doit forcer le passage. Une brève série de jump cuts la montre buvant son cidre puis mettant ses écouteurs, avant d’être attirée par quelque chose hors-champ : sa mère qui s’éloigne dans la rue, apprêtée comme une adolescente en quête de séduction. Le regard de Mia reste fixé sur elle, tiraillé entre rejet et fascination.
Lorsque la musique commence, Mia tourne d’abord comme un lion en cage. La caméra la montre encapuchonnée, à contre-jour, luttant contre un soleil qui éblouit. Sa chorégraphie, encore hésitante, dit moins une maîtrise du mouvement qu’une tentative de se trouver. Mia bouge beaucoup, mais son périmètre demeure limité. Elle est en mouvement perpétuel dans un espace clos : elle avance sans avancer, elle cherche sans parvenir à s’arracher. C’est sans doute le sens du plan final sur l’éolienne : comme elle, l’éolienne tourne sur elle-même, produit de l’énergie, mais reste rivée au même point.