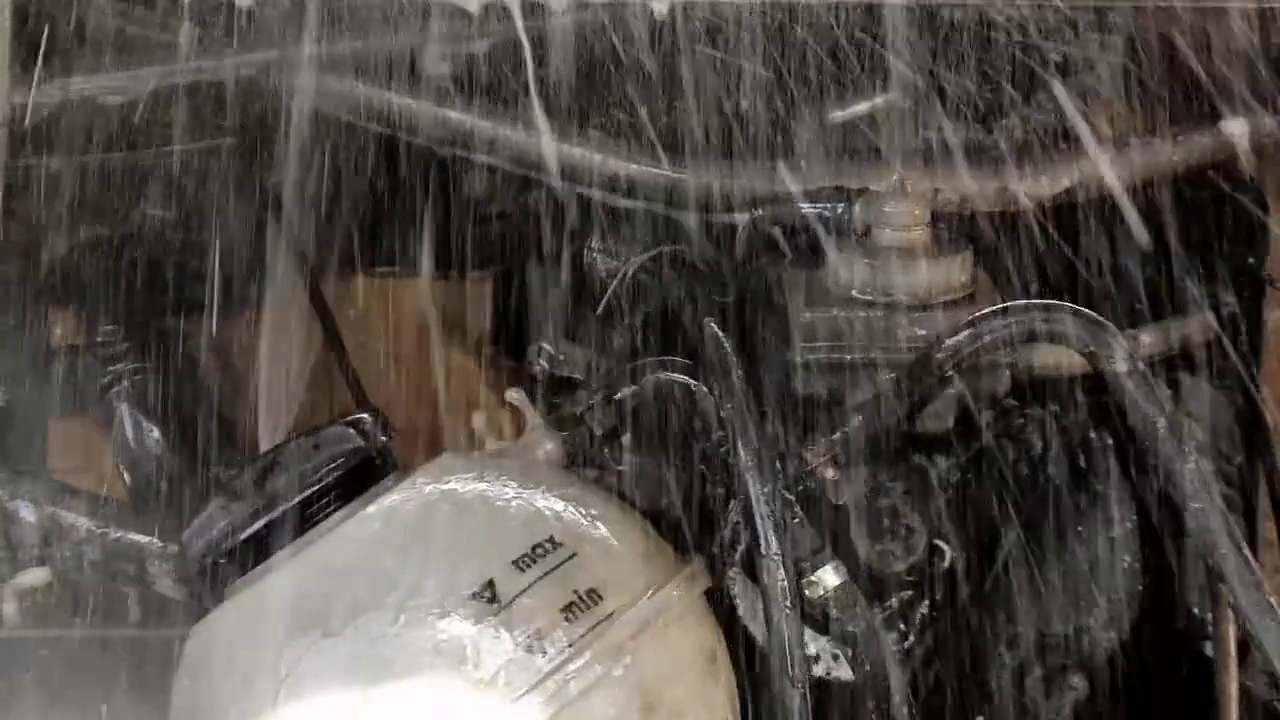Bagnoles en forêt : à propos de la post-nature chez Pugnaire et Raffini
– par Eric Loret
Voir les 5 photos
Jusqu’au 31 octobre, la Fondation d’entreprise Ricard, à Paris, expose les nominés de son prix, sélectionnés cette année par Marc-Olivier Wahler, commissaire et critique d’art, entre autres confondateur de la Chalet Society et ancien directeur du Palais de Tokyo. Les artistes choisis sont David Brognon & Stéphanie Rollin, Julien Dubuisson, Grace Hall, Robin Meier, Florian Pugnaire & David Raffini et Thomas Teurlai. Le prestigieux prix, qui a récompensé ces dernières années Adrien Missika, Lili Reynaud Dewar ou Camille Blatrix, est remis lors de la FIAC. Son lauréat voit une de ses œuvres acquises par le Centre Pompidou. Cette dix-septième édition ouvre et clôt son accrochage sur une œuvre du tandem Pugnaire & Raffini, intitulée Energie sombre (2012), déjà montrée au Palais de Tokyo, sur le site duquel elle jouit d’une fiche explicative emmenant son lecteur aux confins de l’univers.
Au dessus du comptoir d’accueil de la Fondation, donc, une vidéo. Au bout du parcours, le héros du film, un Transporter Volkswagen, salement ratatiné mais tout de même érigé – comme dans le film, qu’on trouve en ligne sur Vimeo.
Énergie sombre from documentsdartistes.
Si l’on triche un peu (en faisant un arrêt sur image), on aperçoit à la cinq cent-vingt-neuvième seconde d’Energie sombre un panneau routier indiquant la direction de Bagnols-en-forêt. Pour une vidéo mettant en scène une auto-destruction de voiture dans des bois et quelques carcasses accidentées, l’onomastique est trop belle : on est averti de ne pas prendre l’objet trop au sérieux (même si par ailleurs un autre panneau indique la ville du Muy et situe cette « fiction » à l’Est du Var, sur les contreforts du massif de l’Esterel). On sera de même bien avisé de lire les lignes qui suivent avec un sérieux tempéré.
La première interrogation, peut-être, qui vient à l’esprit si l’on regarde Energie sombre en mode cinématographique sans avoir rien lu d’abord, porte sur la temporalité et le point de vue. Qui regarde depuis où et depuis quand (analepse, prolepse, scène), même s’il apparaît assez vite que la vidéo met en parallèle, au début du moins, une temporalité de narration (la voiture) et le non-temps du documentaire (la nature). Comme souvent dans la vidéo d’art récente, la frontière entre les montages qu’on dénomme traditionnellement « parallèle » et « alterné » est volontairement brouillée : on ne sait si le sens est en quelque sorte déjà là mais « sensorialisé » selon un discours qu’il nous faut décoder, ou bien si les éléments qu’on nous montre sont sans rapport et offerts à notre liberté interprétative. Il n’y a de fait pas à choisir : l’indétermination est constitutive de l’œuvre. On peut, si l’on veut, supposer durant les premières minutes qu’un Transporter Volkswagen se rend dans une forêt. La vue subjective nous met à la place du chauffeur, mais comme on ne verra jamais celui-ci, c’est en réalité au van lui-même que nous sommes portés à prêter notre subjectivité.
De la forêt nous apercevons des branchages couverts de boue, des flaques, un cours d’eau dans lequel viennent pulser (grâce à un ralenti) des rejets verts puis bleu encre. Bientôt, la forêt apparaît comme un cimetière d’épaves tandis que nous reconnaissons, dans la carcasse pliée aperçue dans le premier plan de la vidéo, le Transporter jaune. Mais de ce fourgon détruit et fumant, la fumée s’échappe à l’envers, signalant une représentation rétrograde du temps. Le montage permet ainsi d’adopter une forme « explosante-fixe » en faisant se croiser deux lignes temporelles convergeant vers un même événement : la destruction du Transporter, mais sans que celle-ci soit définitive ni à proprement parler un résultat – en tant qu’elle achèverait un processus. Le passage du jour à la nuit paraît compléter ce dispositif en miroir, et l’on note (à condition de visionner plusieurs fois la vidéo, ce qui est rarement le cas dans une exposition) une sorte de répétition : lorsque vers la moitié du film, on se retrouve roulant de nuit, une balise à gauche de l’écran apparaît, semblable à celle devant laquelle la voiture avait tourné au tout début. Ce n’est plus l’eau et la terre qui l’attendent, mais l’air ou le feu cette fois, devant un atelier ou une serre éclairés comme pour un cauchemar industriel.
Pugnaire & Raffini labourent depuis 2008 le même sillon : celui des voitures non pas compressées par une force extérieure mais de l’intérieur. En bricolant des vérins posés dans la carrosserie, ils donnent l’impression que la voiture s’écrase sur elle-même, se replie, se rétrécit, comme si elle s’autolysait. L’érection finale de la Volskwagen détruite qu’on voit dans Energie sombre correspond à la description que donnent les artistes d’une autre de leurs performances, In fine (2010) : « une séquence d’auto-destruction à l’image d’un suicide de scorpion qui, lorsqu’il est acculé et sans espoir de survie, retourne son dard contre lui même. » Dardé donc, plutôt qu’érigé, ce qui n’est pas incompatible, comme on le sait, étant donnés Eros et Thanatos.
La deuxième série d’interrogations a trait aux références. Vient immédiatement en tête le genre de la course-poursuite : on pense à Duel (1971) de Spielberg (on ne voit jamais le conducteur du fourgon) aussi bien qu’à Ils attrapèrent le bac (1948) de Dreyer pour l’élément aquatique et la mort au bout :

Il y a évidemment les video games du type Destruction Derby et, du côté de l’art, puisqu’on est sur la Côte d’Azur, une possible citation des vieux maîtres que seraient Hans Hartung ou Yves Klein en tant que partisans d’une peinture rendue au geste, comme « impact » et « empreinte »[1]. Car si le travail de Pugnaire & Raffini ressortit à la sculpture autant qu’à l’installation, et si le pneu patinant dans la glaise fait en quelque sorte un travail de modelage, c’est plutôt la peinture que le début de la vidéo évoque, lorsque la boue gicle sur la carrosserie et que les branchages, tels des couteaux à peindre, raclent cette couche tout juste déposée. On se rappelle que Hartung, à Antibes, fouettait ses toiles avec des rameaux d’olivier.

Ci-dessus, à gauche : Hans Hartung, T1982-H12 (1982) © Fondation Hartung Bergman
Peut-être le bleu déversé dans la rivière est-il aussi un écho des « cosmogonies » de Klein ? On ne peut pas enfin ne pas mentionner le travail de César sur la compression de voitures (ici inversé, puisqu’il s’agit d’une expansion du vide et non d’une compression du plein) même si l’agressivité à l’œuvre dans cette Energie sombre rappellerait plutôt Arman. Enfin, le film Crash (1996) est une autre référence obligée, puisque le milieu de la vidéo nous introduit à une mécanique érotique surdéterminée qui évoque l’intrication de la chair et de la machine. Comme le dit une des héroïnes de Cronenberg, « les revêtements étaient humides. Ça puait le sang et d’autres liquides corporels ou mécaniques »[2]. Ici, on se prend à rêver que le nom de la bourgade sus-nommée se transforme en titre de porno franchouillard : Bagnoles en forêt, une escapade par delà le « min » et le « max ».
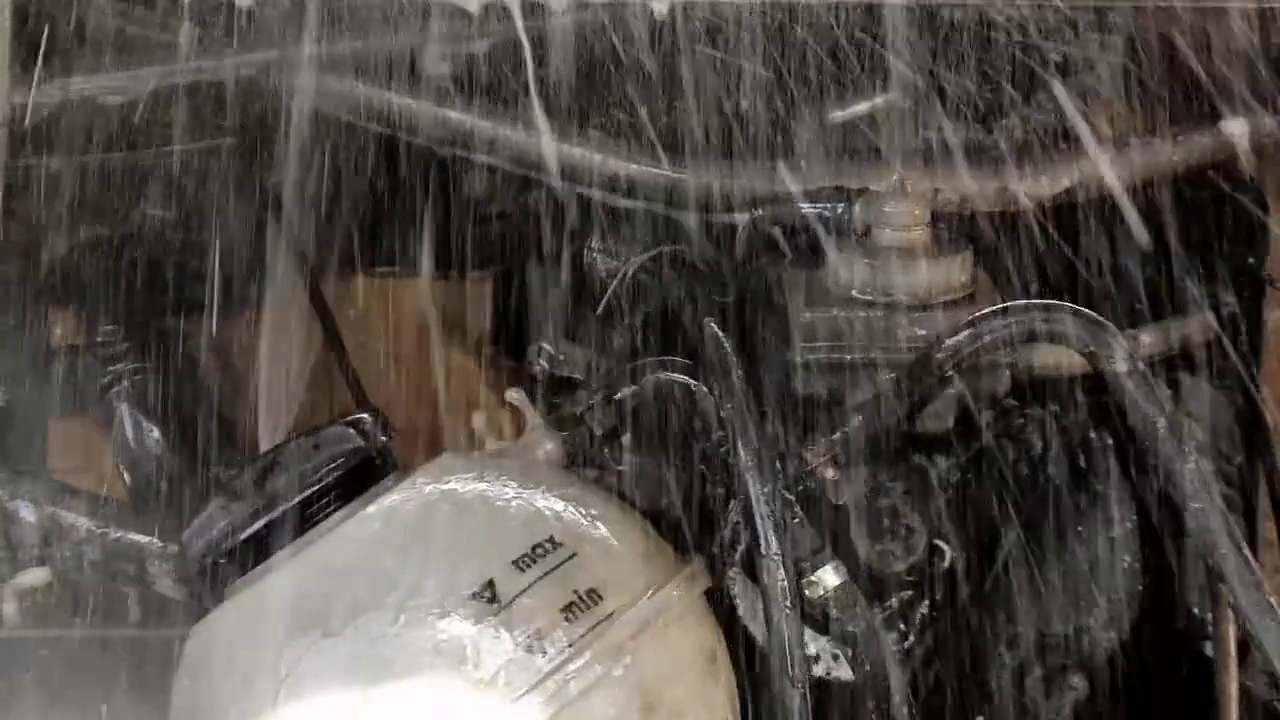
Si par son jeu de références et son aura négative, Energie sombre peut faire figure de commentaire sur l’accélération expansionniste de l’art contemporain au début du XXIe siècle, il n’en reste pas moins tributaire d’un certaine langue collective de cet art, tribut qui à la fois frappe en premier le regardeur découvrant l’œuvre, et lui donne le plus ensuite de fil à retordre. Car Energie sombre partage avec nombre d’œuvres récentes un goût symptomatique pour la représentation végétale.

Si quelques images de Pugnaire & Raffini (comme dans In fine, ci-dessus à gauche) évoquent un romantisme à la Caspar David Friedrich, on pense plus souvent cependant à certaines œuvres photographiques ou vidéo d’Adrien Missika, de Daniel Gustav Cramer, de Daniel Steegman Mangrané ou de Cyprien Gaillard, quoique ces artistes soient engagés chacun dans des voies bien distinctes. Mais ils partagent un topos contemporain, celui de la plante grasse, si l’on ose dire, de la végétation luxuriante : ce n’est pas leur sujet, c’est le milieu où celui-ci se développe. Une végétation vive, fétichisée par le point de vue du « robot cinéma » en ce qu’elle est à la fois attirante, impénétrable et singulière (la feuille, le tronc surgissent de l’image, comme chez Steegman Mangrané ou Gaillard, le premier ayant opté cette année pour l’immersion de l’oculus rift et le second pour la 3D).

Mais fétiche à la place de quoi ? Ce qu’on pourra noter, c’est que chez Pugnaire & Raffini comme chez Gaillard ou Steegman, il faut un œil « machiné » pour pénétrer la forêt, point de vue du van ou technologie avancée. Steegman a même produit une vidéo (16 mm, 2008-2011) selon un principe semblable à celui d’autopropulsion observé chez Pugnaire & Raffini : un travelling où le même moteur fait avancer la caméra et la pellicule, « chaque mètre de pellicule impressionnée correspondant exactement à un mètre de trajet dans les bois ». Confusion entre le regard et l’objet regardé, comme le Transporter « regardeur » va devenir insecte pour s’intégrer finalement à la végétation et à la nuit, pour que le machinique soit rendu à l’organique. Steegman justifie le choix de la jungle amazonienne parce qu’elle est le dernier lieu impénétrable et parce que, écrit-il, même à l’ère postcoloniale, « dans la jungle surviennent une succession de conflits : économiques, écologiques, géographiques, humains, scientifiques, historiques, territoriaux, etc. »[3] Dans le Nightlife de Gaillard, actuellement visible à la Biennale de Lyon, les arbres choisis figurent des « immigrants » indésirables ou se rapportent au démenti apporté en 1936 par l’athlète Jesse Owens à l’idéologie nazie. Une thématique déjà abordée par Missika l’an passé, puisque sa série de photographies de cactus We didn’t cross the border, the border crossed us « pointe cette question de la migration des populations humaines mais aussi des espèces végétales ». Dans la même exposition au Centre Culture Suisse, il y avait en outre Saving an Agave, vidéo où on le voit tenter « de sauver de sa mort imminente une grande agave americana, variété choisie pour son nom hautement symbolique » et qui meurt fissa si on ne lui coupe pas l’unique fleur qu’elle produit dans sa vie.[4]
Alors qu’il n’est question que de politique, on est frappé de voir l’humain absenté de ces œuvres, comme si l’humanité, en quelque sorte, n’était pas là possible, au regard de l’éternité (ou du temps documentaire) de la nature. Celle-ci a pris sa place, elle est devenue sujet politique, mais elle a pris aussi toute la place avec la machine : on est tenté de lire dans cette « post-nature » le pendant d’un « posthumanisme » qui se demande, dans une humanité élargie dans des serres-ateliers aux machines, aux plantes et aux animaux, qui gouvernera. Nulle réponse ici mais un constat, sombre et ludique à la fois : il faut paradoxalement sacrifier la vie à la survie, en coupant la fleur pour l’agave de Missika, en se piquant soi-même comme les voitures de Pugnaire & Raffini.
[1]Ariane Coulondre et Maurice Fréchuret, « La peinture autrement » in l’Art contemporain et la Côte d’azur, les Presses du réel, 2011.
[2]Cité par Jean-Luc Lacuve dans une note sur Crash.
[3]Voir sur le site de Daniel Steegman.
[4]Voir sur le site du Centre culturel suisse.