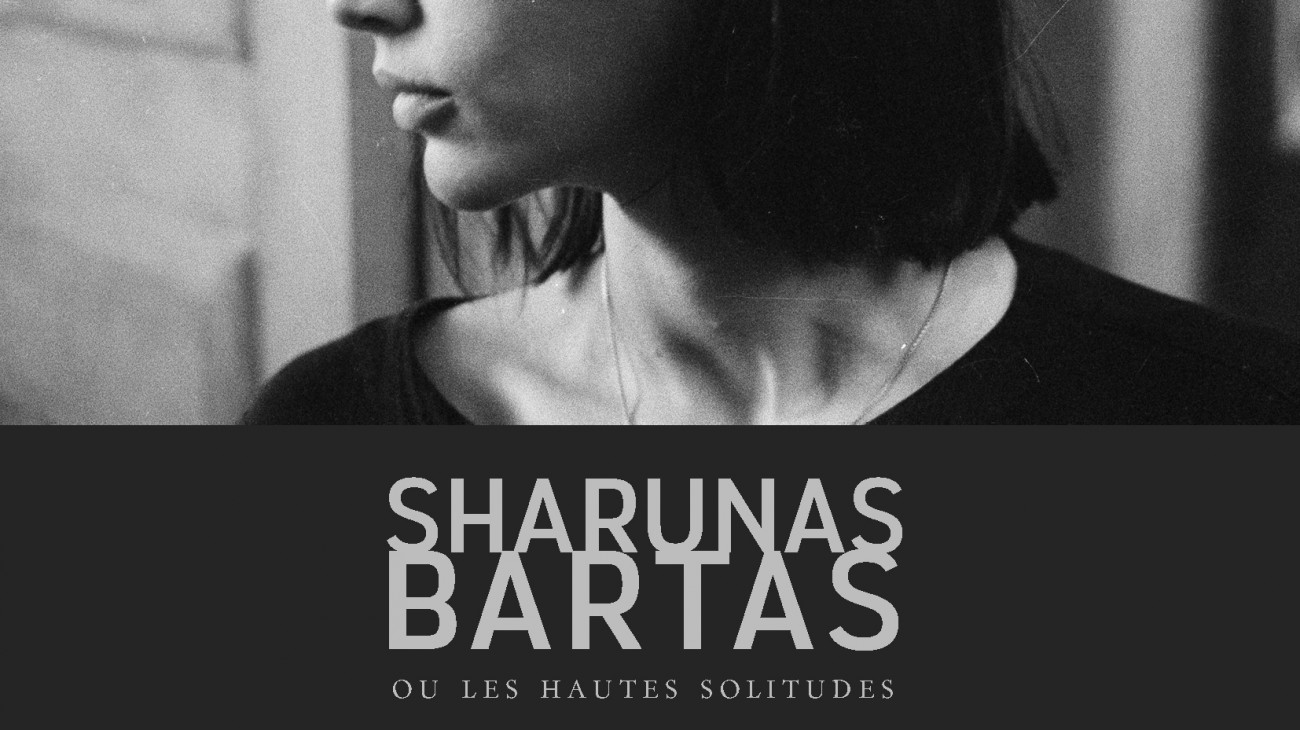Une poétique du désœuvrement
– par Robert Bonamy
Indigènes d'Eurasie (Sharunas Bartas, 2010).
Voir les 5 photos
« […] L’homme est l’animal qui peut sa propre impuissance[1]. »
« […] L’homme est l’animal qui va au cinéma[2]. »
Giorgio Agamben
A l’occasion de la sortie, ce mercredi 10 février, du nouveau film de Sharunas Bartas, Peace To Us In Our Dreams, nous publions le texte d’introduction, par Robert Bonamy, à l’ouvrage collectif consacré au cinéaste, qu’il a dirigé aux Editions de l’Incidence.
Nous le remercions, ainsi que Sabrina Luce-Bonamy, pour cette aimable autorisation.
Alors que le Centre Pompidou invite le cinéaste lituanien Sharunas Bartas à réaliser un film répondant d’une manière ou d’une autre à l’interrogation « Où en êtes-vous, Sharunas Bartas ? », comme il le fait désormais avec chaque cinéaste[3] auquel il consacre une rétrospective intégrale, cette introduction pose aux films de notre cinéaste une autre question, bien connue pour la pensée du cinéma : qu’est-ce que l’acte de création, Sharunas Bartas ? Les quelques hypothèses de réponses formulées dans ce livre dépassent de loin ce que souligne notre ouverture, et c’est notre souhait, ne correspondent pas seulement à une synthèse rétrospective cherchant à repérer les invariants qui formeraient un style trop bien identifiable. Le philosophe Giorgio Agamben, selon sa manière de déplacer autant que prolonger la célèbre conférence prononcée par Gilles Deleuze[4] à la Fémis en 1987 tout en remobilisant son titre, « Qu’est-ce que l’acte de création ? » dans un texte paru en 2014[5], nous permettra notamment de préciser ici un peu les choses, parce qu’il nous fait penser (à) Bartas. Ainsi l’acte de création est reconsidéré en faveur d’« une poétique du désœuvrement » – on ressent assez vite que le mot « désœuvrement » est incontournable pour les films de Bartas –, à travers ce qu’elle produit, réalise, sans se perdre dans l’acte pour investir ce qui reste en puissance. Cette hypothèse ne signifie pas, comme nous le soulignerons, un attrait de l’immobilisme, celui de la dépression des personnages, ou de ce qui se manifeste seulement en deçà de la parole, bien que les films de Bartas soient souvent connus et identifiés selon ces seuls critères insatisfaisants. Au fond il s’agit de réfléchir, avec les films de Bartas, à ce qui est impliqué et s’ouvre grâce à une résistance aux actes dans l’acte même de la réalisation filmique.
Le présent ouvrage collectif est parcouru par des questionnements qui concernent la création, en plusieurs gestes : il accueille des textes écrits par quelques cinéastes contemporains, de différentes générations, qui ont à voir, d’une manière ou d’une autre, de près ou de loin, avec Bartas ; des archives qui font comprendre quelques aspects du travail préparatoire pour ses films (scénarios, dessins, photographies, etc.) ; des textes poétiques ; une réactivation selon une forme performative ; des propositions d’analyses filmiques sensibles à la poétique de Bartas.
Les cinéastes dont les contributions ouvrent le volume peuvent ici parler avec Bartas, plus que sur Bartas, des possibles du cinéma et de ce que cette rencontre avec lui peut dire de leurs propres démarches individuelles. Parmi cette diversité, des éléments en commun apparaissent. À chaque fois, on ressent une proximité, un partage, un attachement, une avancée, un désir ou une idée. Les liens entre Bartas et Leos Carax sont assez connus, notamment grâce aux scènes que Carax joue dans The House (1998) et à celles que Bartas interprète dans Pola X (1999), deux films qui ne sont d’ailleurs pas tout à fait sans rapports. Il faudrait au moins ajouter que les pages arrachées et brûlées par Carax/Edgar dans King Lear (1987) de Jean-Luc Godard peuvent difficilement ne pas être mises en relation avec celles dont s’occupe Carax dans The House, dans son manteau constitué de pages choisies. Aussi, les trois très beaux textes que Carax avait rédigés à propos des premiers films de Bartas ne pouvaient pas ne pas être reproduits dans ce livre. Selon cette logique, nous devons tout autant évoquer le passage de Katerina Golubeva[6] de Trois Jours (1992), le premier long métrage de Bartas, à J’ai pas sommeil (1993) de Claire Denis, deux films qui ne paraissent là non plus pas sans liens, bien qu’ils correspondent à des conduites filmiques bien différentes. Mais ces relations assez visibles sont loin d’être les seules et le livre propose plusieurs indications et voies supplémentaires, en passant par des voix qui comptent pour nous. À chaque fois qu’un cinéaste ou un artiste parle de Bartas, il en ressort quelque chose d’intéressant, de précieux. Pas seulement dans cet ouvrage, bien entendu. Pensons par exemple au travail théâtral de Claude Régy. Deux phrases de son livre L’Ordre des morts (1999) parlent directement de Bartas, tandis que plusieurs aspects de la pratique des deux artistes peuvent plus généralement faire penser à une rencontre autour d’un tragique quotidien et de la recherche d’une « matière noire » dépassant les normes du dialogue et des codes relationnels : « Sharunas Bartas dans ses premiers films montrait l’état de pauvreté, d’inaction flottante. Il montrait des visages, longtemps, sans parole, sans rien.[7] » Régy évoque ainsi, certes brièvement et sans doute d’une manière beaucoup trop allusive qui risque de produire une note schématisant assez les films de Bartas, une connivence avec le cinéaste dans sa recherche d’un état sans nom, issu d’un complexe d’inaction, de lenteur, de silence ou plutôt d’une pensée des conditions de possibilité du langage ou de la communicabilité dont il s’agit de permettre les conditions d’expérience a priori impossible dans les logiques admises de la représentation du vivant. Inventer et investir cet état d’impuissance revient à le montrer, dans le temps de pose nécessaire ; à condition, pour le cinéma, de ne pas tomber dans la pose douteuse, autrement dit dans un cinéma qui serait poseur. Là serait peut-être le risque de la poétique de Bartas, mais ne faut-il pas tout de même être très prudent dans l’usage d’un tel reproche qui à notre sens ne peut correspondre qu’à un jugement beaucoup trop hâtif ? Si ce livre à plusieurs a paru nécessaire, c’est en pensant que les films de Sharunas Bartas sont l’exact contraire d’une (im)posture, qu’ils ne plongent pas non plus dans le nihilisme ; pas seulement parce qu’ils engagent toute sa personne, ce qui n’est pourtant déjà pas tout à fait rien. En outre, limiter l’économie de ses réalisations à un mutisme poseur selon une certaine mode cinématographique des vingt-cinq dernières années, dont il serait un des principaux initiateurs, est sans doute la principale erreur à ne pas reconduire.
S’il s’agissait de construire un lexique imaginaire pour le cinéma de Bartas, le premier mot, à la lettre A, serait, aussi étrange que cela puisse d’abord paraître, le mot accroupi.
Peut-être est-il justement possible de commencer par une pose, ou plutôt une position. Il est toujours un peu facile et simplificateur de procéder à un relevé systématique des occurrences d’une même attitude ou d’une même posture attribuée par un cinéaste à ses acteurs, dans le but d’en fixer une éventuelle interprétation fondée sur l’observation d’une répétition compulsive érigée par l’analyste en symptôme. Néanmoins, s’il s’agissait de construire un lexique imaginaire pour le cinéma de Bartas, le premier mot, à la lettre A, serait, aussi étrange que cela puisse d’abord paraître, le mot accroupi. La position accroupie se répète de personnage en personnage, dès son premier long métrage Trois Jours jusqu’à Peace to us in our dreams (2016), comme pour affirmer quelque chose dont nous ne percevons pourtant pas tout fait la teneur, dont on ne perce pas le sens. D’ailleurs, d’un film à l’autre, cette position n’est jamais envisagée de la même manière, elle est provisoirement sculptée différemment selon une répétition attentive qui permet d’observer à la fois une diffraction du sujet et une rotation des angles. Les personnages presque toujours sans nom sont pris dans une multiplication anonyme d’une même position qui ne se fixe jamais tout à fait pleinement, qui s’ouvre à un tremblement ou à un mouvement. Ils ne reprennent pas clairement les configurations, les expressions des célèbres sculptures de nus accroupis, disons de Michel-Ange à Rodin. Cette position est réécrite, remise en jeu, et si le récent Peace to us in our dreams (2016) y revient avec précision, c’est en partie pour la faire basculer. Dans ce film (fig. 1), donc, Lora Kmieliauskaite, dont le personnage ne porte pas de nom, s’avance dans une robe transparente en direction du ponton du lac situé au bord de la maison de campagne de son compagnon (Sharunas Bartas) dans laquelle elle s’est retirée avec lui et sa fille. Après qu’elle se soit dénudée, en enlevant sa robe transparente, un raccord modifie assez radicalement l’organisation de l’espace, la femme est filmée de trois quarts dos gauche accroupie sur le ponton où elle a déposé son vêtement alors que l’eau du lac occupe le plus grand espace de la partie supérieure du cadre. Elle est accroupie, les jambes repliées sur sa poitrine, chevelure partagée entre le derrière et le devant de son corps, en train d’effectuer des légers mouvements de bascule visant à lui donner l’impulsion nécessaire pour un plongeon en forme de salto dans l’eau ondoyante du lac. L’onde se transforme alors en plusieurs cercles excentriques et le bruit du plongeon a momentanément recouvert celui plus discret de la nature. Freedom (2000) cadre momentanément ainsi la jeune fille (Fatima Ennaflaoui, dont le personnage reste donc lui aussi innommé) qui fait face à la mer d’un territoire désertique au Maroc, dans lequel elle erre avec un homme (après qu’un autre les ait laissés à deux). Son corps prend une position accroupie très similaire, quasiment fœtale, à celle perçue dans Peace to us in our dreams. Avec quelques vêtements à ses côtés, elle est par contre plutôt filmée en légère contre-plongée, de trois-quarts face droit. Presque à l’inverse du film de 2016, donc. Un raccord dans l’axe, tandis que se poursuit le fond sonore de la houle d’une mer agitée par des rouleaux, la recadre en plan rapproché épaule, pensive, avec l’extrémité des genoux qui délimite le cadre et supporte son visage épuisé. Les plans durent, son corps est ponctué de taches de lumière. Un plan montre ensuite l’homme en train de regarder, mais comme toujours les rapports et les axes ne rendent pas tout à fait certain qu’il la regarde. Poursuivons une énumération non exhaustive tout en restant attentifs à la manière dont la filmographie tourne autour de cette position. Dans The House (fig. 3), une jeune femme nue est accroupie, dans la même position, mais cette fois de profil, son visage repose quant à lui sur ses deux mains appuyées sur un mur. Elle est placée à droite du champ et une pièce s’ouvre sans porte sur une jeune fille dont la course ralentie effectue des trajectoires circulaires entre quelques obstacles, alors que résonnent, réverbérés, quelques sons turbulents de portes grinçantes, des tintements de cloches et des présences humaines devinées. Cet enroulement spiralé est encore bien aux côtés de la position ici réellement fixe, comme si la jeune femme accroupie était à distance et en même temps au contact de ce que la course esquisse. Il y aurait bien d’autres cas, qui ne sont a priori pas toujours liés à une position fœtale regardant vers l’origine, dans presque tous les films, peut-être à l’exception de Corridor : celui de la jeune femme de Few of us (fig. 4), cadrée de trois quarts dos droit, se retournant à l’écoute des grincements et des toussotements du vieillard (peut-être simplement son grand-père ou son père), ou celui du garçon de Trois jours, au visage singulier, presque monstrueux, qui annonce quelques étranges figures à venir, qui fume une cigarette selon une des nombreuses pauses filmiques. Parmi les figures masculines, il y a celle, également nue, incarnée par Bartas dans Indigènes d’Eurasie (2010) (fig. 2). En cavale, le personnage de Gena (pour une fois, dans un film davantage narratif, moins réticent dans le développement d’actes au point de côtoyer un régime filmique apparemment différent, lié au film noir sur la mafia russe, les protagonistes portent un nom) prend une même position, encore renversée, puisque le devant de son corps accroupi est filmé de trois quarts face gauche. Cette scène d’épuisement, n’est pas traduite par une fixité, mais par un tremblement à proximité du feu qui le réchauffe mal et dont les flammes s’agitent. Comme pour les mouvements de l’eau, il y a une recherche, multiple, autour de la flamme et de la difficulté du récit. Un raccord dans l’axe montre une souffrance d’un visage, mais aussi la recherche contrariée d’une position. Aussitôt après, la séquence laisse place à un plan de deux poules d’eau qui plongent dans les eaux d’une forêt, dessinant des cercles ; Peace to us in our dreams s’en souviendra, à ceci près que des canards s’envolent au loin après que des tourbillons se soient dessinés à l’issue du plongeon de la compagne du personnage interprété par Bartas. Cette position est humaine, elle est courante dans certaines régions, mais elle a peut-être ici aussi quelque chose d’animal. S’il fallait poursuivre un lexique pour les réalisations du cinéaste, à la lettre B s’imposerait le mot bestiaire. Oui, les personnages se comportent parfois « comme des bêtes[8] », mais il y a une diversité innombrable d’apparitions animales dans ses films : les rennes lents de Few of us, ceux qui tournent dans la forêt, effrayés, de Peace to us in our dreams, les crabes et le reptile de Freedom, les chiens, les poules, les insectes, les chèvres, etc. La liste serait inarrêtable. Il y a sans doute ici une dimension compulsive, pré-individuelle, mais ces présences ne semblent pas univoques, au point d’être parfois non sans humour (à ce titre, l’humour, parfois la dérision et non le cynisme, est une donnée trop souvent négligée à propos des films de Bartas). Il est nécessaire de ne jamais simplifier le rôle de ces figurants ou de réduire leur « éthique zoologique », jusqu’à se demander si la caméra et l’écoute de Bartas n’ont d’ailleurs pas aussi quelque chose d’animal. On ne s’étonnera donc pas tout à fait, même si cela demeure hautement énigmatique, de découvrir, à l’occasion de certaines photographies prises sur les tournages, Bartas au travail dans cette position accroupie, regardant et pensant ses images à la recherche du tourbillon de l’âme humaine. Dans les premiers films, il fait insister des turbulences sonores insituables, en fond, qui accompagnent tous les personnages en apparence presque inactifs. Des voix non traduites et des bruits lointains défient les lignes claires du temps. Mais ne peut-on affirmer qu’il y a aussi un tourbillon d’images qui dépasse les seules logiques de regard, pour des visions (par exemple dans The House où plusieurs apparitions effectuent une ronde, d’un étrange rite costumé à des figures lointaines qui ne raccordent qu’étrangement avec les regards des enfants) ?


Figure 1 : Peace to us in our dreams / Figure 2 : Indigène d’Eurasie.
Avec le temps, et de temps à autre, les formes circulaires des tourbillons se dessinent et agitent les positions trop bien établies. Il ne s’agit pas de penser une relation trop autobiographique ou symbolique ; cette position est peut-être moins celle d’une protection, d’une prière, d’un repli personnel, que d’un regard et d’une écoute de la profondeur des gouffres de l’homme que les films de Bartas se risquent à approcher, en préservant un tremblement qui dépasse la seule structure stylistique. Peace to us in our dreams continue, à sa façon, ce tourbillon pour en faire son idée-fond, conscient qu’au cœur même de notre vie, le tourbillon de l’origine reste présent jusqu’à la fin et accompagne en silence chaque instant de notre existence. Parfois il se rapproche, parfois il s’éloigne si loin que nous ne réunissons plus à le saisir, ni à percevoir son gargouillement secret. Mais dans les moments décisifs, il nous prend et nous entraîne en lui […]. Il y a des êtres qui n’ont qu’un seul désir : se laisser engloutir par le tourbillon de l’origine. D’autres en revanche entretiennent avec l’origine une relation réticente et suspicieuse, s’ingéniant, dans la mesure du possible à ne pas se faire absorber par le maelström. D’autres enfin, moins courageux, n’oseront jamais y jeter un regard[9]. » C’est précisément ce regard et cette écoute de la puissance tourbillonnante que la passion courageuse de Bartas sait nous faire envisager et, par extension, à l’épreuve de laquelle il met ses protagonistes depuis ses premières réalisations. Les personnages « joués » – nous sommes toujours tentés de mettre un tel terme entre guillemets – par Golubeva dans Trois Jours et surtout dans Corridor ne sont jamais installés dans une fixité photographique, encore moins dans celle d’un dispositif pictural (de l’icône, par exemple) comme pourrait le faire croire le profil de couverture. Dans ce plan duquel est précisément extrait ce photogramme, elle effectue justement un mouvement de rotation, à l’équilibre certes incertain, en relation avec la perturbation sonore émanant peut-être des couloirs et des différents seuils auprès desquels elle bouge. Il y a dans les films de Bartas, il faut y revenir plutôt que les oublier, de nombreux mouvements de retournements, mais aussi des rotations complètes qui attribuent une autre puissance filmique que la prétendue fixité immobile et sans finitude. Le personnage est sans doute pensif, les yeux baissés, peut-être à l’écoute, mais, au-delà d’une pose stylistique, une trajectoire s’esquisse.
On a parfois le sentiment que Bartas actualise désormais un peu ce qui restait autrefois sans réponse, et les idées se forment plus ou moins au fil de sa filmographie. Ces mouvements de tourbillons sont figurés dans Peace to us in our dreams à plusieurs niveaux : dans les mouvements qu’effectue la compagne violoniste, jusqu’au tournis, après qu’elle se soit désaccordée avec le piano ; dans les différents retournements (dont, celui, final, de la fille qui disparaît de la fenêtre dans ce mouvement précis) ; mais aussi dans les mouvements de la nature qui laissent une empreinte très importante : les tourbillons dans le lac, les feuilles et les herbes qui tournoient particulièrement au vent, rendant ainsi visibles les trajectoires de l’agitation atmosphérique propre aux derniers plans du film. Cet aspect intervient alors à la fois dans les figures et dans le fond cinématographiques, ce dernier investit ici les éléments naturels plus que les voix et les bruits lointains (aux frontières du réel filmé) davantage travaillés par les réalisations des années quatre-vingt-dix. Ces remarques nous conduisent à insister sur une scène marquante du début du film, celle où le père (Sharunas Bartas) montre à sa fille (Ina Marija Bartaite) une vidéo avec des images d’elle, presque encore un nourrisson, avec sa mère (Katerina Golubeva). Au-delà de l’émotion particulière liée aux circonstances de la vie privée des trois personnes, une dimension proprement filmique s’impose. D’abord parce qu’un plan semble inséré parmi des images à l’esthétique beaucoup plus amateur, celui de Katerina Golubeva qui apparaît comme dans les films du cinéaste, ici en gros plan frontal, accompagnée par des sons hors champ, apparemment des voix d’enfants. Dans ce plan fixe revient son attitude parfois amusée de Trois jours. Un sourire remonte du fond de son visage. Dans les autres plans en apparence beaucoup plus prosaïques de ce « film retrouvé », Golubeva apparaît avec son enfant, elle a un visage différent, quotidien, et s’amuse dans une fête foraine. Le manège s’élance et la caméra est prise dans ses rotations. Le décrochage de ces images de l’esthétique de Bartas confie pourtant cette puissance du tourbillon dont l’émotion produite est si forte qu’elle peut difficilement être formulée. Par la suite, les protagonistes partent pour une maison de campagne, celle où Bartas a vécu et a préparé ses films précédents, notamment en compagnie de Katerina Golubeva, pour produire un étrange vertige temporel.
De très hautes solitudes dans les films de Bartas, mais un livre à plusieurs, pour dégager quelques pistes communes, tout en étant attentif à son travail sur l’individu ou la personne. Les personnages des films ne sont jamais complètement seuls ; ils sont peu, dans des lieux retirés, s’entendent rarement, au risque de s’isoler. Ils ne sont pas des personnages sans vie ou des fantômes. L’Histoire dans laquelle ils pourraient se trouver un contexte efface ses repères. Pour revenir aux solitudes, il n’est pas du tout impossible que Bartas s’intéresse au cinéma de Philippe Garrel, en dehors d’ailleurs d’une seule réflexion qu’un rapprochement forcé avec Les Hautes solitudes (1974) pourrait entraîner. Nous sommes à peu près certains que Bartas dialogue secrètement avec beaucoup de cinéastes, pas toujours les plus attendus (Murnau tout autant que Dreyer, pourquoi pas Ford[10], etc.). Cette observation évite de le placer dans le sillage du seul Tarkovski, malgré une filiation que la doxa critique semble lui imposer et répéter à l’envi. Cette relation n’est assurément pas fausse, elle n’est pas constante et pourrait bien être une source de plusieurs malentendus.
Dans le chapitre 4a d’Histoire(s) du cinéma, « Le contrôle de l’univers » (1998), Jean-Luc Godard ouvre et clôt avec Sharunas Bartas une assez longue citation de Penser avec les mains du philosophe « personnaliste » Denis de Rougemont, protestant suisse. On n’oublie pas, à cette occasion, l’importance de ce courant philosophique pour un moment de la critique de cinéma en France, qui commence avec la revue Esprit dans les années 30 ; mais on se gardera de suivre les enjeux théoriques de ce philosophe pour les relier à Bartas. Restons-en aux quelques mots convoqués par ce biais autour de deux de ses films. Le passage en question d’Histoire(s) du cinéma commence avec un bout de plan de Corridor et se clôt par un petit fragment de la fin de Trois Jours (la maison, le lac, la neige qui tombe). Les deux premiers longs métrages de Bartas encadrent donc une citation dont la pensée de la main concerne l’acte et l’esprit, la pensée qui se manifeste comme acte. Godard articule donc tout un texte sur l’Europe, la nécessaire responsabilité de la personne, le danger pris par toute véritable création, à une présence cinématographique de la main. Il commence alors par retenir deux gestes, pas tout à fait des actes, d’un des nombreux personnages anonymes et pourtant importants des films de Bartas. Les figures sans noms sont aussi sans doute celles qui ont des actes qui n’en sont pas tout à fait, sans sens clairement assignables. Le passage de Corridor s’affiche avec cette citation, entre deux extraits de films réalisés par Godard lui-même, For ever Mozart [1996] et Nouvelle Vague [1990], à la même période que les premiers films de Bartas. Un des deux jeunes personnages de Corridor, en l’occurrence la jeune fille, est cadré au centre de l’image, dans un plan rapproché de profil gauche juste au-dessus de la taille, dans le gris pelliculaire qui marque son corps nu d’une tache de lumière, presque une brûlure à l’épaule. « L’esprit n’est vrai que lorsqu’il manifeste sa présence… », la jeune fille lève le bras gauche, le plie, pour amener sa main sous son menton, elle pince son cou entre son pouce et son index. « Et dans le mot manifester, il y a main. », après avoir relâché son bras gauche, dont la main ressort en bas du cadre, c’est le bras droit qui remonte cette fois, le poing serré sous le menton. Ce geste ne répond à aucun usage ou à aucune représentation claire, il ne renvoie à aucune donnée symbolique ou ne reprend aucune signification clairement délimitée (politique par exemple). Mais ces gestes existent, désactivés d’une fonction. Ils n’ont rien de policé et trouvent une cadence qui n’est pas mécanique. Leur importance passe dans le film par un certain désœuvrement qui consiste à être attentif, à contempler une puissance gestuelle. Plutôt qu’un être inerte ou passant son temps à ne rien faire, quelque chose d’imparfait et d’intime se manifeste dans ce geste, et ce corps (au-delà de la main). En commençant à nous éloigner radicalement de la citation convoquée par Godard (peut-être en partie à tort, il faudrait étudier en détail le penseur qu’il convoque), nous nous approchons peut-être de ce qui correspond à l’acte de création dans la configuration critique que lui confie Bartas, puisqu’il n’est jamais tout à fait un acte clairement défini. Ainsi nous retrouvons la réticence de Giorgio Agamben vis-à-vis des termes de création et d’acte, pour leur préférer, dans le prolongement qui est le sien, celui de poétique (au sens du poein grec, de la fabrique) et de la puissance (dynamis) qui comprend, et le philosophe insiste particulièrement sur ce point, l’adynamia, la puissance de ne pas faire (et pas seulement le ne pas pouvoir faire[11]). À l’acte de résistance deleuzien de « Qu’est-ce que l’acte de création ? », Agamben répond par la résistance à l’acte et par une « puissance de ne pas » dans l’acte artistique réalisé. Si Agamben s’ingénie à ne pas parler de cinéma dans son texte, nous restons fidèles à sa méthode du prolongement et nous pouvons d’ailleurs supposer que ce texte, qui part en quelque sorte d’une réflexion pour le cinéma (celle de Deleuze), contient en puissance des ouvertures possibles pour le film. Le désœuvrement dans les films de Bartas rejoint en bonne partie cette désactivation puissance/acte et semble correspondre à cette hypothèse de définition d’une poétique du désœuvrement. Les plans des films de Bartas sont à la fois réalisés et ne se réalisent pas complètement. Cela permet ainsi de ne pas nous limiter à observer une prétendue apathie ou aphasie des filmés. Comme assez souvent, le personnage de la jeune femme dans Few of us (Katerina Golubeva) et celui du vieillard semblent toujours sur le point de se dire quelque chose en préservant la puissance de ne pas le faire, sans actualiser ce qui reste dans l’intervalle qui les sépare. Bartas filme précisément cet espace-temps et la durée de l’adynamia où se logent des possibilités cinématographiques tout à fait passionnantes. S’il fallait absolument trouver une comparaison avec un cinéaste contemporain, nous pourrions songer à la situation et à l’intervalle final entre les deux personnages, dans une des pièces du bâtiment abandonné, des Chiens errants (2013) de Tsai Ming-liang. Il y aurait d’ailleurs un rapprochement intéressant à faire entre leurs zones et lieux désaffectés ou délaissés. Tout en mesurant l’écart entre l’esthétique des deux cinéastes, ils semblent à la recherche d’un même invisible relatif, peu ou prou audible, qui n’est pas rien et répond peut-être à une autre physique. Il s’agit d’être attentif à ce qui passe entre les mailles de ce qui est formé, celles du style : ce qui tourbillonne invisiblement parmi les différentes composantes de la matière filmique : cela peut être de la lumière qui rend visible de la poussière, le vide empli de temps et de pensées qui s’éprouvent, se vivent.
Dans la suite du plan de Corridor prélevé par Godard, la main se rapproche du visage, qui est la figure souvent beaucoup plus directement retenue par les spectateurs de Bartas. Godard rabote considérablement le plan et la situation du film de Bartas : il isole la figure en obscurcissant l’arrière-plan, supprime la répétition du geste et son recadrage dans l’enchaînement des plans qui aboutit à un plan rapproché épaule, quasiment de face où une mèche de cheveux recouvre l’œil droit du visage. La jeune fille a désormais les deux poings refermés sous le menton. Il n’est pas du tout anecdotique de comprendre que le geste est effectué face à un miroir où la jeune fille contemple sa propre chorégraphie aux intentions floues, tout en en cherchant le tracé sans fonction : « La vie qui contemple sa propre puissance d’agir et de ne pas agir, se désœuvre dans toutes ses opérations, vit seulement sa vivabilité[12] ». Sans doute est-ce dans cette contemplation sans opération qu’apparaît la grâce de cette scène ; bien que toute une série de scènes de solitude face à un miroir soit dominée par une plus grande solitude et souffrance (des scènes au début de The House ou de Peace to us in our dreams, particulièrement). Disons qu’un autre regard existe pour cette séquence, puisque la jeune fille n’est pas seulement en train de se contempler, elle est observée à travers une fenêtre par le jeune garçon depuis son balcon. Un bruit la fait se retourner, elle fait face au point de vue en plongée du garçon avant que celui ne se retourne lui aussi pour fuir : on retrouve cette dynamique du retournement, du circulaire.

Figure 3 : The House / Figure 4 : Few of us.
Les personnages des premiers films de Bartas sont souvent observés dans leurs hésitations. C’est le cas dans Trois jours, où plusieurs errants ou sans abris (mais personne ne semble avoir véritablement d’abris…) ne cessent d’observer les protagonistes, notamment depuis un balcon. Dans ce même Trois jours, une séquence met en place, non sans humour (certes un peu désespéré) une scène de voyeurisme, dans une cour d’immeuble. Les situations optiques de désœuvrement s’agencent depuis le point de vue du personnage principal masculin qui a ouvert une fenêtre sur cour, depuis des toilettes, permettant à une lambada assez improbable de se déployer et de rythmer ce qui apparaît à chaque écran-fenêtre. Parmi ces saynètes qui apparaissent dans plusieurs chambres, un homme peu ou prou inerte est entouré d’une quantité étonnante de pastèques : est-ce tout à fait un hasard si Vive l’amour (1994) de Tsai Ming-liang est contemporain des premiers Bartas ? Si la fenêtre est l’élément de composition principal de Trois Jours, elle est très présente jusqu’au dernier film en date de Bartas, Peace to us in our dreams, et la disparition du personnage de la jeune fille dans l’ultime retournement d’un film qui sait aussi cadrer les chevelures féminines de dos. À ce sujet on notera une certaine instabilité de la couleur donnée à la chevelure de Lora Kmieliauskaite, avec des mèches blondes qui lui donnent une tournure étrange[13], presque turbulente. Lorsque la fille regarde à travers le rideau, avant de disparaître, on peut aussi que se souvenir de ce plan magnifique de Trois Jours où Golubeva regarde à travers l’échancrure d’un rideau qui magnifie son visage, des danses qui forment d’interminables cercles à travers deux fenêtres en forme de vitraux.
Les personnages secondaires ou les figurants sont filmés d’une manière parfois documentaire, certains à partir de focales beaucoup plus longues. Quand nous nous en approchons, nous nous apercevons qu’ils sont aussi toujours en train de surveiller. Les portes des maisons, les fenêtres sont ainsi des dispositifs de visions. Il y aurait ainsi comme des invariants dans les films de Bartas, qui aboutissent à des scènes types construites à partir de certains dispositifs et motifs structurants : le personnage tué au fusil (Few of us, Seven Invisible Men, The House, Peace to us in our dreams, etc.) ; le jardin cultivé dans une pièce intérieure d’une maison (Few of us, The House) ; le geste de fumer (la cigarette est bel et bien un dispositif[14]) ; les paysages (de Sibérie, de Crimée, du Maroc, etc.) ; l’utilisation d’expériences langagières : la langue des signes[15] (En mémoire d’un jour passé (1990), The House, notamment), de plusieurs langues : une longue conversation en russe s’insère parmi le lituanien de Peace to us in our dreams, celle des autochtones de Freedom, le langage gestuel des marionnettes (En mémoire d’un jour passé, The House) ; l’intérêt pour les physiques marginaux, presque des freaks ; les scènes de fêtes parfois interminables, de beuveries désespérées ; la maison, bien évidemment ; les cadres de perceptions, particulièrement la fenêtre et la porte dont les personnages se tiennent au seuil ; le poids de certaines références iconographiques issues de la peinture (on pense au sacrifice d’Isaac), de la religion, de rites ; etc. En même temps, ces éléments fixés dans leur répétition, déjà troubles dans leurs fonctions, sont toujours accompagnés d’écoutes, de regards et de prolongements incertains.
On comprendra ainsi sans doute mieux une poétique qui n’accomplit pas principalement des actes et se remet systématiquement au travail pour les différents âges de son cinéma : du fourmillement et des brûlures de la pellicule au numérique qui paraît plus lisse, du noir et blanc à différentes perceptions de la couleur. Pour approcher cette poétique, nous avons décidé de reproduire des archives du cinéaste. Reproduire des documents préparatoires de Sharunas Bartas, alors que ce qu’ils comportent est en apparence très souvent soustrait des films eux-mêmes, se passe ici de commentaires. Non pas qu’il y ait la moindre culpabilité à imprimer ces archives pas tout à fait personnelles : elles témoignent bien d’une fabrique filmique et d’une économie qui, encore une fois, réfutent l’idée d’un creare ex nihilo et confirment que Bartas n’est pas un adepte du rien, même si sa démarche n’est pas dans l’épanchement verbal (ici, la préparation n’est pas qu’écrite, elle passe aussi particulièrement par le dessin ou la photographie). Mais peut-être doit-on simplement se retenir d’y appliquer la méthode d’un exégète, d’un généticien du texte ou d’un biographe et compter sur la résonance que ces documents prennent avec l’ensemble des textes réunis dans ce livre, en termes de proximité, mais aussi d’écarts, puisque les développements narratifs et les personnages « scénarisés » ont finalement laissé le champ à quelques passages de l’écrit qui prennent des durées et des déploiements filmiques tout autres… On ne manquera pas de s’étonner que les scénarios parfois assez serrés, qui tiennent sur quelques pages, subissent d’une certaine façon des effacements : des éléments sont retirés pour des films qui se déploient sur des temporalités tout de même assez longues, pour d’autres durées. Le geste n’est paradoxal qu’en apparence et il ne s’agit sans doute pas de se demander ce qu’aurait pu être Few of us en s’ouvrant autrement que sur une série de plans de paysages et le visage de Katerina Golubeva, dont le regard se perd dans un hublot d’hélicoptère et The Unanswered Question de Charles Ives.
Le travail d’écriture est, à un moment, pour une raison ou une autre (par exemple, de production, de recherches de fonds, etc.), passé par une autre façon de raconter, un autre registre. Cet ensemble d’archives nous a en partie été confié par Guillaume Coudray[16], qui a participé très précisément à la préparation et au tournage de Freedom ; la place qu’y trouve ce film est donc aussi importante qu’éclairante. Beaucoup d’éléments écrits intriguent, au sens où ils ne nous semblaient – cela relève sans doute de la naïveté – pas pouvoir exister ; ils racontent autre chose que notre expérience des films et, en même temps, pas tout à fait autre chose.
Cela souligne que Bartas n’est pas simplement du côté de l’absence (de mots, d’écriture de projets, etc.) et que son travail de préparation ne se réduit pas à une logique programmatique, fonctionnelle.
Cela appelle une certaine discrétion et, donc, une exposition des archives comme éléments transitoires, laissés en leur état d’incertitude[17].
Nous remercions chaleureusement Sharunas Bartas, l’ensemble des contributeurs de ce livre, ainsi que toutes les personnes qui ont soutenu d’une manière ou d’une autre ce petit chantier, notamment Aurélien Barrau, Yves Citton, Sylvie Pras, Judith Revault d’Allonnes, Simon Lehingue : Norte, Pierre-Damien Huyghe, Kris, Jurga Dikciuviene : Studija Kinema, Janja Kralj : KinoElektron.

Sharunas Bartas sur le tournage de Peace to us in our dreams.
[1] Giorgio Agamben, Nudités, « Sur ce que nous pouvons ne pas faire », Rivages Poche / Petite Bibliothèque, 2012 (2009), p. 66.
[2] Giorgio Agamben, Images et mémoire. Écrits sur l’image, la danse et le cinéma, « Le cinéma de Guy Debord », Desclée de Brouwer, 2004, p.88.
[3] À titre d’exemple, « Où en êtes-vous, Tariq Teguia ? », réalisé en mars 2015. Cette collection « Où en êtes-vous » repose notamment sur des coproductions avec Arte France Cinéma. Sur l’essai d’une vingtaine de minutes proposé par le cinéaste algérien, nous nous permettons de renvoyer à une analyse qui lui est consacrée, aux côtés d’une forme brève que Teguia a réalisée pour la 70e Biennale de Venise : Robert Bonamy, « Le cinéma demain encore dira : ici, il y a quelqu’un) », revue Multitudes, no 61, hiver 2015, p. 198-203.
[4]Gilles Deleuze, « Qu’est-ce que l’acte de création », dans Deux régimes de fous / Textes et entretiens 1975-1995, David Lapoujade éd., Les Éditions de Minuit, 2003, p. 291-302. Retranscription de la conférence de Deleuze à la Fémis, à l’invitation de Jean Narboni, le 17 mars 1987.
[1]Giorgio Agamben, « Qu’est-ce que l’acte de création ? », dans Le Feu et le récit, Bibliothèque Rivages, 2015 (2014 pour l’édition italienne), p. 43-67.
[6]Katerina Golubeva interprète également le rôle d’Isabelle dans Pola X de Carax.
[7]Claude Régy, L’Ordre des morts, Les Solitaires intempestifs, 1999, p. 77.
[8]Sur certains comportements humains, qui passent par des attitudes animales, voir par exemple Pierre Zaoui, « rentrer comme des bêtes », dans Vacarme, no73, rentrer hors des clous, automne 2015, 63-69.
[9]Giorgio Agamben, « Tourbillons », dans Le Feu et le récit, op. cit., p.72. Notons que, dans l’édition française, ce texte suit directement celui intitulé « Qu’est-ce l’acte de création ? ».
[10]À ce titre, le rapprochement proposé par Olivier Séguret entre Seven Invisible Men de Sharunas Bartas et Seven Women (Frontière Chinoise, 1966), le dernier film de John Ford, est particulièrement séduisant. Voir Olivier Séguret, « Vestiges et vertiges des Soviets », Libération, 18 mai 2005.
[11]Sur ces points, voir également Giorgio Agamben, « Sur ce que nous pouvons ne pas faire », Nudités, op. cit., en même temps que « Qu’est-ce que l’acte de création ? », op. cit.
[12]Giorgio Agamben, « Qu’est-ce que l’acte de création ? », op. cit., p.64.
[13]Nous remercions Sabrina Bonamy de nous avoir indiqué l’importance de cette chevelure dans le film.
[14]Voir Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, Rivages poche, 2014 (2006), p.31.
[15]Ce qui distancie, malgré la tentation de les rapprocher, les films de Bartas des écrits de Balázs et de « l’homme visible » particulier au cinéma dont le corps ne renvoie ni à l’écrit, ni au langage : « Car l’homme de la civilisation visuelle ne remplace pas des mots par des gestes, par exemple les sourds-muets avec leur langage des signes. […] Ici l’esprit se fait corps, directement, visible sans l’aide des mots ». Béla Balázs, L’Homme visible et l’esprit du cinéma, Circé, 2010 (1924), p.18.
[16]Guillaume Coudray a réalisé le documentaire Sharunas Bartas, An Army of One, 2010. A l’exception des synopsis de Peace to us in our dreams (confiés par Studija Kinema et KinoElektron), l’ensemble des documents reproduits dans la partie II de ce livre sont issus de son travail auprès cinéaste lituanien.
[17]Voir Claude Régy, L’État d’incertitude, Les Solitaires intempestifs, 2002.