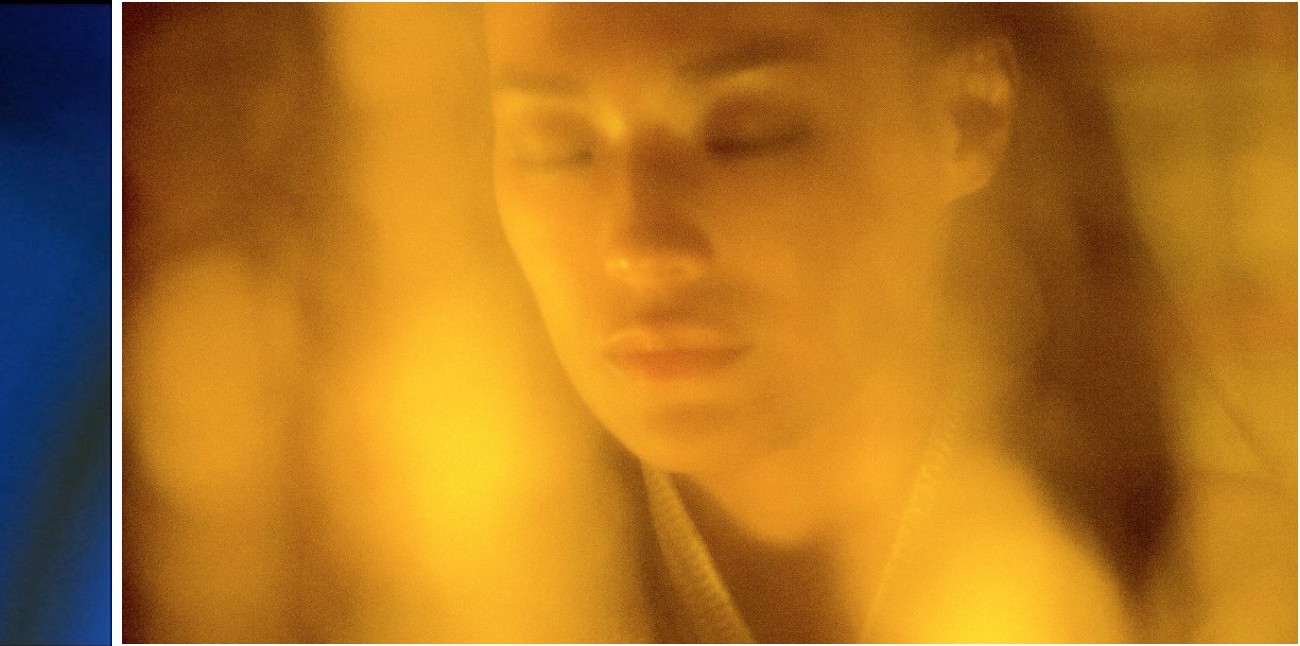Actions, vocations, provocations (Devenir l’acteur que l’on est)
– par Le Café des Images
Poussières dans le vent (Hou Hsiao-hsien, 1986).
Voir les 6 photos
Cet article fait partie d’un cycle
Nicolas Maury était le 20 mars l’invité de Maud Wyler pour son rendez-vous mensuel « L’acteur : regard caméra ». Film choisi : Poussières dans le vent, Hou Hsiao-hsien, 1986. Ce fut un moment rare. Partant de Hou et d’un certain rouge aux joues, Maud Wyler et Nicolas Maury ont fait souffler loin, et où ils voulaient, le vent de leur parole. Avec passion et patience, provocation parfois, ils ont évoqué ce que cela veut dire, et ce qu’il en coûte, que de jouer : quelles convictions et quelles incertitudes, quelle discipline, quelles joies aussi.
Nicolas Maury : Je n’ai vu Poussières dans le vent qu’une seule fois avant ce soir, mais j’en ai tellement parlé que j’avais l’impression étrange d’avoir vécu cette histoire. Je me demandais si je n’avais pas fantasmé le film… Je me rends compte en le revoyant que ce n’est pas le cas. Un mot vient tout de suite à l’esprit : « transparence ». On pourrait l’utiliser pour évoquer le jeu d’acteur, ou le travail d’un peintre, mais il s’agit plutôt dans ce film d’une transparence de personnes. D’où vient-elle ? Je ne sais pas s’il est intéressant de le savoir. Est-elle liée à l’écriture du présent chez Hou Hsiao-hsien ou à la capacité des acteurs de réussir leur abandon ? « Réussir » … « un abandon » : ce sont deux choses qui a priori ne vont pas ensemble. Du point de vue du cinéaste, cela voudrait dire filmer l’oxygène, ce qui est entre, autour, non-dit, les pudeurs, les impudeurs ; pour un acteur, on pourrait dire que cela revient à se laisser filmer, mais ça ne serait pas suffisant : nous sommes des corps mis à l’épreuve sur le tournage. Je me demande comment Hou a pu filmer les états, les températures, les émotions de cette famille, comme un éphéméride ou une météo… Cela reste pour moi de l’ordre du mystère. C’est ce que j’aime dans les interprétations au cinéma.
Maud Wyler : Je serais volontiers tentée de ne rien dire, ou presque rien, tant j’aime t’écouter… Au début, lorsque l’enfant refuse de manger, il sourit à la fin du plan parce qu’il est touché par la scène qu’il a dû jouer. Lorsqu’on le retrouve dans le plan suivant, on a l’impression qu’il a pleuré, qu’il va très mal. Un fleuve semble avoir coulé entre les deux. Je peux me raconter tout un monde. L’acteur nous offre cela de façon troublante, jamais intellectualisée ou démontrée. Il fait apparaître en ôtant, comme des vagues qui repartent sur le sable découvrent du palpable. Lorsqu’ils sont au restaurant, l’homme s’empêche de regarder la femme, sauf à deux moments, et son premier regard est foudroyant. Il traverse le corps, nous renvoie à notre propre cœur. Le cinéma prend tout son sens en cet instant.
N.M. : Je trouve bouleversant – il faudrait un meilleur mot – de montrer la naissance de l’amour, ou l’impuissance à regarder l’être aimé dans les yeux, comme la Pythie. Le premier regard que l’homme porte sur la femme est d’une telle force… Les Éditions de Minuit pourraient publier un roman sur ce seul regard. C’est d’autant plus beau que cela n’est pas une acmé. C’est une trouvaille – j’emploi ce terme un peu facile à dessein –, un concept réussi car vérifié, palpable. Il appelle autre chose, de l’écriture, du littéraire. Ce regard foudroyant appelle une autre scène, d’autres regards. Si j’ai choisi ce film, c’est aussi parce que lorsqu’on demande aux acteurs ou aux actrices qui sont leurs idoles, les réponses évoquent souvent des monstres sacrés du cinéma américain, comme Gena Rowlands ou Leonardo DiCaprio… Je les apprécie beaucoup, mais j’aime aussi Zhao Tao, qui joue dans presque tous les films de Jia Zhangke, ou Shu Qi, chez Hou Hsiao-hsien, qui joue dans The Assassin, Three Times, Millenium Mambo. Ce sont des actrices qui accompagnent le cinéma de leurs cinéastes.
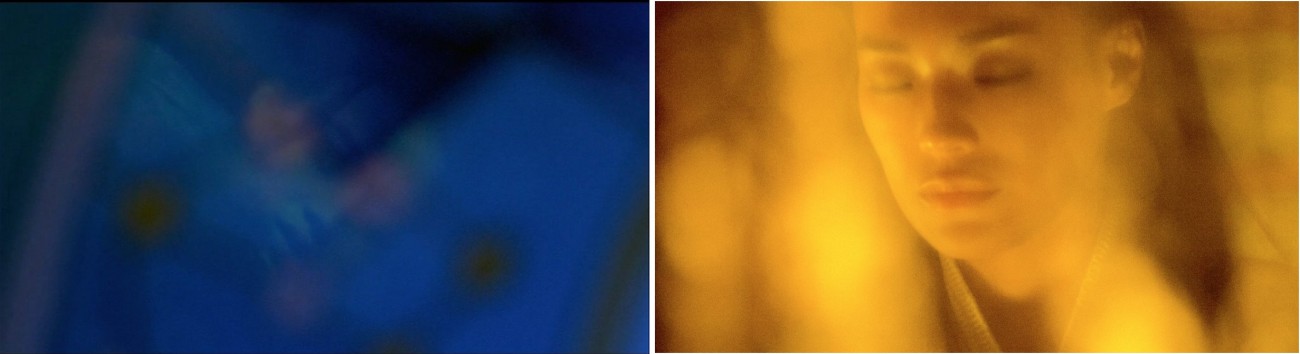
Millenium mambo (Hou Hsiao-hsien, 2001) / The Assassin (Hou Hsiao-hsien, 2016).
On pourrait également évoquer DiCaprio / Scorsese ou Gena Rowlands / Cassavetes : j’aime ces poupées-là, le devenir-marionnette d’un acteur, qui ne renvoie pas fatalement à une entreprise de dépersonnalisation. Cela pose la question de la volonté de l’acteur. Je considère que la volonté et la virtuosité sont ce qu’il y a de plus facile à faire. L’art du visible est le plus élémentaire. Lorsqu’on a la vingtaine et qu’on apprend ce métier, on aime porter des habits de virtuosité. Ce ne sont jamais que des oripeaux. Convoquer sur un plateau de théâtre ou de cinéma ce qui n’a pas de poids en apparence, l’impondérable, offre bien plus de possibilités que ce que l’on peut soi-même imaginer. Est-ce le cinéma français qui ne veut ou ne peut pas filmer l’impalpable, le convoquer avec autant de force ? J’aime cette lenteur, cette idée de dépôt le temps d’un plan. Il faut bien sûr que ce plan soit réussi, ce qui exige beaucoup de minutie, mais le film fait l’aller-retour entre ce que l’on prévoit et ce que l’on cueille. Le cinéma existe dans son intelligence à accueillir le non-écrit. Les choses sont peut-être différentes en comédie. Quoique…
M.W. : Il me semble que dans ton travail, tu injectes précisément dans ces creux quelque chose de l’ordre de la comédie, ce qui est assez rare. Je me demande comment tu organises, ou désorganises tout cela. En te voyant jouer une femme dans une pièce de Marivaux, je me suis dit que tu étais la plus grande actrice du moment. Ta liberté, ton aisance, ton habileté, donnaient l’impression que tu pouvais aller partout, jouer tout, en l’occurrence une femme, dans toute sa complexité, son amour et ses failles. Je comprends que cela t’intéresse d’enlever, d’ôter, de défaire, mais si je me souscris à moi-même, quelle couleur cela produit ?
Je crois qu’être acteur, c’est être auteur de son présent, écrire sa présence. J’écris la mienne en regardant mes fantômes en face.
N.M. : Je ne parle pas de moi ce soir, je parle en tant qu’acteur en France. J’essaie de rendre objectif ce qui serait fumeux. Le film de Hou Hsiao-hsien me paraît « démocratique », et j’aimerais que cette rencontre le soit aussi. Il faut mettre des mots, ce qui peut être long, et chiant… On m’invite à venir parler d’un film que j’ai choisi. Or, je ne l’ai pas choisi au hasard. Parfois, il n’y a rien de plus passionnant que d’entendre un écrivain parler d’un autre écrivain. Je crois qu’être acteur, c’est être auteur de son présent, écrire sa présence. J’écris la mienne en regardant mes fantômes en face. Mes fantômes sont les films que je vois, les livres que je lis. J’en lis et j’en vois beaucoup, ce qui n’est pas le cas de tous les acteurs. J’existe dans cette éducation du regard, dans ce muscle, cette idée que soi, c’est les autres. Que je tourne pour France 2 ou dans un film dont on dira qu’il appartient au cinéma d’auteur, je m’adresse toujours à l’intelligence du spectateur quand je joue. Je ne mets pas de barrières. L’art ne va pas taper à la porte des gens, ce sont les gens qui viennent à lui. Je suis contre l’idée qu’il faudrait penser au grand public. Il n’existe pas pour moi. Il faut s’ennuyer beaucoup, aller vers ce qui ne nous servira pas immédiatement.
Emmanuel Burdeau : Tu as tout de suite évoqué l’envie de montrer un film asiatique lorsque nous nous sommes rencontrés pour préparer cette séance. A priori, Poussières dans le vent n’est pas le genre de film à partir duquel on penserait pouvoir parler des acteurs. D’où notre étonnement, au départ, et notre enthousiasme… Le jeu n’est pas spécialement visible, le registre d’expressivité n’est pas très large. Il est d’ailleurs dit que le personnage principal a un visage de pierre. Nous nous sommes entendus sur Hou Hsiao-hsien, en raison de l’actualité – The Assassin vient de sortir et une rétrospective se tient en ce moment à la Cinémathèque française –, mais nous avons également évoqué Jia Zangkhe et d’autres cinéastes asiatiques encore. Qu’est-ce qui t’intéresse chez eux, en tant que spectateur et en tant qu’acteur ?
N.M. : C’est peut-être une question de culture, mais pas tant que cela. Je ne suis pas spécialiste du cinéma asiatique, mais j’ai l’impression qu’on y tait plus qu’on n’y dit. J’aime l’idée qu’un acteur n’en pense pas moins. C’est ce qui me fait tendre l’oreille. Je ne parle pas de l’acteur-penseur. Quand on est devant une caméra ou au théâtre, il faut bien sûr une mémoire du texte, mais il faut aussi être attiré par quelque chose qui nous dépasse, laisser entrer des éléments hétérogènes, autre chose… De l’inconscient ? Je ne sais pas. Un gros plan sur un acteur est la somme de tout ça. Dans un film comme celui-ci, que je considère comme un film d’aventure – je le pense vraiment, je ne dis pas ça pour faire mon malin –, dans cette aventure amoureuse, ces allers et retours entre Taipei et la campagne taïwanaise, il y a des choses qui naissent mais aussi l’idée que peut-être, comme la nature, tout a déjà été là, déjà été vécu entre eux, dès l’enfance, dès ce voisinage. Comment jouer cela lorsqu’on est acteur ? Il faut se concentrer, faire taire l’hystérie. Tu parlais d’un visage de pierre : je considère que c’est un compliment. On peut dire des grands acteurs qu’ils ont un visage minéral.
E.B. : Lorsqu’on demandait à Chabrol pourquoi il avait aimé travailler avec Michel Bouquet, il disait qu’il aimait son côté minéral.
Yannick Reix : On essaie dans cette salle d’effacer la frontière entre le grand public et le cinéma d’auteur. Poussières dans le vent permet de s’attarder sur la question d’un cinéma « démocratique », pour reprendre le terme que Nicolas utilisait tout à l’heure. Le film montre la banalité du quotidien, que l’on ne voit pas souvent au cinéma. Quand un acteur fume une cigarette, on le voit prendre le paquet dans sa poche, sortir la cigarette, la mettre à sa bouche, l’allumer puis remettre le paquet dans sa poche. Le film montre aussi quelqu’un faire ses lacets, ce qui est très fort car rare au cinéma, une fois de plus. C’est peut-être là qu’il faudrait chercher la définition d’un cinéma populaire ou grand public, celui qui s’intéresserait le plus aux gens en montrant leur vie. Le cinéma occidental porte l’héritage de la tragédie grecque et du spectaculaire, ce qui n’est pas le cas du cinéma asiatique, qui s’inscrit plutôt dans la grande tradition du masque. Les petites choses deviennent spectaculaires. L’événement, c’est un pétard dans ce plan magnifique sur un vieux monsieur qui s’éloigne. La scène où les personnages s’amusent à soulever des pierres est également très drôle : c’est une séquence importante, un moment structurant du film, qui aborde le thème du poids des choses.
N.M. : La scène de la projection en plein air me touche particulièrement. C’est une démocratie, mais une démocratie du regard. On n’est pas à la messe devant le cinéma. Un drame humain essentiel se joue parce qu’un garçon se fait engueuler par sa mère dans un coin et revient dire à ses amis : « Je n’ai pas pu dire à ma mère que j’ai été battu. Je lui ai dit que j’étais tombé de moto. » Il préfère passer pour quelqu’un qui travaille mal et crame son argent, plutôt que dire qu’il a été soumis à quelqu’un de plus élevé socialement. Ce qui me plaît, c’est que les garçons se mettent devant la fille, qui ne peut donc plus voir le film projeté. J’aime d’ailleurs beaucoup ce film dans le film, cette idée absurde, au ras de l’ordinaire, d’oies qui passent sur un pont. Je ne sais pas si le film existe vraiment. En un sens, il va encore plus loin qu’Hou Hsiao-hsien. C’est beau parce que ça n’est pas grave. Un évènement se produit, mais il ne détruit pas le film, dont la projection se poursuit. Certains spectateurs continuent à le regarder, et le personnage se lève pour voir les ecchymoses. C’est ça, Hou Hsiao-hsien ; c’est ça, le cinéma. Je n’aime pas quand on étalonne l’importance des choses à ma place, quand on me dit : « Ça, c’est rapide ; ça, c’est court ; ça, c’est bien ; ça, ça n’est pas bien. » La « démocratie du regard », c’est comme lorsque Deleuze explique la différence entre la gauche et la droite, qui serait une question de perception du monde. Penser que son quartier n’est pas là où l’on habite, mais l’Afrique lointaine. Mon quartier n’est pas ma rue, mais ce qui se trouve le plus loin possible. Lorsqu’on explique une référence ou une idée, on lui ôte son charme. C’est peut-être pour cela que je voulais choisir un film surprenant en apparence, parce que c’est une chose de cœur, pour montrer que c’est dans l’hétérogène et le lointain que se passe l’essentiel.
E.B. : Le film est à distance de nous qui ne vivons ni à Tapei ni dans la campagne taïwanaise, mais aussi de lui-même, comme toujours chez Hou Hsiao-hsien. Il est fait d’effets déportés, d’évènements différés.
N.M. : Exactement, le film se déporte lui-même.

Poussières dans le vent.
E.B. : La femme ne manifeste son émotion qu’une fois qu’elle est mariée à un autre, c’est comme si les choses n’étaient jamais à la bonne place. Il y a parfois chez Hou une pointe de maniérisme, moins marqué sans doute à cette époque qu’aujourd’hui. Comme dans Three Times, si le film donne l’impression de montrer une partie de billard, le spectateur sait qu’il comprendra quelques minutes plus tard que l’histoire est ailleurs. Le premier épisode de Three Times raconte l’histoire d’un garçon au service militaire dans les années 1960, qui tombe amoureux d’une fille employée dans une salle de billard. Il y a certaines rimes entre cet épisode et Poussières dans le vent, comme la présence d’une lettre. Lorsque la jeune femme de Three Times débarque dans la salle de billard, elle trouve une lettre d’amour écrite par le garçon, mais qui ne l’a pas encore rencontrée. La lettre est destinée à l’ancien amour du garçon, mais la fille la prend pour elle. Elle est donc à la fois en avance et en retard. Hou a poussé ce principe jusqu’à un niveau de sophistication extraordinaire.
N.M. : Je veux bien entendre et voir ces « manières » là. Ça n’est pas un méchant mot, même si le terme « maniérisme » est différent. Il n’y a pas d’art sans forme. Heureusement qu’il y a des manières chez Echenoz, par exemple, ou chez Fassbinder.
Spectateur : Devoir jouer le naturel et le quotidien aide sans doute l’acteur à trouver un jeu plus juste. Le naturel est plus présent dans le cinéma asiatique que dans certains cinémas où le scénario est très construit. La justesse est peut-être au fond plus difficile à atteindre dans le cinéma occidental.
N.M. : Il faut se méfier des termes. Bresson disait : « Au naturel, je préfère la nature. » C’était sa réponse quand on lui reprochait le manque de naturel de ses acteurs. Voilà le genre de phrase qui me fait avancer. Je ne suis pas un acteur français à la Tahar Rahim : je ne suis pas naturaliste, je n’arrive pas avec mon blouson en cuir, un casque, toujours en retard, qui prend des cafés qu’il ne paie jamais. Je ne fais pas ça. Moi, dans mes films, je paie mon café et je n’ai pas de moto. J’en suis conscient et je ne me considère pas comme une victime – j’ai appris à ne plus l’être. Je considère que la justesse est la moindre des politesses. On l’oublie souvent. Bien des fois, les critiques trouvent un acteur formidable parce qu’il est juste. Je mets au défi les gens de cette salle de tourner une scène, la même : tout le monde sera juste. Je ne considère pas du tout la justesse comme une réussite.
A propos de votre remarque sur ce qui n’est pas circonscrit par un scénario, il me semble que lorsque les personnages parlent dans Poussières dans le vent, même s’ils ne le font pas dans notre langue, on sent la réplique, le dialogue. Personne ne va voir les films d’Hou Hsiao-hsien pour la verticalité, la poésie d’une réplique ou d’un texte. Les choses sont ailleurs. On croit souvent que c’est dans sa façon de tenir un texte, de mâcher ou de marmonner une réplique, qu’un acteur peut être juste. Or c’est un tout, comme pour un interprète en musique : il y a la partition, et les décisions qui se prennent en direct. Il faut sentir que l’acteur va quelque part mais aussi parfois ne plus le sentir du tout.
Poussières dans le vent est en outre un film sur le destin, qui se passe de mots, montrant des choix de vie, rentrer chez soi ou non. Peut-être qu’en revenant de l’armée, le personnage entrevoit l’image de ce qu’il va devenir en voyant son grand-père adoptif. Je ne vois même pas comment Hou Hsiao-hsien pourrait l’écrire dans le scénario : « Face à face avec le grand père en train de pécher. » Quand on l’explique, cela s’effondre, devient nul. Quand on le vit, c’est du cinéma, et ça n’est que cela.
E.B. : Il n’est pas impossible que tout soit écrit dans le scénario. Je ne sais plus si c’était le cas à l’époque de Poussières dans le vent, mais Hou travaille depuis longtemps avec une écrivaine, Chu Tien-wen, avec qui les choses sont très écrites. Ils font ensemble beaucoup de recherches en amont des films. Un livre vient de paraître. Il regroupe des notes de tournage et le scénario de The Assassin, qui n’a paraît-il rien à voir avec le film.
Une question pour vous deux, à propos de la fameuse scène où le jeune homme rougit : lorsque vous voyez cette scène, vous demandez-vous comment il s’y prend pour rougir ? Est-ce intéressant de se demander où est le travail, la mise en condition ?
M.W. : Si j’étais face aux acteurs ou au réalisateur, je ne voudrais pas le leur demander. Peut-être que je n’oserais pas, mais quoi qu’il en soit, je ne voudrais pas savoir. J’aurais peur d’être déçue par leurs explications. Ce qui m’intéresserait, c’est d’imaginer tous les chemins possibles, de rester dans un rapport sensible. C’est peut-être un leurre : je me mens en omettant la technique, mais je le fais un peu exprès. Je ne sais pas si la technique m’intéresse tant que ça. Le film est par ailleurs tout à fait technique, avec des plans très travaillés. La forme est visible et pourtant, le fond émane absolument. Je travaille dans ce que je sais mais aussi dans ce que je ne sais pas. A aucun moment je me dis en voyant jouer un acteur : « Tiens, il est malin dans sa façon de jouer. » Je ne le vois pas se dire : « Là je vais leur faire ça. » C’est le contraire d’un cinéma américain, de performance, dont on pourrait aussi parler, où je sens très bien qu’à un moment, l’acteur me dit : « Tu vas voir ». Comme une menace. C’est en tout cas ce que j’éprouve parfois en tant que spectatrice.
La relation entre l’acteur et le cinéaste se passe comme en amour : parfois on veut être tenu, parfois on veut se sentir libre. Heureusement que tout existe, mais à ce moment précis, dans ce film, je trouve agréable que l’acteur ne tricote pas avec moi, qu’il soit dans la confiance. J’ai l’impression d’être lavée des a prioris, sur le cinéma mais aussi sur les gens. Il n’y a pas d’autorité ni d’ego. Ou s’il y en a, je ne les vois pas.

Maud Wyler / Nicolas Maury au Café des images (photographies de Thomas Clolus).
N.M. : Je suis d’accord avec Maud. C’est la question abyssale de la volonté de l’acteur. Les cinéastes sont des architectes. Antonioni, par exemple, disait qu’un acteur devait être très con ou très intelligent. Entre les deux, on devient un acteur bourgeois, qui fait un peu bien ci, un peu bien ça. Je pense que ce qu’il voulait dire, c’est qu’on est soit une bête, un animal – « fais-ci, fais-ça », mais en même temps, un animal n’est pas con – soit très intelligent, avec une pensée sur son métier, de la hauteur et de la précision, comme Google Earth. C’est là que je situerais l’intelligence. Je n’aime pas trop dire que je suis acteur. Je préfère annoncer d’autres métiers, comme danseur. Je me dis que de cette façon, on ne mise pas tout sur ma personnalité, mon petit truc – ou mon grand truc –, que je vais vers quelque chose appelé à se développer sur un plus long terme, pour le spectateur : aller vers un geste net, pur, aiguisé, ne pas resservir la même soupe. Je ne dis pas ça par masochisme, mais si je fais un film, je veux que le tournage soit une épreuve, qui m’enseigne quelque chose. Si je n’apprends pas, si je suis en pilote automatique, la salle le sera également. C’est la même chose pour tous les travailleurs du film, les techniciens. Sur un plateau, il faut convier tout le monde à son état de créateur. Il ne faut pas faire son boulot. Mais il est rare que cela arrive. Je n’y parviens pas à chaque fois et tout le monde ne le fait pas autour de moi.
Spectateur : J’ai été frappé par le fait qu’il se passe des choses partout dans les plans larges. Chacun forme un espace géographique à focalisations multiples. Le cœur n’est pas forcément le centre et l’intensité ne cesse de passer du fond au premier plan. Là encore, c’est très démocratique, car il n’y a pas de hiérarchie officielle.
M.W. : Pendant la discussion avec Léa Seydoux, je lui ai posé un peu exprès une question bête pour commencer : est-ce que tu te projettes dans le personnage quand tu regardes le film ? C’était après la projection de La Maison dans l’ombre, de Nicholas Ray, dans lequel Ida Lupino joue le rôle d’une aveugle. Sa réponse m’a surprise : elle ne se projette pas, ne s’invente pas dans un film tant que le rôle ne lui a pas été offert. Cela peut sembler un luxe, mais pas seulement. C’est une histoire de rencontre : l’acteur n’est pas à la merci d’un projet. Il se réfléchit au jour le jour en tant que personne sensible, et puis il croise la route d’un projet, d’un film, d’un réalisateur. Je croyais sans y avoir trop réfléchi, et surtout sans l’avoir éprouvé, que l’acteur arrivait au moment du tournage comme la cerise sur le gâteau : le scénario préexiste, la production et le financement se font en amont, et l’acteur arrive à la fin en sachant son texte pour le jouer. Je me rends compte que ça n’est pas vrai, heureusement. L’acteur s’inscrit dans un film de façon plus vaste. Il écrit aussi. Je le perçois dans la façon de travailler Nicolas, qui est un acteur libre. Tu rêves ton espace de jeu. Tu pars à sa recherche.
L’acteur écrit aussi. Il rêve son espace de jeu. Il part à sa recherche.
N.M. : C’est important de se demander : « Est-ce que j’aurais pu jouer ce rôle ? » Le désir de faire ce métier, la libido, restent chez moi intact. Pour cette raison, il m’est difficile de dire oui à un projet si je sens que je vais m’ennuyer. Si je m’ennuie dans mon métier, c’est la mort. Même si je l’ai choisi, c’est un métier de chien, difficile, d’autant plus que je fais beaucoup de théâtre, qui est un art sévère, austère. Ça n’a rien de facile de donner chaque soir comme on l’entend, donner autre chose, au-delà de ce qui est prévu. La pièce de Marivaux dont parlait Maud est écrite dans une langue totalement étrangère, comme le finnois, que j’ai d’ailleurs appris pour un film. Il faut accomplir un travail de plomb pour rendre la langue organique, immédiate. Voilà ce qui éveille en moi de la libido. Mais je ne suis jamais frustré, car j’aime les acteurs. Je n’aimerais pas être à la place d’un autre. Cette semaine je suis allé voir Isabelle Huppert jouer Phèdre au théâtre. La situation était étrange car j’étais au premier rang : trop proche. J’ai pensé que ça allait être un enfer. Je présumais que j’allais voir tous les détails, mais j’ai vu autre chose, ce qui ne m’était pas arrivé depuis longtemps au théâtre. J’ai vu la situation, le monde de la culture, l’Odéon, le spectacle qu’il faut avoir vu, et au milieu de tout cela, tellement susceptible d’empêcher la vie de se produire, je l’ai vue elle, travailler comme une amatrice. Elle s’est désembourgeoisée de la somme de ce qu’elle est, de son image, ce que je trouve très punk. C’était de fait assez asiatique, comme une dépossession. Elle a d’ailleurs eu un trou de mémoire phénoménal ce soir là, qui l’a obligée à aller chercher un papier – pour une première à l’Odéon, il faut le faire. Je me suis renseigné ensuite : ça n’était pas du tout prévu dans la mise en scène. Elle a fait un acte de peintre, en donnant ces couleurs là pendant 3h30. Je me suis dit : « Voilà, c’est ça, ce métier ». Elle était comme une chanteuse d’opéra. Elle ne disait pas : « Je sais chanter ça », mais elle chantait, avec des blancs, des fausses notes. C’était à la fois contrôlé et impoli, anti-bourgeois, dans ce lieu qui l’est de plus en plus, avec un public fait d’avocats et de médecins, ce qui n’est pas grave en soi, mais c’est une clientèle plutôt que des spectateurs. Or, les spectateurs peuvent changer un film ou une pièce. Il faut le dire aussi : il n’y a pas que les acteurs. Certains soirs au théâtre, je sens pendant que je joue que quelque chose n’est pas renvoyé. Il faut continuer. Cela ne veut pas dire que les gens n’apprécient pas, mais la salle ne porte pas toujours. Pour revenir à l’idée de projection, je ne crois pas en l’acteur unique, la voie royale. Ce qui compte, c’est la faculté d’un acteur à ne pas être seul. On ne travaille pas seul. Si je vois l’acteur de Poussières dans le vent filmé par un autre cinéaste, tout s’effondrera peut-être, comme en amour. Les choses se passent cette fois là, pendant ce rendez-vous là. C’est ce qui me donne à penser mon métier, et d’autres choses aussi d’ailleurs. C’est un beau métier, un métier-somme, qui se sert, qui puise. Je travaille en permanence. Maud aussi. Par exemple, j’ai passé du temps avec ma famille l’autre jour, et c’était formidable, tout ce qui ne se dit pas, les petites humiliations, le mensonge social. On peut en faire quelque chose. Ce sont ces éléments qui m’aident à écrire. Poussières dans le vent réunit tout ce que j’aime, la famille, mais aussi ce qui dépasse la fiction première. Il y a comme une écologie du regard, qui ne se la joue pas exotique. Certains cinémas font parfois montre de leur folklore, mais ici, l’écriture est précise. Ça me plaît.

Nicolas Maury dans Let my people go ! (Mikael Buch, 2011) / Shu Qi dans Three times (Hou Hsiao-hsien, 2004).
Spectateur : Je vais peut-être avoir l’air de faire de la provoc, mais en tant qu’apprenti acteur qui vous écoute dire depuis tout à l’heure que l’on peut finalement trouver la justesse dans le non-jeu ou dans l’amateurisme, sans puiser dans la technique, je me pose cette question : pourquoi alors se former au théâtre ?
N.M. : Je ne pense pas avoir parlé de non-jeu.
Quand on est dans la provocation – ce que je trouve génial –, on ne s’attend pas forcément à une réponse. Sur cette question de la formation, il me semble par exemple difficile de faire de la danse contemporaine sans avoir des bases classiques. Il faut avoir fait des pointes et musclé son corps. Un acteur doit être musclé et en santé. Après, il faut s’entendre : on peut aussi être l’acteur d’un seul film. Certaines personnes ont fait un film, par hasard, comme Martin La Salle, l’acteur de Pickpocket. Tout dépend ce que l’on veut écrire et de si l’on veut écrire en tant qu’acteur. Je ne dis pas ça pour ne pas répondre, mais parce qu’il y a des chemins particuliers. Vous faites une école ? Un conservatoire ? Pourquoi voulez-vous être acteur ?
Spectateur : Vous êtes dur.
N.M. : Vous aussi vous êtes dur. Je ne le sais pas plus que vous, mais j’ai signé mon premier contrat à 16 ans. Or, j’en ai 35 aujourd’hui. Je fais ce métier depuis bientôt vingt ans, donc je peux me permettre d’en parler. Il faut aller vers ce que l’on n’a pas. J’aimerais être sauvage, que ma jeunesse soit intacte dans mon art, mais ça n’est plus possible. En disant cela, je ne vous provoque pas vous, mais moi. C’est un mantra, dans tous les domaines : repasser par sa propre bêtise, comme disait l’autre. Mais si l’on est déjà bête, mieux vaut passer par de l’intelligence. Pour pouvoir parler aux autres, il faut se déplacer. Tous les philosophes le disent. Il faut passer par sa propre bêtise, et non par ses certitudes. Dans notre cas précis, il faut m’écouter et ne pas m’écouter, car je ne suis pas qu’acteur, je provoque aussi des projets. S’il faut une réponse claire, alors oui, je trouve important d’apprendre, tout le temps, que cela soit dans une école ou non. Certaines sont nulles, mais il y a des intervenants, et l’on n’apprendra pas forcément mieux dans une école géniale. C’est parfois par le creux que l’on désire, parce qu’on n’a pas obtenu une chose qu’on la veut. J’ai fait le conservatoire de Paris à vingt ans parce que je voulais travailler avec Dominique Valadié. J’ai eu le conservatoire, mais pendant mes trois ans, elle était en congés sabbatiques pour jouer ses pièces. C’était un désastre. Un prof dont je ne donnerai pas le nom m’a fait faire tout ce que je détestais pendant un an. C’était dur, mais avec le recul, je me dis que c’était le destin. Comme un enfant, je n’ai pas eu ce que je voulais. J’ai peut-être appris par le manque. Lorsque je vous demande pourquoi vous voulez être acteur, la question peut vous sembler violente, mais il faut sans doute y répondre de temps en temps, même si cela fait mal.
POUR POUVOIR PARLER AUX AUTRES, IL FAUT SE DÉPLACER. IL FAUT PASSER PAR SA PROPRE BÊTISE, ET NON PAR SES CERTITUDES.
E.B. : Tu saurais répondre ?
N.M. : Oui, mais il me faudrait quatre ou cinq heures.
E.B. : Et vous, vous avez des éléments de réponse ?
Spectateur : C’est peut-être le théâtre qui nous appelle. Pour reprendre l’idée de destin, on n’a pas vraiment le choix.
Spectatrice : Vous dites que vous n’êtes pas qu’acteur et que vous provoquez parfois les projets. Pouvez-vous nous en parler ?
N.M. : Les personnes avec qui je travaille veulent souvent retravailler avec moi. Quand je vois les autres acteurs, je me dis que c’est parce que je dépasse mon rôle dans mon rapport avec le metteur en scène – certains ne le supportent pas, ce que je comprends tout à fait car je ne supporterais pas un acteur comme moi. On parle ensemble du projet esthétique, d’une démarche globale, plus entière que mon rôle dans le film. On me demande mon avis sur d’autres rôles, d’autres gens, sur des cadres, comme je suis certain qu’on le demande à Maud, car son regard est avisé. Je considère qu’un acteur est avant tout quelqu’un qui propose. J’ai dit un jour à mon agent : « J’en ai marre. Maintenant, il y aura les contrats des films où je poserai des questions et ceux des films où je donnerai des réponses. » Je travaille avec des gens qui ne font que poser des questions, ce qui ne fait pas toujours avancer le travail, au théâtre en tout cas. Je me ferais payer plus cher sur les contrats-réponses ! Un acteur trouve souvent les réponses à des situations bloquées, à des questions de mise en scène.
Et puis, je veux filmer, je vais faire un film : c’est en cela que je vais initier un projet. J’ai aussi le dessein plus général, qu’évoquait Maud, d’écrire avec mon métier. Je me moque de produire une somme, mais je veux faire des choix. Il m’est toutefois plus difficile de refuser du théâtre que du cinéma, car c’est une maison ; pas une famille, mais une maison, je ne peux pas m’en passer (c’est aussi parce que je reçois plus de propositions au théâtre qu’au cinéma). C’est par mes choix que je provoque ma vie. Je privilégie une pièce qui peut être bancale si je lui trouve du sens. Le destin se provoque en disant non, mais surtout en disant oui.
Propos retranscrits et mis en forme par Pauline Soulat.

Les Rencontres d’après minuit (Yann Gonzalez, 2013).