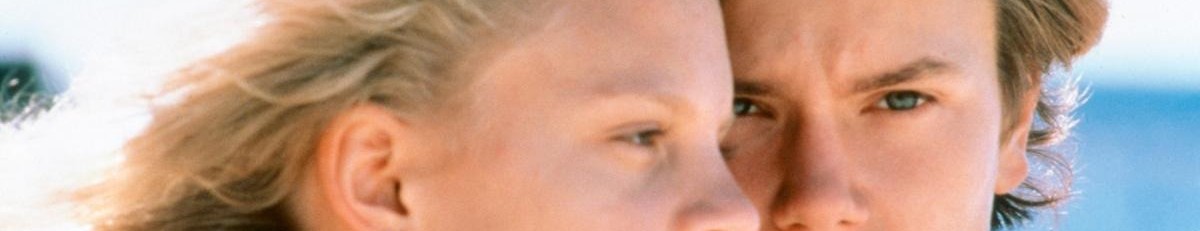La maison des Phillips
Comme on peut le percevoir dès le début de la scène, la maison du Professeur Philips est presque une image d’Épinal de ce « retour aux années 50 » prôné par le président Ronald Reagan, qui dès son premier mandat, se présentait comme le « nouveau bâtisseur du rêve américain ». Danny découvre en effet une habitation opulente, construite en bois blanc, avec la boîte aux lettres typique et le carré de pelouse bien tondue. Si bien qu’en arrivant chez son prof de musique, c’est comme si Danny venait d’effectuer un voyage dans le temps et qu’il se retrouvait dans une doublure des années 50, parfaitement conforme à l’idéologie reaganienne, laquelle œuvrait précisément à renvoyer la période de contestation étudiante anti-Guerre du Vietnam aux oubliettes de l’histoire. Car il s’agit désormais de vendre du rêve et du « chromo », en réaction aux revendications politiques et sociales de la jeunesse du milieu des années 60.
Le cinéma américain mainstream va largement diffuser cette imagerie d’une Amérique réactionnaire, marquée par un conservatisme et un conformisme omniprésents. Sidney Lumet observe ce changement de paradigme par le biais de la trajectoire humaine de son jeune personnage, adolescent des années 80 qui a baigné dans les idéaux révolutionnaires des années 60.



L’appel du Steinway
En arrivant au domicile des Phillips, Danny regarde par la fenêtre et voit immédiatement, trônant dans le salon, le piano Steinway, représentant ses aspirations profondes. À l’occasion de cette visite, le pauvre clavier d’étude muet qu’il transporte habituellement avec lui au cours de chaque déménagement familial, se métamorphose alors sous ses yeux en un piano de très haute qualité.
Le pianiste en herbe ne parvient pas totalement à se défaire de son statut de « marginal » par rapport à son époque et au nouveau milieu qu’il s’apprête à fréquenter. « L’appel du Steinway » est bien plus fort que le rôle du « jeune américain bien sous tous rapports » qu’il doit tenir. Alors que personne ne lui répond lorsqu’il demande « s’il y a quelqu’un », il se comporte comme un cambrioleur et pénètre chez les Phillips sans qu’on l’y invite formellement.
Danny s’installe donc au piano et commence à jouer. La caméra souligne ce moment privilégié par un travelling avant qui part du couloir et se rapproche du jeune instrumentiste, pour ensuite prendre de la hauteur en un mouvement ascendant, exprimant dès lors toute l’importance et toute l’intensité de ce moment vécu par l’adolescent, qui peut enfin entendre la mélodie produite par le déplacement de ses doigts sur un clavier digne de ce nom. Car jusqu’ici, Danny était cantonné au rude effort de l’apprentissage sans jamais pouvoir évaluer concrètement le résultat de son travail assidu.


La musique de Lorna
La suite de la scène décline une nouvelle fois la dialectique « musique classique / musique pop rock », amorcée par le Professeur Philips lors de sa démonstration en classe au lycée. À l’étage, Lorna écoute au casque un disque de reggae, Trouble In Africa (1985) de l’artiste Papa Levi, un chanteur anglais d’origine jamaïcaine, par ailleurs très militant et engagé. Dans la chambre de la jeune fille, on voit également un poster de Bob Marley, un élément de décoration représentant une guitare électrique et plusieurs disques de pop rock. Lorna est par ailleurs vêtue d’une tunique longue avec des motifs brodés qui connotent les années 60 (donc la génération hippie des parents de Danny). On en déduit que c’est là sa manière à elle de s’affirmer face au conformisme de sa famille. Son père est certes un prof sympathique et apprécié, convoquant Madonna à des fins pédagogiques, mais qui porte tout de même nœud papillon et veste de costume à carreaux en tweed, comme dans les années 50. Lorna et Danny sont donc deux personnages symétriquement inversés et parfaitement complémentaires.



Rencontre autour du piano
Alertée par le son du Steinway, Lorna enlève son casque et descend au rez-de-chaussée. Plutôt que d’interrompre Danny, elle attend qu’il termine son morceau : ce renversement d’attentes — c’est lui qui lui demande d’abord qui elle est — installe immédiatement une relation sur un terrain d’ouverture et de curiosité réciproques.
En discutant, les deux adolescents se déplacent autour du piano, comme si l’instrument organisait leur rencontre. Pour Danny, le Steinway représente un horizon de liberté et d’accomplissement ; pour Lorna, il renvoie au milieu social qu’elle cherche à tenir à distance, rappelant que son frère virtuose incarne “ceux qui font tout comme il faut”. Ainsi, le piano matérialise à la fois ce qui les différencie et ce qui peut les rapprocher.
La mise en scène traduit subtilement l’évolution de leur échange : en tournant autour du piano, Danny et Lorna se croisent, se répondent, s’apprivoisent. Le fait qu’ils échangent finalement leurs positions dans l’espace — elle près du piano, lui dans l’embrasure de la porte — suggère un déplacement symbolique de leurs points de vue. Chacun accepte d’entrer un peu dans le monde de l’autre.
Loin de répéter les oppositions idéologiques qui traversent la famille Pope (culture bourgeoise vs. culture contestataire), cette rencontre montre qu’une autre voie est possible : celle du dialogue, de la circulation des influences et du partage. Ce rapprochement esquisse ce que Danny cherche tout au long du film : la possibilité de se construire une identité personnelle conforme à ses aspirations, sans renier les choix de ses parents.