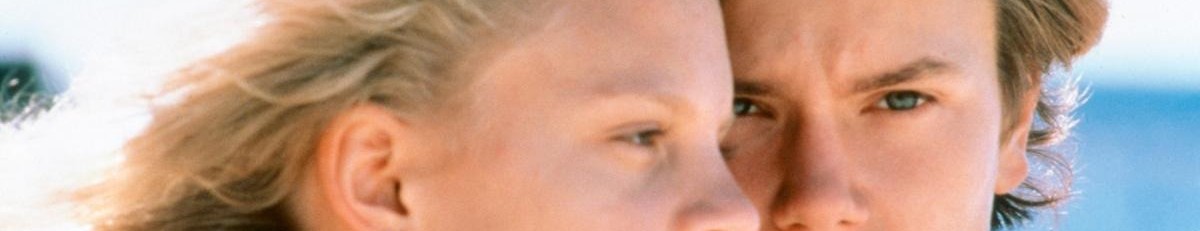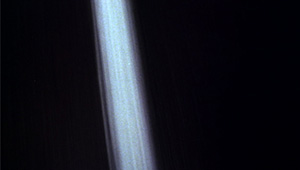

Tracer sa route
L’ouverture d’À bout de course (Running On Empty, 1988) se compose de 34 plans répartis sur moins de 6 minutes, précédés d’un court générique s’inscrivant sur des images nocturnes de route, liées en fondus enchaînés. Ces images, filmées en travelling depuis l’arrière d’un véhicule, en plongée sur les lignes discontinues qui défilent en s’éloignant, se perdent dans le noir de l’asphalte et renvoient bien sûr au titre du film, littéralement « rouler à vide ». Elles peuvent aussi se comprendre, métaphoriquement, comme des vues subjectives sur le passé des quatre membres de la famille Pope, dont la vie marginale d’anciens militants gauchistes fuyant les autorités doit se redessiner sans cesse, laissant des traces éphémères et éparses qui s’effacent au gré des fuites, et que le spectateur découvre, au moins pour l’un d’entre eux, « à bout de force ».
Si les premières minutes du film n’expliquent rien de l’histoire véritable des Pope, ni n’offrent encore de pistes quant aux raisons de ce départ précipité, elles s’emploient surtout à mettre en place les grands principes formels qui vont ensuite gouverner toute la mise en scène de Sidney Lumet.



« Ce n’est qu’un jeu »
Le film s’ouvre sur Danny Pope (River Phoenix) saisi en plan rapproché, d’emblée désigné comme personnage principal et catalyseur des principaux enjeux à venir. Au cours d’une partie de baseball en plein air, Danny est immédiatement isolé des autres par le cadre et la situation. Ses premiers gestes le montrent gauche, mal à l’aise. Devant les grillages du terrain, le jeune homme n’est visiblement pas à sa place, ni dans l’équipe, dont il est un des seuls à ne pas porter la tenue, ni dans cette activité, ce que confirme le plan de demi-ensemble suivant, un contrechamp filmé depuis l’extérieur du stade, qui place le personnage comme « en détention provisoire » : en effet, autour de Danny, tout n’est que grilles et clôtures, auxquelles s’ajoute la présence à l’arrière-plan d’un grand réservoir d’eau, qui, tel un mirador, domine l’ensemble comme pour surveiller les faits et gestes des joueurs.
À priori anodins, les dialogues entrent en résonance avec ce que nous apprendrons par la suite de la vie de l’adolescent: « Allez ! Ce n’est qu’un jeu ». En effet, malgré la liberté apparente et sans que le spectateur ne le comprenne encore, un jeu subtil d’emprisonnement se met en place. Si Danny est enserré par le décor et ses mensonges (on l’appelle « McNally »), cadrages et montage travaillent aussi à un enfermement qui s’amplifie rapidement. Même dans les plans larges de cette première minute, Danny est systématiquement cerné, par des éléments du décor ou par d’autres personnages ; et s’il parvient à s’extraire de cet espace quadrillé par la porte de sortie, c’est pour se retrouver, à pied ou en vélo, à nouveau encerclé ou entouré.
Subtilement, la fiction met en abyme jusqu’à l’art de la comédie : l’adolescence et ses jeux d’apparences s’incarnent en River Phoenix, acteur jouant un jeune homme qui joue à en être un autre.



Repérages
Après une ellipse temporelle marquée par un simple « cut », la deuxième scène retrouve Danny roulant sur sa bicyclette. Bien que le personnage soit désormais montré seul dans un vaste décor ouvert, le découpage prend toutefois le relais pour réinscrire le motif de l’enfermement: c’est à cet instant précis que l’adolescent repère effectivement qu’il est repéré. Il fait alors semblant de vérifier son vélo, « jouant » donc de nouveau pour, en réalité, contrôler le coin de la rue, duquel apparaît en contrechamp la voiture qui a précédemment fait demi-tour pour venir se positionner en planque. Revenant un instant sur Danny, qui se tourne pour observer l’autre côté, le montage passe au coin de rue opposé, confirmant qu’une seconde voiture se poste pour surveiller le bout de route balisé. Physiquement comme symboliquement (par le montage), Danny est à nouveau cerné, pris cette fois dans un cul-de-sac dont il ne peut sortir qu’en rebroussant chemin. Son échappée s’accomplit par l’intermédiaire de deux plans qui s’enchaînent en raccord mouvement, reflets inversés de ceux qui l’ont amené là : d’un plan rapproché dans lequel Danny se relève, la caméra accompagne ensuite le personnage reprenant la route en un panoramique droite/gauche. Les deux voitures, comme le découpage, forcent ainsi le personnage à faire demi-tour, dans une dynamique opposée à celle qui le ramenait chez lui.
Si Danny semble déjouer ses poursuivants, il n’en est pas moins déjà piégé, dans la mesure où la nature même du montage permet au spectateur de sentir ce qui se trame avant de le comprendre tout à fait. La distribution croisée des plans implique effectivement que cette scène s’achève comme elle a commencé, par un cadre identique obligeant le personnage à inverser sa trajectoire.




Disparaître dans la nature
Dès qu’il est hors de vue du danger, le jeune homme passe ensuite rapidement devant un véhicule abandonné au coffre ouvert, fantôme symbolique prêt à accueillir les bagages d’un voyage récurrent désormais arrivé à essoufflement. Puis il abandonne lui- même son véhicule (le vélo), pour s’enfoncer dans la végétation et, au propre comme au figuré, « disparaître dans la nature ».
Le plan suivant reprend Danny dans sa course, par instants masqué par les hautes herbes. Bien que les causes de cette fuite soient pour le moment encore inconnues du spectateur, la tension dramatique s’amplifie, génère de l’étrangeté, du « jeu » (au sens mécanique du terme), tout en provoquant l’adhésion. Cette quatrième scène reprend le principe de la deuxième et décline l’idée du cheminement contrarié, de l’obligation de faire demi-tour. Les plans montrant Danny en train d’organiser le sauvetage de son frère Harry sont en effet encadrés par quatre prises de vue rigoureusement inversées et fonctionnant par paires : le premier plan montre l’arrivée de Danny jusqu’à la maison en panoramique droite/gauche, tandis que le suivant se focalise sur lui, accroupi dans l’herbe en plan rapproché pour appeler le chien Jomo, qui va servir de messager ; les deux plans de fin de séquence reprennent les mêmes valeurs de cadres, mais en reflet contraire des deux premiers, d’abord par un retour sur Danny en plan rapproché attendant la sortie de son frère, puis par un retour au plan d’ensemble de départ qui, cette fois, abandonne la maison à la faveur d’un panoramique gauche/droite accompagnant les fugitifs. Entre deux, le système de plans enchâssés est partiellement repris, lui aussi. Le chien, répondant à l’appel de Danny, vient vers lui : un raccord mouvement enclenche le contrechamp dans lequel, pour faire venir son frère, l’adolescent retire sa chaussure – signal de détresse qui semble sous-entendre que le jeune homme « marcherait moins bien » sans sa famille, ou du moins sans Harry. Deux vues de la maison « sans vie » créent un effet de suspension du temps, que le spectateur vit avec d’autant plus d’empathie que le jeu de River Phoenix, en quelques secondes, déploie toute sa richesse. Très vite, Danny passe en effet par trois phases signifiantes en joignant ses deux mains : il forme d’abord un double index accusateur (peut-être un canon pointé vers la maison), il croise ensuite les doigts des deux mains pour, enfin, les joindre, plaquées l’une contre l’autre, à la manière d’un signe de prière que le montage n’exauce, pour faire durer l’attente, qu’après un dernier plan sur la maison.
Réuni, le noyau fraternel de la famille peut enfin « se sauver », en opérant une nouvelle fois un demi-tour pour sortir d’une impasse et disparaître dans la végétation. Les enfants quittent les lieux avec le strict minimum : Harry emmène le chien (qui sera ensuite abandonné pour des raisons pragmatiques) et Danny le clavier muet sur lequel il s’exerce au piano.



Réunion de famille : le tourbillon de la vie
Une fois rassemblée au complet, la famille Pope organise son « évasion » en un véritable tourbillon de passages de frontières, comme autant de mouvements désespérés destinés à s’extraire des effets de cloisonnements qui ont jusqu’alors proliféré.
Si le premier plan de la scène paraît bien calme en regard de l’agitation des enfants, les signes de la tension se devinent tout autant qu’ils se perçoivent. Ainsi, un discret travelling ascendant opère un recadrage pour orienter la caméra en légère plongée ; un mouvement d’appareil a priori insignifiant mais non dénué de conséquence, puisqu’il fait disparaître le drapeau américain qui flottait jusqu’alors dans le coin supérieur droit du cadre… Ensuite, lorsqu’Arthur Pope rejoint son épouse, il est suivi en un panoramique droite/gauche qui a pour effet de mettre en évidence, pointé sur lui, l’index de la femme avec laquelle il s’entretenait – doigt involontairement accusateur, mais en tout cas geste de désignation souligné par la mise en scène.
Dans la scène suivante, les parents rejoignent leurs deux garçons, postés de l’autre côté de la route, obéissant à un mode opératoire que l’on devine bien rôdé. De part et d’autre de la voie ferrée s’opposent alors en cet instant deux vies, deux temps, l’avant et l’après, que la mise en scène concrétise par le point de vue et le montage : les parents sont encore les « McNally » tandis que les enfants sont déjà prêts à passer dans le camp des « Manfield » (leur futur nom d’emprunt). La camionnette des parents franchit donc les rails, au niveau de trois panneaux « stop » pour le moins annonciateurs (au regard de la problématique personnelle du plus âgé des deux fils), effectuant un demi-tour complet pour rejoindre Harry et Danny.
Sans en abandonner totalement la forme, ce segment fait exploser le principe d’enclavement d’images entre des plans identiques mais inversés : il faut en effet désormais que la fuite soit possible, que soient rompus les liens qui enferment, même si ces changements ne mènent guère à mieux, car provoqués dans un affolement qui, s’il est pas visible dans les comportements, n’en est pas moins exprimé par la mise en scène.


Révolution vaine, saine résolution
La séquence d’exposition d’À bout de course se clôt sur un effet de transition particulièrement significatif, dans la mesure où il procure une forme visuelle aux principaux enjeux du film. Après s’être littéralement dissoute dans le paysage par le truchement d’un fondu enchaîné, la camionnette des Pope réapparaît ensuite par la gauche de la profondeur de champ, puis braque pour se positionner face à la caméra, de manière à venir se placer dans la droite du cadre, décrivant ainsi une trajectoire en arc de cercle qui semble, par le jeu de l’enchaînement des plans, obliger le véhicule à effectuer un tour complet sur lui-même, en une « révolution » dérisoire qui le fait revenir à son point de départ et, dès lors, tourner en rond.
Sortir du cercle (familial), briser le cycle infernal de la fuite constamment recommencée pour enfin se poser et se construire soi-même: telle n’est autre que la problématique personnelle du jeune Danny, que l’issue de ce prologue synthétise donc admirablement, par les seuls moyens de l’image.
À la toute fin du film, lorsque le père accepte le souhait d’émancipation de l’adolescent, il ne répond d’ailleurs pas autrement : au volant de sa camionnette, Arthur Pope décrit une dernière trajectoire circulaire autour de son fils, avant de le laisser libre de tracer sa route.