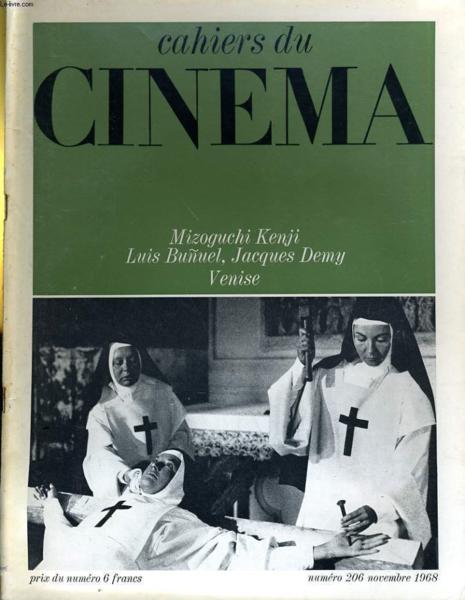Cet article fait partie d’un cycle
Les 6 et 7 février, le Café des Images aura l’immense plaisir de présenter trois films de l’auteur, dramaturge, acteur, metteur en scène et cinéaste italien Carmelo Bene dans le cadre du festival Écritures partagées, organisé par l’équipe de la Comédie de Caen.
Le premier des cinq films de Bene, Notre-Dame-des-Turcs (1968), ouvrira le week-end samedi soir, accompagné par un « Portrait Bene » proposé par Marcial Di Fonzo Bo et ses acteurs. Jean Narboni présentera l’œuvre de Bene puis discuter avec le public du Café à l’issue de la projection.
Au moment de la présentation du film en première mondiale à la Mostra de Venise en 1968, Jean Narboni, alors rédacteur aux Cahiers du Cinéma, avait rencontré Carmelo Bene pour un entretien, le premier réalisé en France, que nous vous proposons de redécouvrir ici.
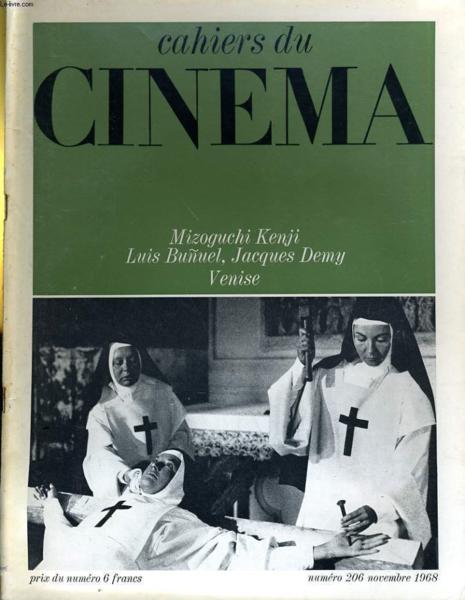
Carmelo Bene : Pourquoi toutes ces bandes de magnétophone ? Nous allons être brefs…
Les Cahiers du Cinéma : Brefs, oui, mais pendant longtemps.
Bene : En général, je déteste les journalistes, vous savez…
Cahiers : Mais nous n’en sommes pas.
Bene : À ma conférence de presse, j’ai demandé que tous les journalistes et critiques italiens sortent, ou bien je m’en allais moi-même.
Cahiers : Que s’est-il passé ?
Bene : Quelques injures ont été lancées, et je suis sorti.
Cahiers : Pourquoi être ici, alors?
Bene : Parce que vous n’êtes pas italien.
Cahiers : Pendant votre film, vous étiez surtout devant ou derrière la caméra ?
Bene : Les deux à la fois. Je suis dans presque tous les plans, mais si je ne jouais pas, je crois que j’aurais été autant devant la caméra pendant le tournage. Pour moi, tourner un film — qu’on y joue ou non — c’est être autant de chaque côté.
Cahiers : Votre personnage, pour être incarné, réclame (parlons par euphémisme) « un certain état de délire «. En même temps, les cadres, la progression, sont calmes, rigoureux, précis, réfléchis…
Bene : Tout était concerté, surtout le délire. Du moins l’intention du délire. Le délire, lui. mais après, était un vrai délire. D’abord je pense à vivre, après je vis, la même chose continue. J’improvise à partir de ce qui est très très élaboré.
Cahiers : Souvent, les films donnent l ’impression d’une confusion complète entre le désordre que le metteur en scène veut filmer et la façon dont il le filme. Pas ici.
Bene : Parce que mon délire même, en délirant et au moment où je le fais, je le conteste. J’essaie de ne pas m’y complaire. C’est la seule liberté complète. Sinon, c’est du délire.
Cahiers : Toutes les obsessions, tous les mythes italiens sont présents et retournés dana votre film : la Vierge, le bel canto, etc.
Bene : L’Italie est ce qui m’ intéresse le moins dans le film, et dans la vie. Les mythes italiens ne me concernent pas. C’est pour Pasolini, la Vierge et les Évangiles.
Cahiers : II n’empêche que ces mythes y sont, et que le film ne sera pas reçu de la même façon en Italie et ailleurs.
Bene : Culturellement, je ne suis pas Italien, mais Arabe.
Cahiers : Mais l’Italie du Sud est Arabe…
Bene : Dans cette mesure alors oui, je suis Italien. Culturellement, je me sens plus proche de Borges, ou de Huysmans, que de tous les écrivains d’ ici. Il faut tenter de se défaire de son propre conditionnement culturel. Les Italiens parlent tous de l’Orient, de la Chine, mais ne réfléchissent pas sur eux-mêmes.
Cahiers : Vous aimeriez travailler ailleurs ?
Bene : Non. Au fond, c’est vrai, il y a des choses dans « Nostra Signora dei Turchi » qui pourraient être vues comme spécifiquement italiennes. La grande référence en Italie, c’est le mélo, pas la littérature comme en France. La tradition italienne, c’est la musique. Vous avez une langue, nous pas. Les Italiens méprisent le mélo, et pourtant c’est leur seule tradition, ils vivent dans la mauvaise conscience intellectuelle, cultùrelle… Ils chantent et ne pensent pas.
Cahiers : Quel moment du film a été le plus important pour vous ?
Bene : Le tournage, sans aucun doute. J’ai dû voir le film pour le monter, mais c’est un travail très modeste, qui ne m’ intéresse pas. En tournant, je me conteste moi-même, je conteste mes projets, leur réalisation et en faisant cela je conteste tout, je conteste le monde entier.
En tournant, je me conteste moi-même, je conteste mes projets, leur réalisation et en faisant cela je conteste le monde entier.
Cahiers : Pourquoi avoir fait un film de votre livre, vous qui faites du théâtre ?
Bene : J’avais beaucoup réfléchi au cinéma comme moyen « spécifique », et j ’ai eu envie de tourner cela. Ce qui m’importe, c’est les gens qui ont d’abord une idée du cinéma. L’idée de cinéma contient sans doute un cinéma d’idées, mais le contraire n’est pas vrai. « Pierrot le fou » est un film génial pour cela, et – Week-end – raté pour cela aussi. Mais aujourd’hui, on aime et on pratique le cinéma – d’idées », où les petites idées se plaquent sur de la pellicule, sans nécessité. Vous verrez qui aura le Lion d’Or[1].
Cahiers : Et Lewis ? On y pense en voyant le film, et en vous voyant jouer.
Bene : Je n’ai pas vu ses films, il ne m’intéresse pas.
Cahiers : Vraiment ?
Bene : Vraiment.
Cahiers : Nous n’en croyons rien. Tout à l’heure, vous disiez : se contester, c’est contester le monde. Il faut donc s’engager franchement dans la subjectivité, et la traverser, pas l’éviter a priori et arbitrairement ?
Bene : Tout à fait. Mais Valéry a dit là-dessus des choses tout à fait justes. Nous les avons lues.
Cahiers : Si on s’arrête en chemin, il y a un risque : le narcissisme. Pour éviter le narcissisme, il faut pousser le moi jusqu’au bout.
Bene : Juste. Si tout le monde entre dans le film, alors c’est le narcissisme complet. C’est le respect complet du monde. Je n’ai pas une modestie d’enfant terrible. Si le monde entier entre en moi, alors je suis un grand Narcisse et je prends en considération le monde entier. Je ne méprise alors pas les autres. Je les estime comme « frères ». Les chrétiens n’ont rien compris.

Notre-Dame-des-Turcs (Carmelo Bene, 1968).
Cahiers : Est-ce que ce que vous faites au théâtre a un rapport avec Bussotti ?
Bene : Nous sommes tous les deux des « martyrs », Bussotti est un musicien qui ne pense qu’à faire du théâtre, et moi un homme de théâtre qui rêve d’être musicien. Je suis un musicien et lui un homme de théâtre, mais moi je connais la musique et lui ne connaît pas le théâtre. C’est Debussy et d’Annunzio.
Cahiers : Mais vous pensez aller dans le même sens ?
Bene : Nous avons des affinités dans notre attitude vis-à-vis de la culture… Je suis musicien, mais je n’écrirai jamais de musique. Le monde me parle comme à un musicien, pas comme à un cinéaste.
Cahiers : Vous avez vu le film de Straub sur Bach ?
Bene : Non, et je le regrette. Ce qui m’ennuie aujourd’hui, c’est que tous les musiciens s’efforcent d’expliquer la musique au lieu d’en faire.
LE MONDE ME PARLE COMME À UN MUSICIEN, PAS COMME À UN CINÉASTE.
Cahiers : Il faut bien que quelqu’un en parle, les critiques en sont incapables. En un peu moins grave, c’est la même chose pour tout.
Bene : Oui. Le film de Kluge est épouvantable pour ça. Il n’aime pas le cinéma, il a ses petites idées toutes faites sur le monde, pas sans intérêt d’ailleurs — et il plaque tout cela sur un semblant de film. En plus, il n’aime pas le cirque.
Cahiers : Votre film, vous avez voulu qu’il ne parle pas du tout du cinéma ?
Bene : Qu’il parle de lui, oui, pas sur lui. Le cadre est une chose biologique, naturelle. Il reçoit ce qu’il y a dans le plan. Il essaie de ne pas l’étouffer, ni de l’assécher.
Cahiers : Depuis pas mal de temps, ici même et avec vigueur, on entend crier à la mort de l’art ? Quel est votre avis ?
Bene : Nous ne sommes pas obligés par le gouvernement à faire de l’art, l’inutilité de l’art garantit l’existence de l’art. Quand on se met à décider de lui, c’est fini. J’ai lu une fois dans les Cahiers : « l’art n’a plus qu’à disparaître si son inutilité même n’est plus comprise ». Je suis d’accord. Les étudiants révolutionnaires sont devenus dogmatiques, ils ont pris la place des professeurs. Rudi Dutschke l’a bien compris, Lefebvre aussi.
Cahiers : Et le cinéma, quel rôle a-t-il à jouer là dedans, s’il en a un ?
Bene : II est inutile aussi, et c’est sa force, grâce à ça et en le sachant, il peut presque devenir utile. La première chose à faire c’est de constamment déranger les gens, c’est pour le moment sa seule utilité. Déranger avec assez de force pour qu’on ne vous récupère pas tôt ou tard, et qu’on ne paye pas pour «être dérangé». Qu’on ne se mette pas à vous déguster.
Cahiers : Dans votre film la nourriture est assez peu ragoûtante. Un peu la « brouchtoucaille » de Queneau…
Bene : Oui, mais il ne faut pas être trop dégoûté et oublier ce que dit l’acteur au même moment. Dans la scène de l’omelette, le test entre le bon et le mauvais spectateur, c’est que le deuxième détourne les yeux et n’entend rien, tandis que l’autre écoute aussi. Je dis à ce moment : « Quand on n’a pas de servante à se mettre sous la main, on a des petits garçons à la cuisine, et s’il n’y a pas de petits garçons, il reste toujours le four… »
Cahiers : C’est dégoûtant dans le plan, mais pas complaisant.
Bene : Oui, parce que ce n’est pas le dégoût qui doit primer, mais le goût du dégoût. En même temps, il y a toute l’histoire du paradoxe du comédien…
Cahiers : Dans cette scène, il y a un petit côté eisensteinien…
Bene : Bien sûr, c’est « Ivan le Terrible ». Dans une scène aussi drôle et avec un cadre aussi ridicule, il ne fallait surtout pas faire d’allusion aux scènes sublimes en couleur d’ « Ivan ». Et c’est pour cela que je l’ai fait.
Cahiers : Quand vous vous maquillez devant le miroir, on pense aussi à Welles…
Bene : On y entend la musique du « Troisième homme ». L’idée, c’est que la scène se trouve juste après celle du double. Ici, c’est le titre de la musique qui importe, pas la musique. Si on l’écoute et qu’on oublie le titre, c’est fichu.
Cahiers : Le côté Welles vient aussi du maquillage.
Bene : Alors là, c’est un pur hasard. Une référence culturelle inconsciente, mais pas moins importante, si vous l’avez vue.
Cahiers : Quels sont les cinéastes que vous aimez ?
Bene : Eisenstein, et Godard, le seul homme de cinéma actuel, sauf dans « Week-end ». et pour ce que je vous ai dit. J’adore « Les Carabiniers », très proche de Jarry, qui est un de mes auteurs favoris.
Cahiers : Avez-vous monté du Jarry au théâtre ?
Bene : Oui, « Ubu Roi ».
Cahiers : Dans Jarry, il y a des références constantes à la moulinette. Votre film ressemble un peu à ce que doit être le résultat d’un passage à la moulinette. Vous acceptez cette référence ?
Bene : Tout à fait.
Cahiers : Au Festival, vous avez vu des films qui vous ont plu ?
Bene : Non. Je hais le Kluge. J’avais envie de voir, je vous l’ai dit, le film sur Bach, et je crois que j ’aurais aimé le « Socrate » de Lapoujade.
Cahiers : Votre film va sortir en Italie ?
Bene : J’espère que non.

Propos recueillis par Jean Narboni, initialement parus en novembre 1968 dans les Cahiers du Cinéma n°206.
[1]La chose s’est vérifiée. Le Lion d’or fut décerné au film d’Alexander Kluge, Les Artistes sous les chapiteaux : perplexes. (N.D.L.R.)