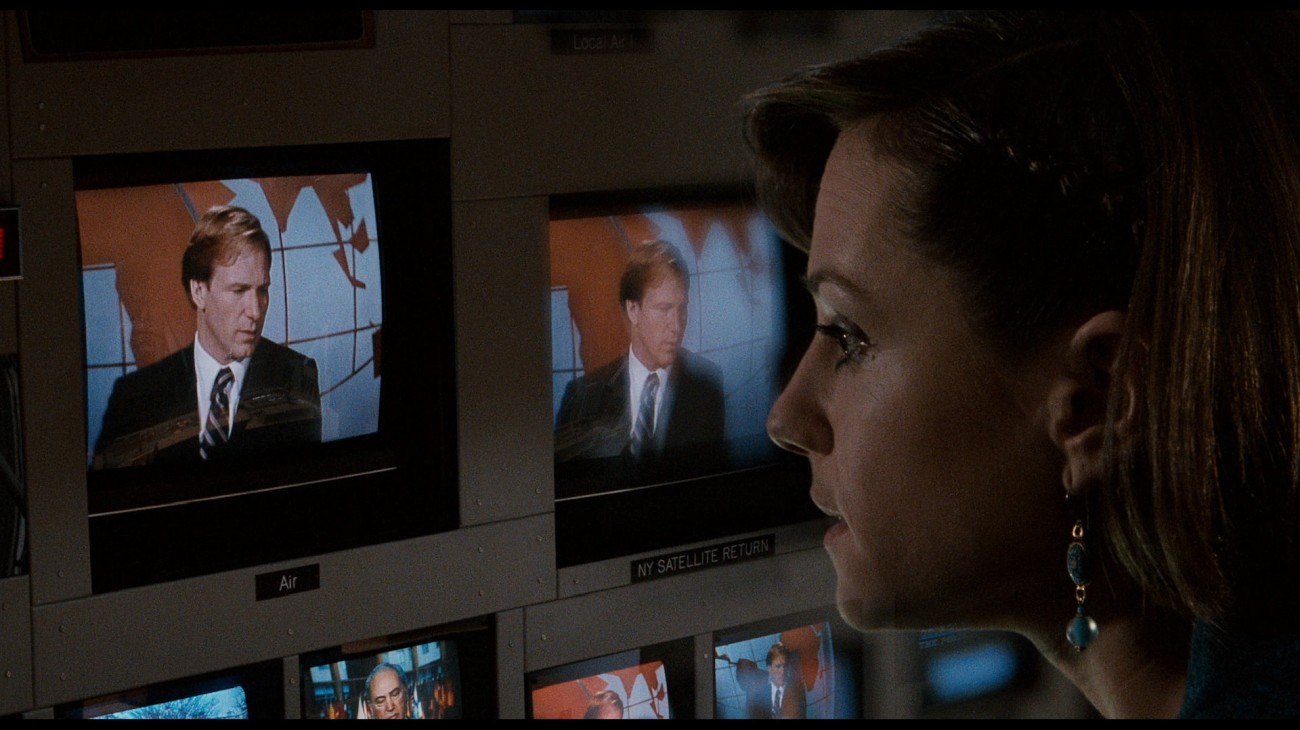Entretien avec Jean-François Rauger
– par Emmanuel Burdeau
L'Orribile segreto del Dr. Hichcock (Riccardo Freda, 1962).
Voir les 3 photos
Comment les films sont-ils montrés ? Comment Internet modifie-t-il ce qu’être cinéphile veut dire ? Tout le cinéma est-il réellement accessible désormais, comme on a tendance à le croire ? À quoi servent les cinémathèques ? À quoi bon encore le grand écran et l’obscurité ?
Ces questions concernent au plus haut point le Café, à la fois salle et site, cinéma et revue, lieu matériel et, désormais, immatériel. Pour les évoquer, nous avons longuement rencontré Jean-François Rauger, directeur de la programmation à la Cinémathèque française et critique de cinéma.
Sur ces mêmes thèmes, d’autres entretiens suivront bientôt.
Emmanuel Burdeau : En 2012 vous avez publié chez Yellow Now, dans une collection dirigée par Dominique Païni, un recueil de vos textes intitulés L’Œil qui jouit. Ce sont des articles qui ont été publiés dans les Cahiers du cinéma, dans le Monde, dans les programmes de la Cinémathèque… On y retrouve vos passions de toujours, Claude Chabrol, Jean Renoir, Alain Delon, les années 1970, des auteurs consacrés (Vidor, Cukor…), des maîtres du cinéma bis (Bava, Freda, Fisher, Franco, Fulci…).
Le livre s’ouvre par deux essais consacrés aux missions d’une cinémathèque et à leur évolution. Le deuxième, intitulé « Les rendez-vous manqués, ou La cinémathèque n’est pas un dîner de gala », a des accents de pamphlet. Il se lit comme un diagnostic sévère — et pénétrant — quant à l’orientation récente de la Cinémathèque française vers une logique davantage dédiée à l’« événement culturel », voire à l’« ornementation » et à l’« occupation ludique » — ce sont vos mots — qu’à l’Histoire du cinéma et aux devoirs d’une institution décrite par vous comme « instance de cotation symbolique unique ». L’origine de ce texte polémique n’est pas précisée dans le volume. D’où vient-il ?
Jean-François Rauger : J’ai écrit ce texte à un moment où j’étais en colère et un peu excité. Je n’en avais pas parlé au Directeur de la Cinémathèque d’alors. Je l’avais montré à Dominique Païni qui m’a dit : « C’est vachement bien, il faut que tu le publies ». Comme je n’ai pas voulu le publier tel quel, je l’ai réécrit, mais c’est le seul texte inédit du recueil.
On ne peut pourtant pas dire qu’il s’agisse d’un texte pro-païnien : la logique que vous remettez en cause n’est pas la sienne — on pense plutôt aux années Serge Toubiana — mais la critique le concerne aussi, en quelque manière.
JFR : Païni est comme ça. Même s’il savait que je l’attaquais un peu, il estimait le texte.
La publication du texte dans L’Œil qui jouit a-t-elle suscité des réactions ?
JFR : Les gens m’en parlent, surtout les plus cinéphiles, qui comprennent ce qu’il y a derrière. C’est un texte exagérément puriste. J’aurais dû prendre davantage en compte le fait qu’il faut parfois composer avec la réalité économique et politique. Mais cela n’empêche pas que ce texte plaise à ceux qui font passer le cinéma avant le reste.
Le texte est daté de septembre 2010. Il peut être intéressant de revenir, cinq ans et demi plus tard, sur certains points que vous y développez. Vous dites notamment que le patrimoine du cinéma n’a jamais été aussi accessible. Y a-t-il toutefois aujourd’hui encore de grandes œuvres facilement disponibles en DVD et en ligne, qui ne peuvent faire l’objet d’une rétrospective en salle, faute de copies projetables ?
JFR : C’est une question-clé. Certains fims de Claude Chabrol, à qui nous voulons consacrer un hommage, n’existent plus sous la forme de matériel projetable. Il ne s’agit hélas pas d’un cas unique. Le problème est général. Avec le numérique, la pellicule vieillit, s’abîme. Les ayants droit n’ont aucun intérêt à dépenser de l’argent pour fabriquer un support permettant à un film d’être projeté en salle. Quelles salles peuvent encore passer de tels films, à part les cinémathèques et les salles d’art et d’essai indépendantes ? On restaure les classiques, mais il n’y a pas de travail de fond sur les filmographies, car cela coûte cher. Les ayants droit ont tendance à avoir des fantasmes qui s’inscrivent dans une logique purement capitaliste : « Si les pouvoirs publics considèrent comme une mission de service public de projeter des films dans les cinémathèques, ils n’ont qu’à payer », pensent-ils. Un grand emprunt a d’ailleurs a été mis en place il y a quelques années, pour la rénovation. Les ayants droit devaient rembourser. C’était un emprunt, pas une aide à la numérisation des archives. Le problème est donc le suivant : qui va payer pour avoir du matériel susceptible d’être projeté en salle ? On peut toujours projeter du BETA ou du DVD, mais ça n’est pas fait pour cela. C’est moche.
Il est vrai qu’il y a aujourd’hui le sentiment que les films ne sont pas perdus puisqu’on peut les voir sur DVD. Un film d’Hitchcock est fait pour être vu à plusieurs dans une grande salle noire. On peut toujours décrypter les films sur un petit écran d’ordinateur ou de télévision, c’est formidable, mais il manque le dispositif. C’est d’ailleurs ce qui restera des cinémathèques, entre autres : le « dispositif spectatoriel », la salle, le monde, la vision collective. La dimension sociale est inhérente au cinéma, mais il semble que cela ne constitue pas une raison suffisante pour pousser un ayant droit à investir.
Le numérique a été le cheval de Troie qui a permis la concentration de la production, de la distribution et de l’exploitation.
Pensez-vous que les ayants droit font un mauvais calcul ? Ont-ils raison financièrement ? Sous-estiment-ils les revenus possibles d’une numérisation et d’une rétrospective susceptible de partir en tournée ?
JFR : Je crains qu’ils aient économiquement raison. Une telle démarche peut être rentable, mais sur le long terme. Les ayants droit doivent se dire : « On n’a pas le temps d’attendre. Ça ne vaut pas le coût. Le résultat est trop aléatoire. » C’est une logique économique. Le numérique a été le cheval de Troie qui a permis la concentration de la production, de la distribution et de l’exploitation. C’est la loi de l’économie qui impose le numérique. Même si nombreux sont ceux qui regrettent le temps de la pellicule car ils n’aiment pas le numérique, ils ont tort d’un point de vue économique. Cette loi nous est imposée.
Vous arrive t-il de projeter une BETA ou un DVD, dans certains cas extrêmes ?
JFR : Quand je n’ai rien d’autre. Je préviens alors les spectateurs : « Vous allez voir le film dans des conditions qui ne sont pas les meilleures, mais je vous assure qu’il n’y en a pas d’autres possibles. »
Vous imposez-vous des limites, par exemple de ne montrer, sur une rétrospective de quarante films, que deux ou trois dans des conditions médiocres ?
JFR : Oui. On peut toujours se dire qu’il est inutile de montrer un DVD à la Cinémathèque si les gens peuvent le voir chez eux sur leur ordinateur. C’est la difficulté.
Quelles sont les œuvres aujourd’hui dont il est difficile d’organiser une rétrospective ?
JFR : Le cas Pierre Etaix a longtemps posé problème, mais il y a assez peu de films. Les choses sont plus simples pour le cinéma américain, car les major companies ont conservé les films et possèdent 80 % des droits de la production hollywoodienne. En France, même s’il y a eu Gaumont-Pathé notamment, la production se fait toujours dans de petites structures, avec de nombreux petits producteurs, des ventes, des rachats… Cet éclatement a retardé la concentration, qui n’est d’ailleurs pas encore achevée, en raison des querelles entre certains ayants droit ou héritiers. Le cinéma français est donc beaucoup plus difficile à restaurer que le cinéma américain. Les querelles de droit sur certains titres empêchent par exemple de montrer dans de bonnes conditions l’œuvre intégrale de Jean Grémillon ou de Georges Franju. Dans certains cas, parce qu’il surestime la valeur d’un film, un ayant droit attend une offre que personne ne fera jamais.
Croyez-vous qu’on a tort de considérer que le numérique insuffle un mouvement massif de restauration et de remise à disposition ?
JFR : Une fois de plus, la question est de savoir jusqu’où va le numérique, s’il peut aller jusqu’au DVD, etc. De fait, le numérique a baissé les coûts de restauration et de diffusion des films. On peut faire autant de DCP qu’on le souhaite pour les salles, à un coût assez faible. Cela a d’ailleurs aidé à la concentration, en permettant d’avoir encore plus de copies peu chères, puisqu’il fallait avoir des films pour lesquels on estimait que la demande pouvait être de 10 000 copies. Le numérique a baissé les coûts de fabrication des copies, favorisé la diffusion des films via le DVD, le BLURAY, le téléchargement légal ou illégal. Quatre ou cinq films de répertoire ressortent chaque semaine, alors qu’ils font 50 % d’entrées de moins qu’il y a 20 ans. C’est un phénomène curieux, dont on aurait toutefois tort de se plaindre.
Comment explique-t-on que ces films (res)sortent alors même qu’ils attirent de moins en moins les spectateurs ?
JFR : Le distributeur attend toujours de tomber sur le gros lot, le film qui marchera mieux que les autres et qui pourra tourner. Une fois qu’on a acheté les droits et accepté un minimum garanti auprès de l’ayant droit, on fait le DCP, qui ne coûte pas très cher, puis on le fait tourner. Il ne s’use pas. L’exploitation se fait à moyen terme en province. Certains petits distributeurs commencent à avoir un catalogue de films, même s’ils ne le gardent pas très longtemps. Quand on a plusieurs films, on peut en faire tourner deux ou trois chaque semaine pour survivre, mais aussi faire d’autres acquisitions.
Par ailleurs, le public des salles d’art et d’essai a diminué, même si Paris est préservé. C’est un public qui vieillit et qui vient voir des films de répertoire. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne voient pas de classiques, mais ils les téléchargent, les voient à la télévision ou sur leur ordinateur. C’est un autre phénomène, qui touche à la mutation de la cinéphilie.
Vous évoquez dans votre texte la mutation majeure que représente Internet. Cinq ans après on peut dire que ce point est définitivement acquis. Ma question est d’ordre général et peut-être un peu naïve : dans quelle mesure ces nouvelles pratiques et ces nouvelles cinéphilies modifient-elles votre travail de directeur de la programmation à la Cinémathèque française ?
JFR : On a l’impression de pouvoir tout trouver, mais c’est une illusion. Certains films ne se trouvent qu’à la Cinémathèque, pas en téléchargement. Je pense par exemple à Annett Wolf, dont on vient de montrer les documentaires : ils étaient introuvables jusque là et ils ont épaté tous ceux qui ont pu les découvrir à cette occasion.

Alfred Hitchcock (Annett Wolf, 1976) / Ivan Malinowski (Annett Wolf, 1972).
Existe-t-il encore un privilège absolu de la Cinémathèque sur la disponibilité des films ?
JFR : Oui, la Cinémathèque a accès aux archives du monde entier, ce qui n’est pas le cas d’un distributeur, qui doit acheter les droits d’un producteur ou d’un ayant droit. C’est une situation « non commerciale », une forme d’extra-territorialité juridique. Cela ne relève même pas du « non commercial » au sens où l’entend le CNC, c’est plutôt une coutume juridique : nous avons accès à tout et personne ne viendra nous embêter parce qu’on aura montré un film sans visa d’exploitation, sans distributeur. Ensuite, je constate que la jeune cinéphilie télécharge beaucoup, mais vient tout de même à la Cinémathèque. En partie au moins. J’aimerais qu’elle vienne plus souvent et plus nombreuse, mais il n’y a pas de coupure nette entre la cinéphilipe de la jeunesse, qui serait celle du téléchargement, et celle plus mûre, plus âgée, qui viendrait dans les salles de la Cinémathèque. C’est assez poreux. Nous avons de la chance car c’est sans doute une exception française. Je voyage un peu, les autres cinémathèques se plaignent du vieillissement de leur public. Nous avons réussi à faire en sorte que les jeunes viennent à la Cinémathèque, pour plusieurs raisons. Les cinémathèques proposent un film et disent éventuellement pourquoi. Elles donnent des repères que beaucoup de gens cherchent encore. Nous ne sommes pas dans l’indifférence absolue de l’accès à toutes les images.
Cette porosité est-elle récente ?
JFR : Je n’ai pas suivi le phénomène dans le détail depuis le début, mais je sais que nombre de nos spectateurs sont par ailleurs des spécialistes du téléchargement. Certains viennent revoir des films, parfois même parce qu’ils recherchent le dispositif, le principe d’aller à plusieurs dans une salle.
Les choses évoluent donc dans le bon sens ?
JFR : Tout cela est très fragile. En tout cas, les jeunes cinéphiles ne considèrent pas comme bizarre d’aller à la Cinémathèque. C’est un défi que nous devons relever : que peut-on donner en plus à quelqu’un qui ne veut pas se contenter de télécharger un film ou de le voir en DVD ?
C’est en effet une question.
JFR : Hormis le dispositif, il y a l’action culturelle, le discours, les conférences, les présentations. Quelqu’un montre un film et explique pourquoi il a choisi de le montrer. Les expositions jouent un rôle similaire, mais de façon partielle. Elles peuvent constituer un voyage pédagogique à l’intérieur d’une œuvre.
La Cinémathèque a-t-elle envisagé de rendre des films accessibles sur son site, pour créer une continuité en ligne ?
JFR : Nous y avons pensé, mais nous n’avons pas les droits, sauf pour quelques films, comme ceux du catalogue Albatros. Nous y travaillons. Nous pouvons le faire sur un petit corpus.
De quels droits parlez-vous ?
JFR : Quand on montre un film, il faut payer quelque chose à la personne qui en détient les droits.
Même la Cinémathèque ?
JFR : Oui, même si nous pouvons négocier. Il arrive qu’on ne paye pas les droits, mais a priori, dans le cadre d’une projection publique, celui qui projette doit payer une somme au détenteur des droits. Nous sommes loin de l’âge d’or pendant lequel la Cinémathèque retrouvait et sauvait les films. Nous avons affaire à des gens qui n’ont pas connu Henri Langlois. Ils nous disent : « Si vous voulez passer ce film, vous devez nous payer telle somme. » Juridiquement, ils sont dans leur droit. Nous devons alors négocier, expliquer qui nous sommes, notre travail de conservation… Avec un système d’échange, les projections nous reviennent moins cher qu’à un exploitant, mais elles ont un coût, comme une diffusion à la télévision. Pour mettre un film en ligne, il faut avoir les droits ou payer. Pour l’instant, nous n’avons pas de budget pour cela.
Ce sont des questions que relancera la prochaine édition du festival du film restauré, « Toute la mémoire du monde ». Les films peuvent être estampillés « Cinémathèque Française », comme une marque symbole d’expertise, qui renvoie au travail crucial d’accompagnement des restaurations. Nous avons des experts qui travaillent sur des questions d’esthétique, d’histoire, de technique. Ce que la Cinémathèque peut apporter, c’est la marque et la matière grise. Le nouveau directeur, Frédéric Bonnaud, est très sensible à cela. Certaines salles parisiennes montreront des films pendant le festival. Nous faisons le programme et les salles se débrouillent avec les ayants droit. C’est donc un programme « Cinémathèque » diffusé à la fondation Pathé (association privée), aux Fauvettes (salle commerciale) et au Reflet Médicis. Certains programmes estampillés « Cinémathèque » seront également diffusés en banlieue et en province.
Vous estampillez les programmes, mais les exploitants doivent se débrouiller avec les difficultés ?
JFR : Si le programme est estampillé, c’est que nous avons réglé les difficultés.
Mais ce sont les exploitants qui paient les distributeurs. Un tel principe existe-t-il déjà ?
JFR : C’est en cours de développement. Le festival sera un laboratoire, de façon plus intense qu’auparavant. L’ADRC (Agence pour le Développement Régional du Cinéma) aide au tirage de copies de films. Par exemple, au moment de la rétrospective John Ford organisée l’année dernière à la Cinémathèque, j’ai prévenu les distributeurs, dont beaucoup ont acheté une délégation de droits auprès de major companies, ou de mandataires comme Park Circus ou Hollywood Classics. L’ADRC les a aidés à la fabrication d’un matériel numérique et les programmes ont pu circuler dans toute la France, comme une extension de la rétrospective à la Cinémathèque. Il y avait une actualité, j’ai présenté quelques films, etc. C’est une économie symbolique car la Cinémathèque n’a pas d’argent.
Le phénomène est récent ?
JFR : Pendant des années, la Cinémathèque n’avait aucun problème avec les exploitants des salles de cinéma d’art et essai. Quand elle s’est installée à Bercy, avec trois salles, une carte de fidélité, etc., les exploitants parisiens se sont sentis menacés. Il y a eu une fronde de leur part. Les relations se sont normalisées petit à petit. Aujourd’hui, la Cinémathèque est un endroit autour duquel s’organise la gestion du patrimoine, à laquelle participent les exploitants parisiens de salles d’art et essai. Il y a deux programmateurs : la Cinémathèque, et l’exploitant avisé qui raccroche son wagon à l’actualité engendrée par la force de frappe de la Cinémathèque.
Le système reste avant tout parisien…
JFR : Il est surtout parisien, mais à partir du moment où un distributeur tire la copie d’un film, le film tourne en province. Il revient aussi aux exploitants de province de décider de le faire ou non le plus tôt possible, d’attendre ou de profiter de la résonance médiatique — c’est un bien grand mot — de certaines rétrospectives. La Cinémathèque sera de plus en plus active au coeur du patrimoine, du répertoire.
L’opération Ford en salle a-t-elle été un succès à l’extérieur ?
JFR : Je pense que oui. Mais cela dépend aussi de l’investissement de l’exploitant et de la localisation de la salle. De nombreux facteurs entrent en compte. Il y avait en tout cas plus de monde que lorsque j’ai accompagné Le Convoi de la peur (The Sorcerer) de Friedkin. La dernière édition de « Toute la mémoire du monde » a relancé le mouvement autour de cette restauration. Et puis, il y a eu une actualité Friedkin puisqu’il sortait un livre et un film. Le film sort en BLURAY aux États-Unis et en France. Beaucoup de distributeurs le veulent. C’est encore une exception française. Je pense que c’est Friedkin qui a pris la décision finale d’accorder le DVD à Wild Side et de ressortir le film en salle. La Cinémathèque a été l’un des acteurs de cette résurrection. Nous n’avons pas payé la restauration, mais nous avons participé à la diffusion et à la valorisation symbolique. La Cinémathèque avait déjà « ressuscité » Friedkin il y a dix ans. Nous avions organisé une rétrospective alors qu’on ne parlait plus beaucoup de lui. Son statut était incertain. Certains cinéphiles l’aiment beaucoup, mais d’autres moins. La Cinémathèque l’a fait rentrer, re-rentrer dans l’histoire du cinéma. Les gens ont vu ou revu ses films. C’est un processus qui prend du temps, au sein duquel la Cinémathèque française a joué un rôle. Je ne sais pas si ce rôle a été déterminant, mais il a joué pour la réception du Convoi de la peur en France. Même si les Américains s’en moquent un peu, c’était important pour Friedkin, car la cinéphilie française lui importe.
Langlois montrait toujours des films contemporains, comme ceux de Philippe Garrel. La Cinémathèque n’a jamais été uniquement le lieu du passé.
La Cinémathèque française adapte-t-elle sa programmation pour la jeune cinéphilie ? J’ai le sentiment que, depuis l’installation à Bercy, la programmation s’inscrit plus dans l’actualité, que les rétrospectives concernent davantage des cinéastes encore en activité.
JFR : Il faut nuancer : Langlois montrait toujours des films contemporains, comme ceux de Philippe Garrel, parce qu’ils lui plaisaient. Il avait organisé une rétrospective Alain Delon dans les années 1960, à l’époque où Delon n’était pas encore une star. Il était à l’affût de tout ce qui se faisait. On ne peut pas dire que la Cinémathèque se soit soudain branchée sur l’actualité au détriment d’un cinéma de patrimoine qu’il faudrait valoriser. Elle n’a jamais été uniquement le lieu du passé. C’était un lieu où les jeunes cinéastes montraient leurs films. Aujourd’hui, un jeune cinéaste ne montre plus ses films à la Cinémathèque en première instance mais à Thierry Frémaux qui dirige le festival de Cannes, à Edouard Weintrop pour la Quinzaine des réalisateurs, à d’autres festivals… C’est de cette façon que le film sera le plus largement exposé et vu, de cette façon qu’il a le plus de chance de trouver un distributeur. Les découvreurs sont un peu partout dans le monde. Quelle que soit la section, mieux vaut pour la carrière d’un film passer par Cannes. Mais la Cinémathèque accueille toujours les cinéastes ou les acteurs : ils viennent montrer leurs films et en parler. Rien n’a changé sur ce point, même si le phénomène s’est accentué ces quinze dernières années. Serge Toubiana y était très sensible : il voulait que le monde du cinéma vienne à la Cinémathèque. C’était l’une de ses priorités.
Je continue de penser que par ailleurs, la Cinémathèque est le lieu des rétrospectives et du patrimoine, que l’on peut y montrer un cinéma de toutes les époques. J’aimerais par exemple programmer une histoire du mélodrame français, qui est un genre passionnant dans toutes les cinématographies. Y a-t-il un « women’s picture » français ? A Hollywood, les producteurs pensaient que les hommes allaient prioritairement voir, disons, les westerns et les femmes les mélos. C’est en outre une manière de voyager dans le cinéma français, de Camille de Morlhon à Paul Vecchiali, en passant par Abel Gance ou Léonide Moguy. Mais ce genre pose problème en France. Il y a eu un grand nombre de mélos dans les années 1930, puis bien sûr sous l’Occupation, avec le mélo pétainiste, mais la qualité française n’aime pas ce type de films. Le cas de la Nouvelle Vague est complexe, car c’est un cinéma distancié. Vivre sa vie de Godard est pourtant bien un mélo, l’histoire d’une fille perdue. J’évoque cette idée d’une traversée du cinéma français via le mélodrame dans le premier texte du livre, « Misère de la monographie, monographie de la misère ». Ça n’est pas parce qu’il serait injuste de rendre hommage à un cinéaste moyen comme si c’était un grand artiste qu’il ne faut pas montrer ses films. On peut les montrer d’une façon différente, dans une programmation transversale. Ce sont des choses que nous allons développer.
Vos présentations de rétrospectives dans les programmes de la Cinémathèque sont toujours très précisément informées. Revoyez-vous les films avant d’écrire ? Si oui, en salle ? En DVD ?
JFR : Cela dépend, mais quand je le fais, je vois tout en DVD.
J’imaginais que vous aviez passé quatre jours en salle de projection pour écrire votre beau texte sur Terence Fisher.
JFR : Je le fais dans certains cas. Il y a, par exemple, très peu de DVD des films de Riccardo Freda. Je suis donc allé dans les collections de la Cinémathèque pour regarder ses films sur une table de montage. J’ai également dû me rendre à Mexico pour préparer la programmation consacrée au mélodrame mexicain. L’Institut français a payé le voyage et j’ai également pu rapporter les DVD pour les regarder chez moi.
Je pourrais me faire projeter des copies, mais il faudrait mobiliser un projectionniste. Ce sont des complications matérielles. Comme je sais me servir d’une table de montage, je vais à au Fort de Saint-Cyr, dans les stocks de la Cinémathèque pour voir les bobines.
Quelles sont vos sources de documentation pour la programmation autour des mélos français ?
JFR : D’abord ma connaissance du cinéma français. J’ai eu l’occasion dans ma vie de voir des films de Gance, Grémillon, Pagnol. Ensuite, c’est une recherche encyclopédique. Il faut acheter en DVD tout ce qui ressemble à du mélo et le regarder. Je m’y suis attelé l’été dernier, ce qui m’a d’ailleurs permis de faire quelques découvertes.
Vous ne programmez aucun film sans l’avoir vu ?
JFR : Je fais parfois confiance aux gens qui me conseillent.. Je n’ai pas vu tous les films qui passent à la Cinémathèque, mais beaucoup. Par exemple, je n’avais vu que vingt-cinq films d’Im Kwon Taek quand je les ai programmés. Je continue à en voir. On peut dire que je les ai programmés pour les voir !
Avez-vous le temps de voir les films quand ils passent ?
JFR : Oui. C’est important pour un programmateur d’être dans la salle, de voir qui sont les spectateurs…
Dans le cadre de vos recherches sur le mélo, trouvez-vous toujours un moyen de vous procurer les films que vous souhaitez voir ?
JFR : Si je n’arrive pas à le trouver, c’est que le film n’est pas projetable. Je passe parfois à côté certains titres, mais je me documente, et si j’entends parler d’une copie que je ne pourrais pas voir avant la projection, je prends le pari de la montrer, poussé par la curiosité.
Quand cette programmation est-elle prévue ?
JFR : Il y aura une cinquantaine de films cet été. Je peux difficilement en dire plus pour le moment.
Cherchez-vous certains films en ligne ?
JFR : Non, ça n’est pas mon truc. Je ne l’ai jamais fait et je ne saurais pas comment m’y prendre. On m’a envoyé beaucoup de DVD. J’en achète aussi. J’en ai commandé une vingtaine pour la programmation sur le mélo français.
Comment regardez vous les films lorsque vous êtes chez vous ?
JFR : Sur une grande télé. Je n’ai pas de home cinéma, mais j’ai un écran plat.
Vous n’avez pas de vidéo-projecteur ?
JFR : Non. J’y pense. Mais peut-on dire qu’en ce cas on se rapproche des conditions pour lesquelles les films ont été faits ?

La fille de nulle part (Jean-Claude Brisseau, 2012).
Un peu, mais le fait d’être seul ou à deux est souligné. Il devient pesant, ce qu’il n’est évidemment pas avec un ordinateur ou un écran de télé.
JFR : Personnellement, je ne veux pas voir un film sur un ordinateur. L’un de mes amis est collectionneur. Il organise tous les mardis pour ses copains des projections de 35 mm, pour montrer des raretés, des bizarreries. Il y a parfois du monde, mais on se connaît tous, alors parfois on chahute.
Les cinéphiles, je veux dire ceux qui aiment à se reconnaître sous ce vocable, ont souvent tendance à ne pas s’intéresser au cinéma contemporain, à le juger globalement médiocre. Je me demande même si cette tendance n’est pas plus marquée aujourd’hui qu’hier. D’où une autre question un rien naïve : n’y a-t-il pas une certaine schizophrénie à rendre compte d’une actualité, comme vous le faites dans Le Monde, tout en étant directeur de programmation à la Cinémathèque française ?
JFR : Pour moi c’est la même chose. Je le dis dans mon livre : programmer, c’est une façon d’écrire une histoire du cinéma en ordonnant ses goûts. Je ne vois aucune contraction là-dedans. Écrire mène à programmer ; programmer mène à écrire. C’est une façon de libérer des concepts et des idées.
Par ailleurs, la cinéphilie nostalgique ne m’intéresse pas. Je trouve même absurde de se construire la nostalgie d’une époque qu’on n’a pas vécue. Le cinéma est un art du présent. On peut considérer le présent comme décevant, mais je ne comprends pas qu’on se dise cinéphile si l’on ne s’intéresse pas au présent du cinéma. Bien sûr, je préfère un film de John Ford aux Bronzés 3, ou un film de Jean-Claude Brisseau à une série B de Sam Newfield avec des types déguisés en gorilles. Mais je n’ai pas remarqué que les jeunes cinéphiles ne s’intéressaient pas au cinéma contemporain.
En tant programmateur de cinéma bis, avez-vous l’impression d’assister à un mouvement récent, qui tend à redistribuer les cartes ?
JFR : C’est une bonne question, mais qui n’est pas simple. Je considère que l’histoire du cinéma telle qu’on la connait ne bougera plus beaucoup, mais qu’il y a des mouvements tectoniques et des choses a découvrir. Tout dépend du critère. On peut considérer que le critère est le public, l’intérêt du public, mais la popularité est un mouvement très lent. Aujourd’hui ce sont les rétrospectives des grands cinéastes classiques hollywoodiens qui attirent le plus de monde. Ford, Hitchcock, Lang, Lubitsch, ne bougent pas. Certains genres, comme la comédie ou le film noir, restent aussi très populaires. Avec Philippe Garnier, nous avions monté une programmation intitulée « Perles noires », des films noirs, mais signés de cinéastes relativement inconnus, comme Norman Foster ou Felix Feist. Il y avait de très belles choses. La programmation a eu beaucoup de succès, grâce à « l’effet film noir ». Il y a aussi les monographies de cinéastes installés.
Je considère que l’histoire du cinéma telle qu’on la connait ne bougera plus beaucoup, mais qu’il y a des mouvements tectoniques et des choses a découvrir.
Je remarque en revanche un désamour pour certains cinéastes modernes. J’ai été déçu de la façon dont les films d’Oshima ont été accueillis, alors que c’était un cinéaste culte il y a vingt ans. La programmation n’a pas résonné comme je l’avais imaginé. Antonioni a été un grand succès. La grande salle était comble pour L’Avventura ou Blow Up. Le Mystère d’Oberwald a fait moins que La Nuit, L’Eclipse ou Le Désert rouge. Ce sont des films pour ceux qui se considèrent comme des amateurs plus que comme des cinéphiles, ceux qui se disent : « Si je m’intéresse au cinéma, je dois l’avoir vu ». C’est d’ailleurs un phénomène très intéressant. Je demande parfois aux spectateurs dans une salle : « Combien de personnes vont voir le film pour la première fois ? ». Pour Mamma Roma de Pasolini, 80% des spectateurs ont levé la main. Il faut prendre en compte cette donnée : au sein du perpétuel renouvellement du goût pour le cinéma, il y a les goûts éphémères de ceux qui, à un moment de leur vie, ont envie de voir les classiques, mais qui passent ensuite à autre chose. Ils ne sont pas dans la cinéphilie, ils ne sont pas préoccupés par la quête, qui existe aussi par ailleurs, de l’objet rare ou à anoblir.
Les rétrospectives de cinéastes américains en activité, dont les films sont facilement accessibles, rencontrent-elles le succès ?
JFR : Pour le cinéma américain contemporain, comme Spielberg, nous avons un public jeune. Les spectateurs ont vu les films en DVD, mais ils ont envie de les revoir sur grand écran. Ils recherchent l’expérience de la salle. La grande salle de la cinémathèque a 400 places et offre des conditions de projection excellentes. Dans ces cas précis, les spectateurs se moquent que le film soit projeté sur pellicule ou en numérique. Nous passons d’ailleurs ce type de film en numérique, car il n’y a aucune nostalgie. Les cinéastes américains modernes relativement cultes, comme William Friedkin ou Michael Mann, attirent un public plutôt jeune. Une fois de plus, un « public DVD ». Une partie de la salle se dit : « Tiens, si la Cinémathèque le projette, c’est sans doute bien, je vais essayer », et l’autre : « Je vais aller revoir le film de Michael Mann sur grand écran. »
Qu’en est-il de Scorsese ?
JFR : Il entre bien sûr dans cette catégorie, surtout ses films les plus connus.
Les années 1970 ont fait un grand retour il y a une quinzaine ou une vingtaine d’années. N’est-on pas en train d’assister à un retour des années 1980 ?
JFR : Les années 1980 sont plus ingrates que les années 1970, qui ne sont d’ailleurs pas si populaires que cela. L’épiphénomène cinéphilique n’entraîne pas forcément le succès immédiat des films des années 1970. Tout dépend desquels on parle. Pour Scorsese, oui, ou même John Flynn, mais ses films n’étaient pas aussi spectaculaires que ceux de Friedkin ou Michael Mann.
Peut-on imaginer qu’un jour la Cinémathèque consacre une rétrospective à James L. Brooks ou à John Hughes ?
JFR : Je connais mal John Hughes. Il faut voir s’il vaudrait la peine de l’exhumer. Je me fous de la nostalgie, ça n’est pas mon truc. Je ne vois pas l’intérêt de faire une rétrospective uniquement par simple nostalgie de l’époque où j’étais adolescent.
Propos retranscrits par Pauline Soulat.
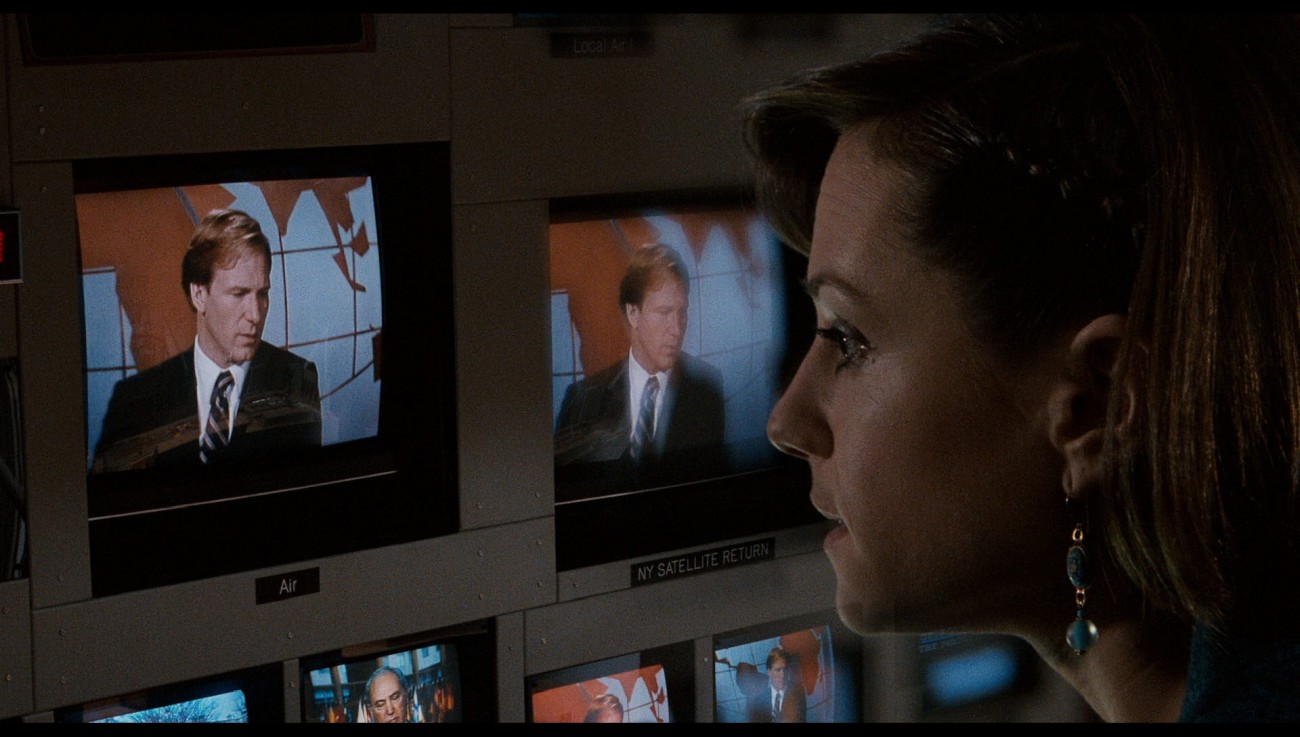
Broadcast news (James L. Brooks, 1987).