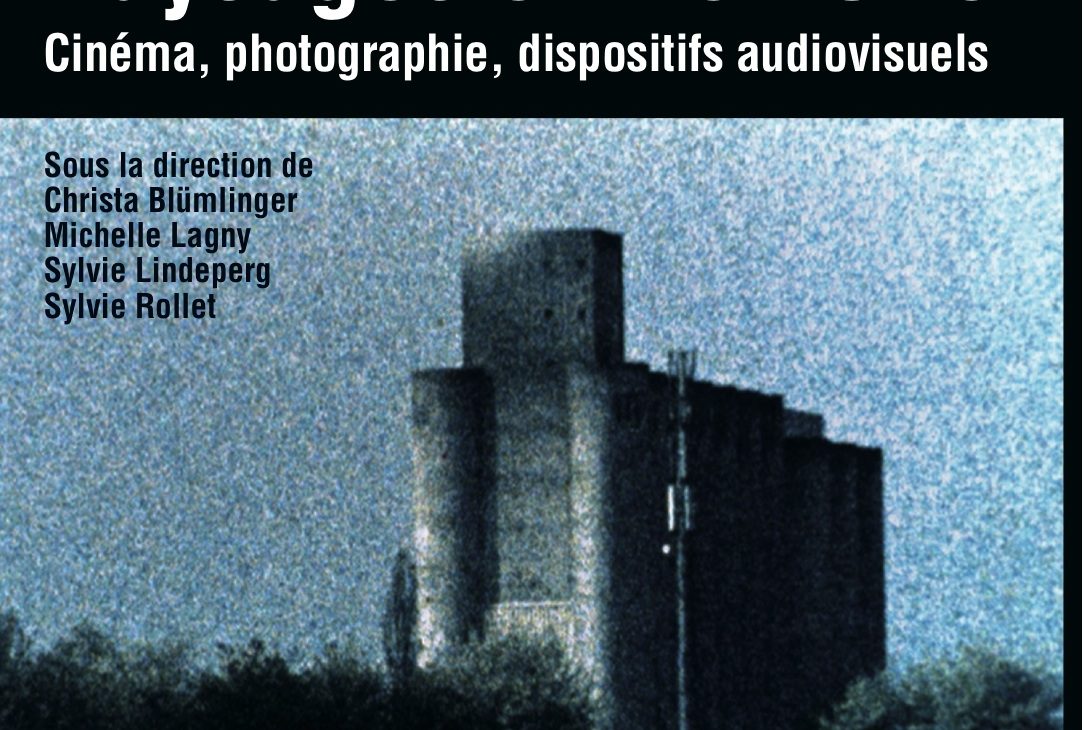La mémoire se cache en forêt
– par Diane Arnaud
Charisma (Kiyoshi Kurosawa, 1999).
Voir les 5 photos
Cet article fait partie d’un cycle
Maître de conférence à l’Université Paris-Diderot, Diane Arnaud est l’auteure de Kiyoshi Kurosawa : Mémoire de la disparition (2007, Rouge Profond). Elle signe également le livret qui accompagne le coffret DVD édité par Condor. Parmi les dix films de ce coffret figure Charisma (1990), à propos duquel D. Arnaud a écrit un essai dans le numéro 19 de la revue Théorème, intitulé « Paysages et Mémoire. Cinema, Photographie, Dispositifs Audiovisuels » et dirigé par Christa Blümlinger, Michèle Lagny, Sylvie Lindeperg et Sylvie Rollet. Cet essai a pour titre « La mémoire se cache en forêt » Nous remercions D. Arnaud, ainsi que S. Rollet, de nous avoir autorisés à le reproduire.
Au tournant du siècle dernier, le cinéma de Kiyoshi Kurosawa quitte Tokyo pour situer l’action de Charisma (1999) dans une forêt qui se meurt. Une fois échoué dans les bois, l’inspecteur Gorô Yabuike vit des aventures déconcertantes sans qu’il puisse trouver le temps de contempler l’environnement naturel, à l’instar des ascètes yamabushi (« couche-en-montagne »), adeptes de la tradition spirituelle millénaire du shugendô. C’est donc un événement visuel quand, au bout d’une heure de film, le paysage se dégage à la vue dix secondes durant. Ce long plan large retient d’autant plus l’attention qu’il comporte un élément figuratif surprenant à l’arrière-plan (fig.1).
On est d’emblée stupéfait de découvrir, surplombant la forêt dans un silence et une immobilité de circonstances, un arbre gigantesque, dont la forme évoque curieusement celle d’un champignon. Au premier plan, la silhouette excentrée et miniaturisée du héros se fait plus discrète. Cette énigmatique vision, partagée par le personnage et le spectateur, a ceci de remarquable qu’elle provoque plusieurs associations libres. Certains éléments du récit tels que la défense de l’écosystème originel ont pu laisser croire que la catastrophe à laquelle Charisma se référait allégoriquement était le ravage écologique du sappûkei, littéralement le « tue-paysage », lié à l’inoculation « à haute dose du genre de vie à l’américaine » (Berque dans Forrest, 2011 : 40) dans le Japon d’après-guerre [1]. Mais contre toute attente, la transfiguration de la nature, au moment même où des choix filmiques jusqu’à alors évités la cadrent en paysage, inscrit un autre imaginaire mémoriel : celui des explosions atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki.
Promenons-nous dans les bois de sorte à relever par quels procédés d’ordre narratif, allégorique, poétique et, selon quelles visées, cette imagerie collective réapparaît.
Rétablir les Règles du monde
La découverte du paysage filmé invite à prendre un certain recul à l’égard de l’action en cours. Via le rappel de la scène traumatisante du début, qui a eu lieu en ville, la nature se donne alors à voir comme miroir du monde. Le plan large où trône l’arbre gigantesque vient juste après que Yabuike est intervenu, sans succès, pour arbitrer les conflits entre les différents clans de la forêt. Ses aventures l’amènent ainsi à s’interroger de nouveau sur le bon usage politique de la force. Il convient, pour mieux défendre cette vision du film, de rappeler les faits.
Dès l’ouverture du récit, l’inspecteur est confronté à une situation épineuse de prise d’otage : un jeune homme mutique a séquestré un représentant élu du peuple pour revendiquer, par écrit, le rétablissement d’énigmatiques « Règles du Monde ». Yabuike a alors choisi de ne pas tirer en vue de « sauver les deux vies ». À la suite de son refus d’intervenir, le preneur d’otage et le député ont été abattus tous les deux. Le policier, congédié, mis à pied, quitte la ville. Il attend en vain un bus sur une route de montagne et, le soir tombé, va dormir dans les bois obscurs dont il ne pourra sortir in extremis qu’au dernier plan de Charisma. Dès son entrée dans la forêt, Yabuike se fait agresser sans que l’éclairage ni le cadrage ne nous permettent de discerner, par qui, comment, et pourquoi. Avant que les gardes forestiers ne le recueillent en piteux état le lendemain matin, on les découvre en un plan large, long et fixe en train de planter des pousses sur un versant montagneux clairsemé d’arbres. Le sentiment d’incompréhension et d’impuissance éprouvé face aux images agitées de la veille est prolongé en plein jour, en dépit des choix formels distincts, sur un mode plus comique qu’inquiétant. La conversation entre deux hommes, visiblement en charge des opérations, placée au centre du cadre, empêche le regard d’embrasser l’étendue de la vue paysagère. Nakasone, l’expert des bois, se désole : « On a beau planter sans relâche, ils meurent tous. » Alors que le silence enfin s’installe, un arbuste situé en hauteur, dont la frêle silhouette se découpe contre le ciel gris, se met à tomber (fig.2).

Figures 1 et 2 : Charisma (Kiyoshi Kurosawa, 1999).
La chute s’avère d’autant plus drôle que l’inaptitude du personnage à agir sur l’environnement est reliée à la gêne du spectateur à percevoir le lointain en tant que tel. En effet, le plan a été composé de façon à ce que l’arbre, avant de choir, ait l’air d’être planté sur la tête du longiligne chef des gardes forestiers. Cette facétie visuelle, indissociable d’une négation de la perspective entre l’avant-plan et l’arrière-plan, rend cocasse l’impossible constitution d’une vue paysagère.
La forêt qui se meurt est d’abord filmée comme un milieu ambiant [2]. La propagation de la brume à travers l’entrelacs des branchages crée une sensation d’immersion, entrave la vision en profondeur et interdit qu’un « point de vue » puisse se dégager. Même quand la ligne d’horizon réapparaît au sortir des bois, le regard est frappé d’instabilité du fait du hiatus entre le point d’observation et le trajet des corps. L’indépendance des mouvements d’appareils, qui n’accompagnent pas systématiquement le déplacement des protagonistes à travers les clairières et les champs, rend non seulement imprévisibles leurs trajectoires, mais entraîne un vacillement entre objectivité et subjectivité du point de vue. En outre, l’architecture ouverte sur le dehors des habitations offre, par les fenêtres grillagées et les baies vitrées, un ancrage aux prises de vues mobiles. La même imbrication entre intériorité et extériorité régit la bande son du film, dont les bruits d’ambiance évoquent une respiration virtuellement commune à l’homme et à la nature. La poétique spatiale de Charisma rend ainsi sensible la notion de « trajectivité » proposée par Augustin Berque pour qualifier la dynamique historique de constitution d’un « milieu ». Il s’agit, pour le géographe, de dépasser la triple dualité du subjectif et de l’objectif, du naturel et du culturel, du collectif et de l’individuel, mais aussi de combiner plusieurs logiques temporelles : « temporalité linéaire (l’enchaînement causal), temporalité bouclée (les rétroactions), et achronisation (la suppression du temps par l’assimilation métaphorique du passé au présent, du possible à l’actuel) » (Berque 1986 : 151). Si le film de Kurosawa éclaire la pensée de Berque, c’est que la nature filmée dans Charisma est à la fois un terrain d’expérimentation et un terrain de spéculation.
Ce western forestier qu’est Charisma peut être compris comme une fable politique sur la crise de l’identité nationale que traverse la société japonaise contemporaine.
Ce western forestier peut être compris comme une fable politique sur la crise de l’identité nationale que traverse la société japonaise contemporaine soumise à de nouveaux modèles, alors qu’elle a traditionnellement privilégié le groupe au détriment de l’individu. Dans le film, l’opposition entre les clans se fonde sur une analyse divergente des menaces qui pèsent sur l’environnement. Charisma, l’arbre bien nommé, est l’objet de toutes les spéculations intellectuelles. Selon la biologiste, Melle Jinbo, il faut éliminer ce « monstre », car ce spécimen rare, installé dans une clairière, secrète des toxines mortelles pour survivre. Sauver la forêt dans son ensemble, c’est, dit-elle, la défendre contre son désir : les arbres, irrésistiblement fascinés et attirés par le parasite, s’en rapprochent dangereusement au lieu de le fuir. Le propos scientifique vise à rétablir « l’écosystème originel » qui est ici une forêt idéale et parfaite de hêtres pure souche. L’arbre apporté de l’extérieur par l’ancien directeur du sanatorium prend la figure politique de l’étranger. Le discours de la scientifique évoque le mythe de la sylve primordiale (cette « nostalgie de la matrice » qui a joué un rôle important dans la mobilisation écologique depuis quarante ans), devenu, non sans « complaisance », un élément d’ancrage de « l’authenticité nationale » dans l’imaginaire des Japonais (Berque, 1986 : 115). Dans le camp adverse, Kiriyama, un ancien patient du sanatorium, poursuit l’œuvre du feu directeur. Pour lui, Charisma est, au sens hégélien, un Grand Homme, « dont l’âme a une envergure spirituelle inconnue chez les hommes ordinaires » (Hegel 1965 : 123). Cet arbre, qui a la « puissance irrésistible » d’un conducteur d’âmes, doit être vénéré, soigné et protégé. Face à ce conflit idéologique portant sur le « sens de l’histoire », Yabuike a du mal à choisir son camp. S’il hésite à agir, alors que tous se tournent vers lui, c’est que les conflits qui surviennent au beau milieu de la nature lui rappellent ce qu’il a connu dans la violence urbaine. Aux arguments de la biologiste, il oppose un désir de conciliation : sauver à la fois Charisma et la forêt. Quand Kiriyama exhorte à suivre les « Règles de la nature », ces propos font écho au souhait exprimé par le preneur d’otage qui appelait au rétablissement des « Règles du monde ». Peut-on, par analogie, voir une explicitation de ces mystérieuses règles dans la proposition de lever une armée en pleine forêt ? Mais le modèle serait-il alors celui de l’idéologie fasciste ou celui de la révolution étudiante marxiste ? Les dialogues de Charisma comportent tant d’allusions historiques et culturelles que le sens des allégories politiques qui y seraient cachées en devient indécidable. Ce qui convaincra Yabuike de prêter main forte à Kiriyama, c’est, finalement, la menace capitaliste : des mercenaires enlèvent Charisma pour le vendre et réaliser de substantiels profits.
La vue du paysage ne peut avoir lieu qu’après cette scène d’action rocambolesque, menée tambour battant, en hommage impossible aux Aventuriers de l’Arche perdue (1980) de Steven Spielberg [3]. L’intervention de Yabuike finit ainsi par échouer car Mlle Jimbo, aidée de sa sœur, a incendié l’arbre insolite. Dans le hors-champ du plan paysager, Kiriyama, désolé, se tient accroupi devant Charisma réduit à un tronc carbonisé. C’est parce que Yabuike a détourné son regard du drame que le paysage est perçu à une autre échelle. Dès lors, le héros va envisager différemment le dilemme de la forêt, non sans lien réflexif avec l’énigme que lui a posée la société japonaise. Afin de dépasser l’opposition entre le Grand Arbre et l’ensemble du biotope, entre l’individu et le collectif, Yabuike élit pour nouveau Charisma un arbre ordinaire et décide de ne plus agir selon le diktat de règles préétablies mais au cas par cas, de manière contingente. Les habitants de la forêt, décontenancés par le choix de leur leader, se mettent un à un à disparaître. Le héros va alors – enfin ! – sauver deux vies : celle du mercenaire, à la place du jeune homme, et celle de la scientifique, à la place du député, selon une logique de remplacement qui reste inexplicable. Après cet incident, l’inspecteur Yabuike retourne en ville pour s’apercevoir que le chaos y règne aussi. Le séjour dans la nature aura donc pris la dimension d’une « métaphore agissante ». Cette visée allégorique du récit, quant à la difficulté pour l’individu moderne à agir ou à ne pas agir, dans un milieu qui échappe à sa compréhension, ne saurait toutefois épuiser le sens pris par l’imaginaire du paysage.

Figure 3.
Redessiner le contour des croyances
La forêt de Charisma est aussi le site sur lequel une mémoire collective oubliée revient en images [4]. Avant que le paysage se dégage à la vue, après la destruction de Charisma par les flammes, une mousse verte envahit le ciel derrière la tête de Yabuike en gros plan (fig.3).
Cette formation imaginaire ne s’assimile pas à une image mentale subjective. Comme la coupe sonore, synchrone, le signale, la vision imaginaire tend à se départir du récit en cours, ainsi que de son sens allégorique ‑ d’ailleurs difficilement identifiable. Il n’est pas anodin que la première vue du paysage qui ne se dérobe pas à la durée soit une image de synthèse ; elle intègre à l’enregistrement naturaliste du visible l’effet-spécial du trucage numérique. L’aspect quasi dessiné que revêt l’arbre gigantesque peut alors remettre à l’esprit, l’espace d’un instant, le film d’animation d’Hisayo Miyazaki, Princesse Mononoké (1997), qui a traité sur le registre du merveilleux la mythologie des Dieux de la nature. Dans la pensée japonaise de la haute antiquité, les phénomènes et forces naturels, tels que les montagnes et les arbres, « souvent de grande taille ou de forme particulière » (Rotermund : 2000, 37), constituaient des kamis (généralement traduit par « divinités »). La pensée shintoïste des époques ultérieures a personnifié les kamis en les dotant de qualités éthiques, mais à l’origine ils relevaient davantage de conceptions animistes. C’est de manière implicite et diffuse que Charisma fait référence à ce fonds de croyances sur les forêts sacrées du Japon ancestral. À partir du moment où l’inspecteur Yabuike se perd dans les bois, plusieurs événements ressortissent à la toute-puissance de la pensée magique. Au lendemain de son immersion nocturne, le héros va tenter de récupérer son badge et son arme qui lui ont été subtilisés. Au cours de sa promenade dans les champs, il se retrouve soudain, à la faveur d’une ellipse, en haut d’une montagne ; au moment même où il aurait pu jouir d’un espace-temps de contemplation face à la vue panoramique des cimes bleutées alentour, une étrange coïncidence se produit. Son téléphone portable sonne derrière son dos. Alors, Yabuike se détourne du paysage : il va chercher l’appareil dans les herbes et décroche. Son chef lui signifie que son congé est devenu « illimité ». La destitution de ses fonctions est le fait d’un enchaînement incroyable, en vague écho aux croyances animistes logées dans la nature par les traditions populaires japonaises. Sous une forme entêtante et allusive, la présence cachée d’un passé culturel et historique est rendue sensible dans un paysage qui est lui-même dissimulé à la vue.
Avant l’apparition de l’arbre géant, le film a déjà associé les dérèglements de la vision subjective à un processus de hantise trompeur, comme si une mémoire collective enfouie jouait à cache-cache avec le regard de Yabuike. Juste après l’épisode du téléphone portable, il replonge dans les bois enfumés et y mange un champignon, qui sera identifié après coup comme un « bolet hilarant », probablement hallucinogène (fig.4).

Figure 4.
En contrechamp de son regard, plusieurs visions pour le moins angoissantes provoquent chez lui une hilarité incongrue face à un cadavre pendu à un arbre, devant un Grand Hotel en ruines caché derrière les branchages. Yabuike s’introduit dans ce sanatorium à l’abandon et s’y endort. Quand il est réveillé, l’expression d’effroi sur son visage se découvre au fur et à mesure que disparaît l’ombre portée de son mystérieux interlocuteur hors-champ. Un jeune homme de noir vêtu, entraperçu dans l’obscurité ambiante, a proposé de lui rendre son arme « en échange de son âme ». La terreur suscitée par son apparition ainsi que la teneur de ses propos (évoquant le relais entre les genres, du film policier au film de fantôme) l’apparentent à une forme moderne de yurei, un spectre japonais issu des contes fantastiques, les kwaidan, qui ont été rendus célèbres en Occident par l’ouvrage de Lafcadio Hearn au début du siècle dernier. C’est le terme que Yabuike utilise lors de la rencontre officielle avec Kiriyama, le lendemain matin, quand il s’exclame : « Alors, tu n’es pas un spectre. » En dépit de ce constat, l’empreinte du fantomatique ne s’estompe pas. Ajoutons que le cadre choisi pour l’apparition du faux-fantôme est un hôtel juché dans la montagne, dans la même position surplombante que celle de l’Overlook Hotel dans Shining (1980, Stanley Kubrick). Cette référence au cinéma fantastique occidental rappelle ce haut lieu d’une horreur familiale et historique qui se reproduit au cours du vingtième siècle. Aussi la spécificité du fantomatique dans l’univers du cinéaste est-elle double. Ses spectres, conformément à la tradition japonaise, ne sont pas des revenants ; ils côtoient le réel sans en être séparés, sans être tenus à distance. Au détour d’un changement d’éclairage, via un discret recadrage du plan, la mise en scène les découvre comme étant déjà-là. Contrairement à ce que développent les récits des kwaidan, toutefois, la présence fantomatique que subissent les héros de Kiyoshi Kurosawa ne correspond pas systématiquement à une histoire de vengeance personnelle. Inexplicablement, les protagonistes, l’air de plus en plus sonnés, se comportent comme s’ils avaient eux-mêmes vécu un événement traumatique dont ils n’ont été ni témoins ni prévenus et qui pourtant les hante. L’apparition du faux yurei aux yeux de Yabuike, couché dans un cocon-tombeau, dans l’antre obscur de l’hôtel réactive le lien entre le lieu cryptique et l’héritage fantomatique. Le héros est bien frappé par le dévoilement d’un inconscient collectif, provenant d’un passé à la fois méconnu et refoulé [5].
L’« horizon » du paysage est une question : en quoi la catastrophe nucléaire continue-t-elle à peser sur la possibilité de l’action, dans le Japon en crise des années 2000 ?
Avant cette scène de face à face fantomatique, le montage a inscrit en filigrane une forme paradoxale de remémoration : le « faux-départ ». Ce motif caractéristique des films policiers de Kurosawa, consiste à reprendre les choix scénographiques de la séquence d’ouverture en en changeant quelques paramètres stylistiques et narratifs. L’effet produit constitue un paradoxe : le récit avance tout en donnant l’impression de s’effacer, de s’oublier dans le défilement. Charisma radicalise le procédé en opérant de la sorte dès la troisième séquence, de part et d’autre de la prise d’otage, par le doublon de la scène au commissariat. À l’effet du « faux-départ » s’ajoute la présomption du « faux-réveil », lui-même répété chaque fois que Yabuike est réveillé par son supérieur. Très tôt, on se met à croire que ce qui s’est passé a pu avoir lieu dans un espace imaginaire parallèle. Lors de l’entrée dans la forêt, l’inspecteur congédié est de nouveau surpris dans son sommeil par l’incendie de la voiture, dans laquelle il s’est assoupi, à l’orée du bois. Ce statut indécidable des faits, qui échappe à la distinction entre l’onirique et le réel, crée une logique proche de celle du « non-sens » chez Lewis Carroll à même de détruire à la fois « le bon sens comme sens unique » et « le sens commun comme assignation d’identités fixes » (Deleuze 1969 : 12). Comme dans les aventures supposément rêvées d’Alice au pays des merveilles ou De l’autre côté du miroir, les personnages pris au piège, vont et viennent, tournent en rond, s’interrogent sur l’absurdité de ce qu’ils vivent et se demandent sous la loi de quel univers autre que le leur ils sont possiblement tombés. Yabuike, égaré dans la forêt, ramasse et mange, à l’instar d’Alice, un champignon avant d’halluciner un yurei le soir venu. La construction fictive d’un imaginaire insensé repose sur les processus mémoriels de va-et-vient entre événement, souvenir et effacement en série. Ainsi, vers la fin du film, l’employé municipal du bureau de l’environnement se perd dans la forêt embrumée et, soudain affamé, dévore un champignon. L’effet n’est plus aussi hilarant puisque le chef forestier Nakasone, qui agonise à ses côtés, commente la situation en ces termes : « C’est l’Enfer. » Ce passage est sans doute un écho du film d’Ishirô Honda (réalisateur de Godzilla), Matango [6] (1963). Les personnages échoués, sans provisions, sur une île se transforment en monstres après l’absorption de champignons cueillis dans une forêt maudite. La référence à l’épisode des pêcheurs irradiés à la suite des essais nucléaires américains sur l’atoll de Bikini passe par une métaphore visuelle : de la défiguration des visages à la forme des champignons.
Revoir tomber la catastrophe
Dans Charisma, les motifs évoquant la catastrophe nucléaire sont plus labiles. La référence à l’événement historique prend la tournure inattendue d’une vision imaginaire si bien qu’un apaisement contemplatif se mêle à la stupeur de la reconnaissance. Il n’est pas fortuit que l’arbre géant ait la forme d’un champignon atomique. Cette apparition, à l’instar des présences fantomatiques dans le cinéma de Kiyoshi Kurosawa, semble avoir été toujours « déjà-là » bien que dissimulée dans le milieu forestier. Dès lors que le film se détourne du récit, que le cadrage assume un recul suffisant, que le silence se fait, et que la durée du plan fixe se prolonge durant quelques secondes, se produit un dévoilement, à la fois perceptif et mémoriel. Puis, sans y prêter attention, l’intrigue reprend son cours. Et on a de fait tendance à oublier la vision de l’arbre-champignon tant le récit redevient déconcertant. Seulement, le souvenir de l’anéantissement va revenir à l’occasion de deux autres vues paysagères qui composent un triptyque avec la première. Cette modalité discontinue de reconnaissance conduit, si ce n’est à donner une signification évidente à ces visions, tout au moins à penser la temporalité qu’induit l’explosion de la bombe atomique. L’« horizon » du paysage est, en ce sens, une question : en quoi la catastrophe nucléaire continue-t-elle à peser sur la possibilité de l’action, dans le Japon en crise des années 2000 ? Le deuxième volet du triptyque est une vue fixe sur le « nouveau Charisma » : un arbre ordinaire et peut-être mort, qui a retenu l’attention de Yabuike. Il le soigne puis le détruit sans états d’âme : l’usage de la violence est désormais contingent. Dans le plan large qui cadre l’arbre solitaire, la silhouette du policier s’immisce dans l’avant-plan et tire en direction du « nouveau Charisma » – au pied duquel la biologiste a placé des tubes d’air comprimé. Au moment de l’explosion, aveuglé par l’éclat d’une blancheur irradiante, le héros retourne la tête vers nous puis disparaît du champ (fig.5). Dans maints films de Kurosawa apparaît, mais toujours en pointillé, la référence au pika [7], c’est-à-dire au flash de l’explosion nucléaire et à sa double temporalité, entre instantané et à-venir, déjà-là et après-coup [8]. Il ne s’agit pas tant d’imposer un devoir de mémoire que de réinscrire la référence historique parmi les contraintes qui déterminent notre vie quotidienne.
Le retour épisodique et la dissipation de ces images mémorielles amènent à percevoir ce que la fin du monde a de banal. À la fin du film, les brumes mystérieuses, entourant le nouveau Charisma, se propageant à travers la nature, réduisent ses habitants à la paralysie mortelle de pantins désarticulés. Après avoir sauvé l’otage et la victime, dans un reenactment concluant de la scène inaugurale, l’inspecteur Yabuike quitte les montagnes. Au sortir des bois, il appelle son chef qui semble soulagé d’apprendre que celui qu’il avait congédié reprend du service. Le regard du héros trahit alors une détermination inédite, quand apparaît, en contrechamp, le troisième volet du triptyque paysager : non plus la forêt ou la clairière, mais la ville vue depuis les collines. Rougeoyante dans l’obscurité ambiante, survolée par trois hélicoptères, elle a l’air d’être plongée dans le chaos (fig.6).
Cette vision apocalyptique, intensifiée par les bruits des sirènes, n’engendre toutefois pas l’excitation spectaculaire produite par les films catastrophe. La largeur, la fixité ainsi que la durée prolongée du plan rappellent les caractéristiques formelles des deux autres paysages filmés de Charisma. S’y inscrit de nouveau la sensation apaisée d’un péril banalisé. Avec assurance, Yabuike s’éloigne vers le devoir qui l’attend. Désormais l’action s’insère dans un monde qui puise dans la mémoire de la catastrophe le savoir de sa fin « techniquement possible et même vraisemblable » (Anders 2007 : 115). Telles sont les « Règles du monde » qui ont été rétablies par les visions du paysage.
Il serait tentant de voir dans l’association entre le paysage atomisé et la ville apocalyptique une préfiguration de « l’équivalence des catastrophes ». C’est en ces termes que Jean-Luc Nancy décrit le traumatisme du san ichi ichi, (« le trois un un »), le séisme du 11 mars 2011 et l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima qui s’en est suivi, un demi-siècle après la destruction atomique de Hiroshima et Nagasaki. À partir du « paradigme » du risque nucléaire, les conséquences des choix techniques, économiques, politiques sont désormais inséparables des désastres naturels. À la fin de Charisma, un vent de folie souffle de la nature à la ville, de la ville à la nature. La forêt détruite a servi de support imaginaire pour que la mémoire de l’explosion atomique se reforme de manière paradoxale, sur fond d’oubli, en intégrant des processus de hantise et d’effacement. Un surprenant triptyque paysager, construit en retrait du récit, aura mobilisé le regard de manière à revoir et à prévoir pareil risque d’anéantissement.

Figure 5.
Références
ANDERS, Günther, 2007, Le Temps de la fin, Paris, L’Herne.
ARNAUD, Diane, 2007, Kiyoshi Kurosawa. Mémoire de la disparition, Pertuis, Rouge Profond.
BERQUE, Augustin, 2011, « Avec le Japon », in Forrest, Philippe (éd.), Du Japon, La Nouvelle Revue Française, n°599-600, Paris, Gallimard, p. 33-44.
BERQUE, Augustin, 1986, Le Sauvage et l’artifice. Les Japonais devant la nature, Paris, Gallimard.
CORTADE, Ludovic, 2002, « Charisma : l’arbre de la non-substance », in Mottet, Jean (éd.), L’Arbre dans le paysage, Seyssel, Champ Vallon, p. 137-151.
DELEUZE, Gilles, 1969, Logique du sens, Paris, Minuit.
HEGEL, G.W.F., 1965 [1830], La Raison dans l’histoire. Introduction à la philosophie de l’histoire, traduit de l’allemand par K. Papaioannou, Paris, 10/18.
KUROSAWA, Kiyoshi, 2008, Mon Effroyable histoire du cinéma. Entretiens avec Makoto Shinozaki, traduit du japonais par Mayumi Matsuo et David Matarasso, Pertuis, Rouge Profond.
ROTERMUND, Hartmund O. (éd.), 2000, Religions, croyances et traditions populaires du Japon, Paris, Maisonneuve & Larose.
NANCY, Jean-Luc, 2012, L’Équivalence des catastrophes (Après Fukushima), Paris, Galilée.
THOMAS, Benjamin, 2009, Le Cinéma japonais d’aujourd’hui. Cadres incertains, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
[1] Pompoko (1994), dessin animé d’Isao Takahata, a justement traité du phénomène de déforestation lors de l’essor des villes nouvelles autour de la mégalopole de Tokyo dans les années 1960. Les blaireaux, descendants des tanukis, divinités monstrueuses et métamorphiques de la forêt, se rebellent en vain contre l’éradication de leur biotope. Une fois la forêt ratiboisée, les tanukis se retrouvent contraints de se transformer en hommes des villes aliénés par un sempiternel métro-boulot-dodo. Dès le départ, cependant leur comportement supposé représenter une vie rurale collective, rythmée par le cycle des saisons, est régi par l’acculturation occidentale, de l’ingurgitation de hamburgers à l’abrutissement devant la télévision.
[2] La forêt apparaît davantage comme un « huis clos », où « la trame du tissu social se distend », dans l’étude de Ludovic Cortade sur Charisma, inspirée par les travaux d’Augustin Berque et de Georg Simmel (2002 : 141).
[3] « J’aurais aimé faire un film d’aventures comme Indiana Jones avec deux rivaux dans la quête d’un trésor » déclare le cinéaste, « mais il n’y a pas d’Indiana Jones dans la vie. Et c’est ça que je filme ». (Mes, 2005 : 98) Ma traduction de l’anglais.
[4] Charisma a peut-être inspiré le renouveau du motif de la forêt dans le cinéma japonais contemporain. Mais contrairement au film de Kiyoshi Kurosawa qui privilégie des formes paradoxales de déjà-là et de va-et-vient pour les processus imaginaires de remémoration, ce sont les motifs du surgissement et du soubassement qui sont employés lors des visions et des souvenirs dans La Forêt oubliée (2005, Kôhei Oguri) et The Taste of Tea (2003, Katsuhito Ishii). Pour ce dernier film, voir Thomas (2009 : 248-249).
[5] Dans Reincarnation (2006) de Takashi Shimizu, Kiyoshi Kurosawa joue le rôle d’un professeur en « cryptomnésie », définie comme la hantise de l’inconscient d’un défunt en soi, dont nous partageons les souvenirs sous formes de visions, sans les avoir vécus. La familiarité de l’univers du cinéaste avec les notions métapsychologiques de la « crypte » et du « fantôme » est en effet indiscutable.
[6] Kurosawa rapporte que Matango, qu’il a vu en salle à l’âge de huit ans, est le premier film qui l’ait effrayé (Kurosawa, 2008 : 14).
[7] L’expression onomatopéique est employée par les rescapés d’Hiroshima et Nagasaki, les Hibakusha.
[8] Des traces visuelles évoquant les bombes atomiques et les bombardements au napalm de la Seconde Guerre mondiale sont glissées ici et là, dans les films de Kurosawa, sur le même mode de la vision flashée. Interrogé à propos des empreintes charbonneuses qui, dans Kaïro (2001), apparaissent sur les murs et les trottoirs d’un Tokyo déserté, le cinéaste reconnaît avoir figuré les jeunes « fantomisés » (selon un mot-valise que l’on propose de former entre fantôme et atomisation) à partir de l’inscription visuelle d’Hiroshima. Voir Arnaud, 2007.