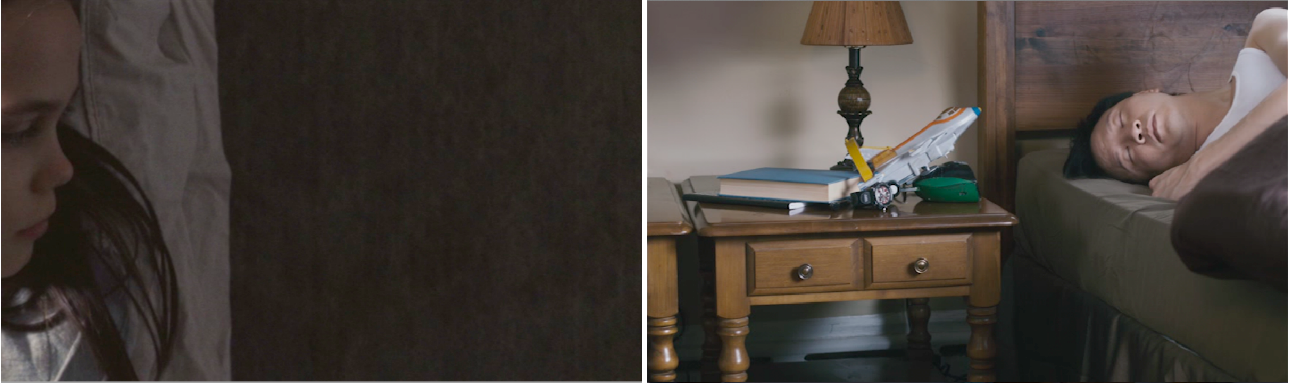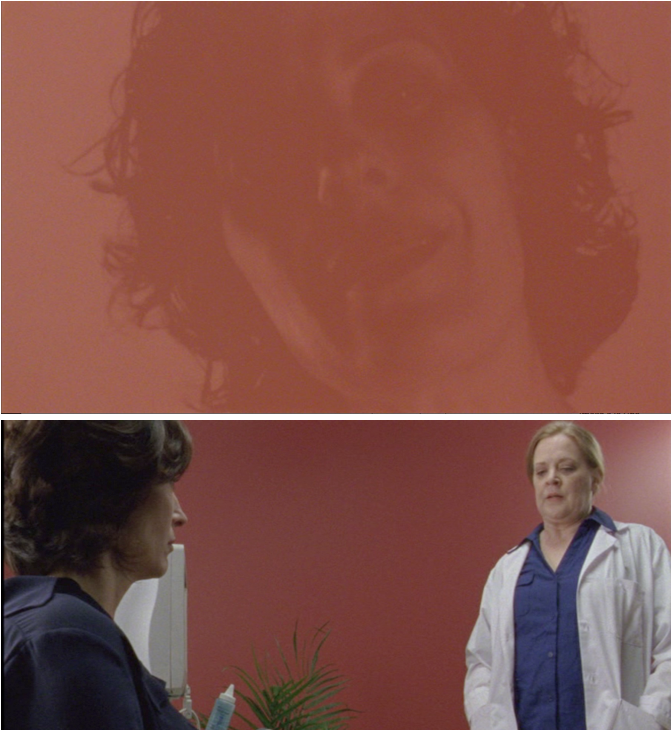Patrick Wang : “Le mystère durera toujours.”
– par Le public du Café des Images
© Marie Bottois
Voir les 5 photos
Cet article fait partie d’un cycle
Il avait fallu plus de trois années pour qu’In the family, le premier long-métrage que Patrick Wang réalisa en 2011, arrive sur les écrans français. Le cinéaste n’avait alors eu l’occasion de présenter son film que dans une seule salle, à Paris. Aujourd’hui, l’intérêt critique et, surtout, le travail courageux mené par son distributeur, ED distribution, permettent aux Secrets des autres de bénéficier d’une sortie plus digne des promesses que contient cette œuvre délicate. Nous sommes heureux d’avoir pu laisser résonner, sous le dôme du Café des images, la parole vive, précise, et toujours pleine d’humour, de Patrick Wang, qui se retrouve à nouveau, ainsi qu’il l’écrit lui-même en évoquant le tournage de son film, « comme un moine catapulté dans une course olympique ».
Merci à Stéphanie Levet, interprète de Patrick Wang lors de cette soirée.
Yannick Reix : Nous pourrions commencer par évoquer le travail d’adaptation à l’origine des Secrets des autres.
Patrick Wang : J’avais lu les précédents romans de Leah Hager Cohen sans avoir jamais l’idée d’en faire des films. Mais quelque chose m’a retenu dans The Grief of Others. Ce roman m’a beaucoup appris, non à propos de choses lointaines, mais au contraire très proches. Il m’a rendu notamment plus sensible à ce que pouvait vivre mon entourage, aux douleurs des autres, ainsi qu’à la manière dont nous vivons ensemble. Cela m’a semblé une bonne raison pour en faire un film. Par ailleurs, j’ai toujours eu beaucoup de théories concernant l’adaptation des livres au cinéma. Mais les théories n’ont selon moi de sens que si elles sont mises en pratique. Ce roman m’offrait une matière pour aborder concrètement ce problème.
Leah est une amie. L’avantage de travailler avec une amie est qu’il n’y a pas d’intermédiaire. Personne n’est venu interférer. Ni avocat, ni homme d’affaires. Nous avons alors pu connaître une de ces situations, rares, où il est possible d’être vraiment honnête. Je me suis lancé dans l’écriture du scénario, je lui montrais le résultat. Elle me demandait : « Mais est-ce que les gens vont comprendre ? Est-ce que ça va marcher ? » Et, en tout honnêteté, je lui répondais que je n’en savais rien. Certains éléments peuvent se prévoir, mais pour bien d’autres, il faut réaliser le film pour s’en rendre compte. C’est le genre de choses qu’un avocat ne comprend que difficilement. Mais un autre artiste peut trouver cela réellement enthousiasmant.
Hachem : Avant la projection, vous avez dit que le roman avait un côté « direct », au contraire du film. Était-ce une manière d’évoquer l’agencement chronologique de l’un et l’autre ? J’aimerais par ailleurs savoir si, au cours de ce travail d’adaptation, des ajouts importants se sont imposés à vous.
P.W. : Le roman est très long, et complexe. Il y a six points de vue, qui alternent sans cesse, même si cela se fait sur des phases plus longues que dans le film. J’ai d’abord pensé étudier précisément la structure de l’ouvrage. Mais j’ai abandonné ce projet. Je me suis en fait rendu compte que j’avais une merveilleuse tendance à l’oubli. Cela m’a permis de découvrir la colonne vertébrale du livre. Ne m’était tout simplement resté que ce qui m’avait vraiment touché. J’ai donc supprimé des scènes, comme des renvois au passé qui ne sont désormais plus qu’évoqués par un dialogue. J’ai aussi utilisé des photographies pour faire passer certaines informations. Parmi les choses supprimées, il y en a tout de même certaines dont nous avons souhaité conserver l’esprit. J’ai alors procédé par condensation. Cela peut prendre la forme d’un accessoire, par exemple. Ce ne sont que des détails, certes – auxquels vous n’avez pas forcément prêté attention, et que j’ai même peut-être oubliés. Il y a pourtant là ce qui donne le sentiment que le roman, tout le roman, est bel et bien présent dans le film. Je dirais que 80 % du livre a été conservé. Et sur les 10 ou 20 % restants, j’ai rassemblé, compressé divers éléments du roman avec cette volonté d’en extraire le suc.
Je me suis rendu compte que j’avais une merveilleuse tendance à l’oubli.
Au fond, la question est toujours la même : ce livre pouvait-il devenir un film ? Je ne sais pas comment je suis parvenu à cette solution, mais c’est en envisageant l’éclatement de la forme, du récit, l’usage des ellipses et des répétitions, que j’ai enfin compris que ce qui constituait l’esprit de ce livre pouvait être saisi par le cinéma.
Y.R. : Le film s’ouvre sur un plan subjectif, teinté de rouge, très étonnant. Celui-ci semble à la fois convoquer le personnage absent, ce bébé dont la mort hante la famille dont vous racontez l’histoire, et le spectateur. De la même manière, la fin se présente comme une adresse au personnage absent du bébé. À l’évidence, le film est très composé, très écrit. Comment en avez-vous conçu la structure ?
P.W. : Le livre est très riche en détails, ce qui m’a beaucoup aidé. Si je n’avais pas tourné ce premier plan du point de vue du bébé, je crois que le film n’aurait reposé que sur un sentiment d’absence, ce qui est très ténu, très difficile à transformer en une matière dramatique vivante. Votre question concerne la composition de l’oeuvre. En fait, il me semble essentiel d’accepter un certain nombre de défis, et de ne pas toujours savoir où l’on va. Le prologue du roman raconte les premières heures de la vie du bébé. La prose y atteint un degré de poésie absolument formidable. Pour beaucoup de lecteurs, c’est même le plus beau passage du livre. Évidemment, les gens me demandaient si j’allais le conserver, tant cela semblait impossible à traduire à l’écran. Pourtant, il est évident que cela donne un cadre un film, que cela produit un effet de hantise chez le spectateur. J’ai donc essayé de le retranscrire malgré tout.

Rouge douleur (Les Secrets des autres).
Thierry : À propos du système de reprises mis en place dans le film, j’aimerais revenir sur le personnage de Gordie. Il est présent lors du premier rituel funéraire fait de manière solitaire par la petite fille, puis revient à la toute fin, lorsque les membres de la famille rendent hommage ensemble au bébé mort. La trajectoire de ce personnage est-elle de rejoindre la scène familiale, ou sa présence est-elle motivée par un autre élément, comme le fait qu’il pourrait être lui aussi touché par une absence ?
P.W. : Il y a en effet beaucoup de parallèles et de variations entre le début et la fin. Gordie ne rencontre pas les autres personnages sans bonne raison. À la fin, néanmoins, la rencontre advient de manière très simple et naturelle, sans motif particulier. Il y a donc cette évolution en lui. On ne sait pas s’il va devenir un ami de la famille, si celle-ci va l’accepter. Ce moment reste comme suspendu. Il était important pour moi de finir ainsi. Un autre aspect que j’aime dans cette situation est que Gordie vient en quelque sorte contrebalancer le départ de Jess. Une forme d’équilibre revient grâce à ce nouvel élargissement de la famille.
Catherine : J’ai beaucoup aimé la non-linéarité de votre récit, son morcellement. Pourquoi avez-vous choisi cette manière de raconter ?
P.W. : Un film offre très peu de temps par rapport à un roman. Il faut donc concentrer les durées. Pour ce faire, j’ai joué sur ce qui constitue au fond l’expérience quotidienne de chacun. Les gens ne se rencontrent généralement que pour de brefs moments. Par exemple, vous et moi, ce soir, nous parlons depuis à peine quinze minutes et pourtant, nous n’avons aucun mal à nous représenter l’histoire de l’autre, à avoir une opinion sur lui. Mais si jamais nous avons l’occasion de nous croiser à nouveau, peut-être commencerons-nous à évoquer notre passé. Nous pourrons alors ajuster, affiner nos opinions respectives. C’est avec tous ces fragments désordonnés que nous apprenons à nous connaître. J’ai pensé que je pourrais faire la même chose au cinéma.
Y.R. : Les Secrets des autres est marqué par un véritable sens de l’équilibre, notamment dans le rapport des personnages dans le cadre. D’un autre côté, il y a aussi comme des trouées, des attaques portées contre les images elles-mêmes. Je pense notamment au très long plan de la fin, où deux espaces s’enchevêtrent, l’un intérieur, l’autre extérieur, mais aussi à cette conversation où un personnage est sans prévenir remplacé par un autre. Pourriez-vous évoquer cette tension ?
P.W. : Un mot qui me tient à cœur dans ce que vous venez de dire est celui d’équilibre. Nous ne voulions pas d’un film étriqué du point de vue esthétique. Nous avons par conséquent travaillé, tant au plan des personnages que des cadrages, à varier les perspectives. Lorsque vous prenez un tel risque, évidemment, vous êtes heureux d’entendre que le résultat atteint un certain équilibre. La progression est un élément décisif en la matière. La scène dont vous parlez, où Jess est remplacée par un autre adolescent, n’aurait pas pu apparaître dans les dix premières minutes du film. Mais, puisque le spectateur a eu le temps de s’habituer aux choses de plus en plus étranges qui surviennent, il peut finalement les accepter. Tous ceux qui ont lu le scénario m’ont demandé si cette scène fonctionnerait. Pour ma part, j’y tenais vraiment. Il est évident que ce « remplacement » aurait pu être coupé au montage. J’ai cependant la conviction qu’il permet de revoir la scène sous un angle complètement différent. Ce détail ouvre notre attention, notre sensibilité. Évidemment, si vous voulez savoir qui est exactement ce personnage, il vous faudra lire le roman. Mais ce que retrouve le film n’est rien qu’une sensation très familière : il arrive fréquemment, alors que nous parlons à quelqu’un, qu’un souvenir parasite notre conscience immédiate. Pour un bref instant, nous sommes ailleurs. Et notre pauvre interlocuteur se retrouve à porter le poids de notre histoire. En tant que spectateur, même si vous ne savez pas qui est le personnage qui apparaît, où de quel point de vue se produit la scène, il y a là un élément psychologique courant qui, je pense, a pour conséquence de nous rendre plus attentif à ce qui passe. À mesure que nous côtoyons les gens, l’impression grandit en nous de les connaître totalement. Or, il y a dans ce moment comme une manière de nous rappeler qu’une part de mystère durera toujours.

La perte inscrite dans l’espace (In the family).
Spectatrice : Aviez-vous peur que certaines scènes, comme celles que vous venez d’évoquer par exemple, où des émotions contradictoires sont en jeu, s’avèrent trop difficiles à réaliser ?
P.W. : Les scènes les plus difficiles à tourner ne sont jamais celles auxquelles nous pensons au moment de la préparation du tournage, curieusement. La plupart des changements que je fais vont dans le sens de la simplification. Je vais vous donner un exemple. Nous pensions tourner en deux plans la scène où John rentre chez lui après avoir bu avec son collègue – un plan sur chaque comédien, avec une caméra qui, d’une certaine manière, danserait avec eux. Nous avions passé pas mal de temps à réfléchir à tout cela. L’espace étant très étroit, au moment des répétitions, je me suis juché avec le chef-opérateur sur une boîte afin de laisser le passage libre au acteurs. Nous avons alors réalisé deux choses. D’une part, la scène était très intéressante vue depuis ces perchoirs. Et par ailleurs, les gestes des acteurs étaient en fait très ténus, très fragiles. Bouger la caméra les aurait noyés. Nous avons donc choisi de simplifier la scène.
Y.R. : J’aimerais revenir sur votre recherche de simplicité et d’équilibre, ou peut-être, pour utiliser un autre terme, de neutralité. Il me semble que les personnages essaient toujours de comprendre où se situer les uns par rapport aux autres. Cela a à voir avec la question du secret, mais aussi très concrètement de l’espace, par exemple celui de la cuisine, qui est le lieu où tout le monde se retrouve.
P.W. : Si un film est trop équilibré, il est mort. Il faut de la surprise, de la tension, que l’on ne puisse jamais tout à fait deviner ce qui va suivre. Quand je regarde le film – c‘est embarrassant à dire, mais vrai -, je finis par me demander si les acteurs vont réussir à jouer leur scène correctement. La tension naît du fait que je ne les dirige pas au millimètre. Leurs gestes peuvent donc me surprendre. Cela me semble le révélateur qu’il se passe effectivement quelque chose. Parfois, vous regardez un film et vous devinez immédiatement que le personnage va aller s’asseoir sur telle chaise. Celle-ci est éclairée, le cadre oriente notre regard vers cet endroit et ainsi de suite. Comme mon cadre est en général plus vaste que nécessaire, je laisse une marge aux acteurs pour habiter l’espace. Si quelque chose ne fonctionne pas dans la scène, cela se traduit immédiatement dans leurs déplacements, leur rapport au lieu. L’espace est trop souvent négligé comme élément de sens pour comprendre les personnages. Quant à la cuisine, oui, beaucoup de mes scènes s’y passent car c’est dans ce lieu que se joue la vie des familles.
Y.R. : Dans une scène où deux personnages contemplent et commentent une œuvre créée par le père de Gordie, ils remarquent l‘ambiguïté qui existent entre deux termes italiens, l’un évoquant le soleil [sole], l’autre la solitude [solo]. Vos personnages sont tiraillés entre la solitude et le soleil, le repli et l’ouverture, la solitude et la famille. Et pour retrouver le soleil, cette famille a besoin d’un élément extérieur, de quelque chose d’hétérogène, en l’occurence d’un personnage extérieur, Gordie et son histoire, une autre histoire.
P.W. : Chaque membre de la famille pense rendre service aux autres en gardant ses souffrances pour lui. Or justement, la plus belle chose à faire, c’est partager ses peines. Quand on vit sous le même toit, il n’est de toute façon pas aisé de se cacher des autres, notamment entre parents et enfants. Cela finit par instaurer une distance entre les êtres.
Avi : La fin est étonnante. Est-ce un vrai happy-end, ou nous invitez-vous plutôt à imaginer, avec tous ces contrastes et ses difficultés, ce qui pourrait se passer ensuite dans cette famille ?
P.W. : Pour répondre à votre question, il faut revenir sur les différentes étapes qui mènent à cette fin. Certains personnages ont le sentiment que les choses empirent. Quand Ricky se confesse, nous pouvons penser que la situation se dégrade. De même lorsque les parents commencent à se disputer. Mais il y a aussi des étapes où l’autre est entendu, où la générosité se manifeste. J’aime par exemple beaucoup cette scène où, lorsque la famille se retrouve à table après le départ de Jess, la mère partage, en accord avec le père, l’idée d’une cérémonie funéraire pour le bébé. Nous voyons alors que les enfants n’attendaient que cette parole, et que tous éprouvent un profond soulagement. Le film construit différentes étapes, différentes trajectoires émotionnelles. Il ne s’agit pas simplement de montrer que tout va de mal en pis, mais plutôt de chercher comment les choses s’améliorent à travers des processus toujours profondément complexes. La fin n’est donc pas selon moi purement et simplement heureuse, mais elle est assurément chargée d’espoir. Au minimum, nous pouvons dire qu’il y a plus d’attention et de compréhension entre les êtres.
Dominique : L’histoire se passe dans l’état de New York. Pourriez-vous nous parler de cette région ? Pourquoi l’avoir choisie ?
P.W. : Le film a été tourné dans un village situé à une heure de route au nord de la ville de New York. C’est aussi là que se passe le roman. C’est un endroit merveilleux, il y a dans ses proportions quelque chose qui donne l’impression qu’il a été construit pour les enfants ! J’aime beaucoup tourner en extérieurs, dans des lieux réels. Pour ce film, le village entier était devenu notre plateau. Cela offre beaucoup de possibilités esthétiques.
Frédéric : Votre film ne s’intéresse pas au contexte social dans lequel s’inscrit cette famille. Était-ce selon vous nécessaire pour que nous puissions entrer dans leurs vies intimes ?
P.W. : Il me semble que l’essentiel de nos émotions proviennent du contexte familial et que beaucoup des problèmes que nous n’y réglons pas se répercutent en-dehors. En s’intéressant au foyer, nous revenons à la racine même de ce qui nous constitue. C’est en outre un lieu idéal pour envisager un entrelacement de relations. Les familles sont contraintes de partager l’espace. Il suffit donc d’une cuisine, pour faire un film.
Dominique : J’ai été très séduite par certains visages, certaines présences. Comment avez-vous choisi vos acteurs ?
P.W. : Je ne connaissais que Trevor St-John, qui incarne donc le père et a joué également dans mon premier film, In the family. Le processus du casting a suivi un cours assez ordinaire. Avec ma directrice de casting, nous avons rencontré une quinzaine de personnes pour chaque rôle. Ce qui est peut-être moins courant est que j’ai passé beaucoup de temps à sélectionner ces quinze personnes, à étudier leur profil avant même qu’elles ne se présentent pour jouer. Ensuite, je me suis interrogé sur l’étendue de leurs capacités. Mais le plus important pour moi est de comprendre comment la relation avec un acteur peut évoluer. Même si l’interprétation est maladroite, mal dégrossie au moment des essais, ce qui compte réellement, c’est que je puisse déceler une marge de progression et une entente.
Spectatrice : Le film est très graphique et développe un jeu très fort avec le grain. Comment avez-vous abordé cet aspect du film, cette matérialité très particulière ?
P.W. : Je n’avais jamais tourné en pellicule auparavant. Dans la vie, lorsqu’on découvre quelque chose, on se pose des questions de base. En l’occurrence : qu’est-ce que la pellicule ? Qu’est-ce que le grain ? Ma réponse a été simple : c’est un outil. La plupart des caméras sont aujourd’hui vendues selon l’argument de la netteté, de la précision du rendu. Avec le grain de la pellicule, nous avons cependant un dynamisme naturel de l’image, une forme de langage avec laquelle jouer. Nous avons ainsi mélangé différents supports, le super-8 et le super-16, mais avons également travaillé sur la matière même du super-16. Je crois qu’il se passe quelque chose d’extraordinaire lorsque l’on confronte dans un même plan plusieurs grains d’image. Pour moi, cela a autant de consistance, de poids cinématographique, que la psychologie. De ce point de vue, l’image numérique manque d’épaisseur.
Confronter dans un même plan plusieurs grains d’image a pour moi autant de consistance, de poids cinématographique, que la psychologie.
Maxime : Le cinéma contemporain est souvent marqué par sa rapidité. Or dans vos films, les émotions se développent lentement. Il y a d’abord toute une phase de perception, de recherche. Les émotions sont comme des mines cachées dans le sol, prêtes à exploser, à jaillir.
P.W. : Contempler puis éprouver de l’émotion, presque à retardement, est le processus même que je vis dans mon existence quotidienne. Je suis quelqu’un de lent, et c’est sans doute pour cela que mes films sont longs. Il me faut du temps. Mais lorsqu’enfin je comprends quelque chose, il y a effectivement ce caractère explosif de la révélation. J’essaie de retrouver cela dans mon travail.
Y.R. : J’aimerais, pour finir, revenir sur une phrase que vous avez écrite dans votre journal de tournage, Post Script. Vous dites que vous ne vous sentez pas en tant que cinéaste comme un prophète, mais plutôt comme « un moine catapulté dans une course olympique ». L’image est amusante, frappante.
P.W. : Aux États-Unis, les cinéastes sont censés avoir une « vision ». C’est sans doute le cas pour certains, mais en ce qui me concerne, je n’ai que des idées que je mets à l’épreuve. C’est très différent d’une « vision », qui implique une totalité, une complétude. Plutôt que d’envisager la réalisation sous la forme d’une révélation intégrale de la vérité, je préfère évoquer le travail d’étude du moine, qui comprend progressivement les choses. J’ai besoin de beaucoup de solitude et de temps pour clarifier mes idées. Puis arrive soudain le moment du tournage. Je dois alors faire face à des nuées et des nuées de questions. L’excitation est grande, mais il me semble que si je prends une décision intuitive dans ces conditions-là, celle-ci ne sera juste que parce qu’elle aura été le fruit de ma réflexion antérieure, mûrie dans la sérénité. L’une des meilleures choses qu’un cinéaste peut faire sur un plateau est parfois tout simplement de ralentir le mouvement, de prendre deux secondes pour ne pas savoir et réfléchir. Alors il sera possible de trouver une réponse juste.
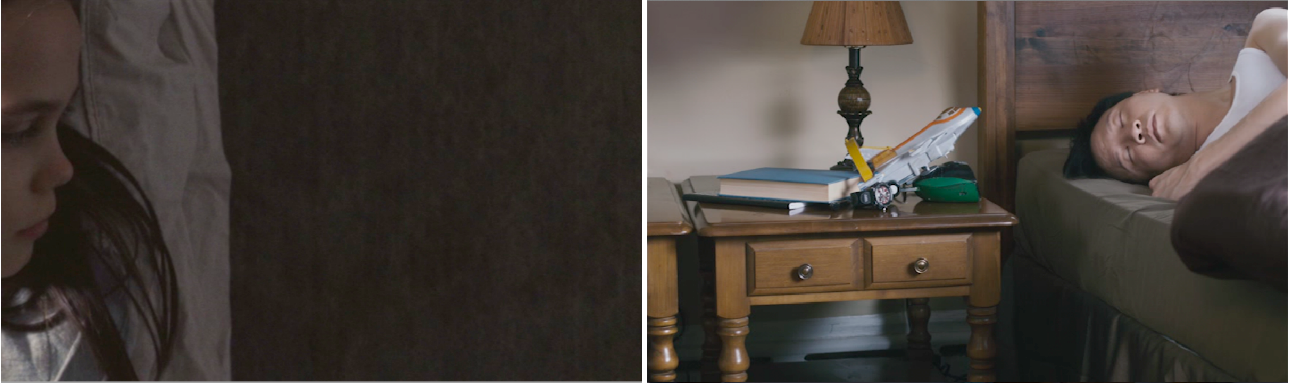
L’absence (Les Secrets des autres et In the family).