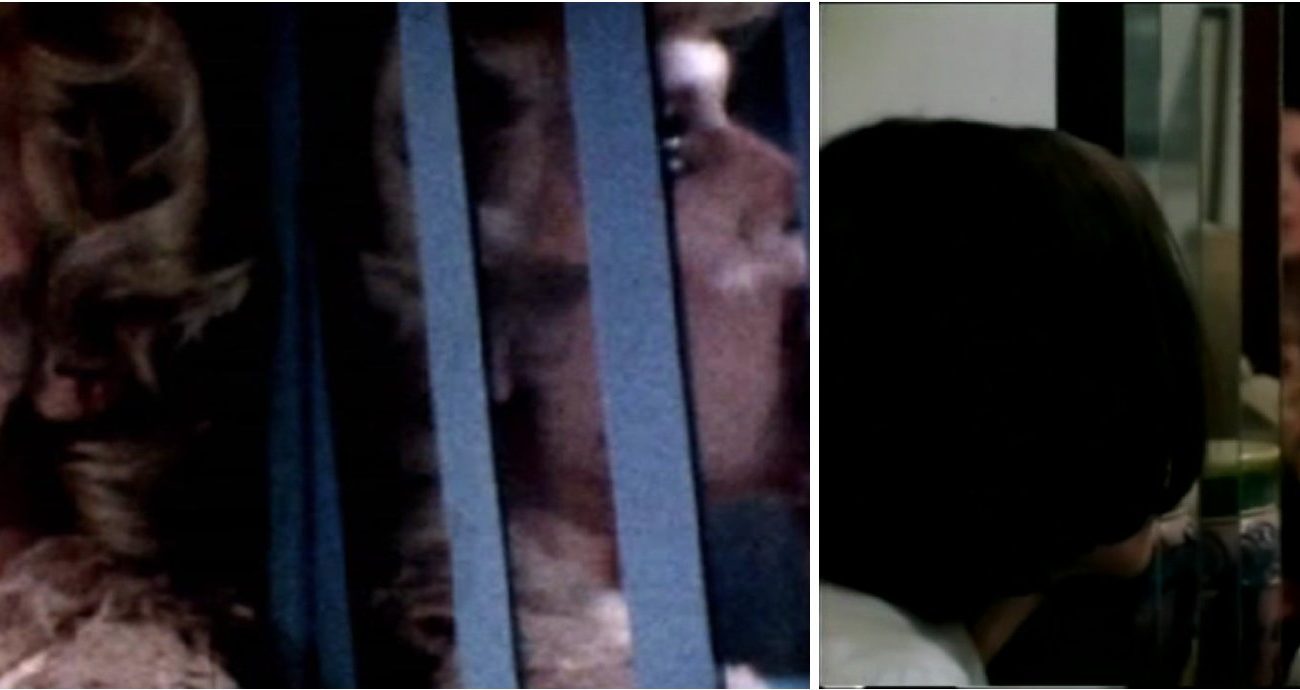Mercredi 18 janvier sort le nouveau film d’Ado(lfo) Arrietta, Belle Dormant, avec un casting très riche : Niels Schneider, Agathe Bonitzer, Tatiana Verstraten, Mathieu Amalric, Ingrid Caven, Serge Bozon, Andy Gillet…
Projeté au Café à partir du 18, le film du grand cinéaste espagnol souvent comparé à Jean Cocteau fait l’objet d’une avant-première exceptionnelle ce vendredi 13, à 20h, en sa présence et en celle de N. Schneider, A. Bonitzer, I. Caven et Nathalie Trafford, productrice.
Le lendemain, à 14h, le Café projette le film le plus célèbre, et sans doute le plus beau, d’Arrietta, Flammes (1978), dans lequel Caroline Loeb — future interprète de C’est la ouate — est une jeune femme fascinée par l’érotisme des pompiers. Le film sera présenté par le cinéaste et par Jean Narboni qui, à sa sortie, a écrit à son sujet dans les Cahiers du cinéma un texte qui a fait date.
Voici, pour accompagner cet évènement l’introduction, par Philippe Azoury, au texte d’entretien avec A. Arrietta qu’il a publié en 2011 chez Capricci sous le titre … Un morceau de ton rêve (Underground Paris-Madrid, 1965-1995).
Toute rencontre relève du sortilège. Visiblement, celui qui entoura la fabrication de ce livre d’entretiens avec Adolpho Arrietta porte aussi en lui sa propre température. Il faut avouer ici que tout ce qui s’est dit lors de cette conversation entamée le 23 juillet 2009 au comptoir du bar de l’Hôtel de las letras à Madrid pour ne s’achever que le 26 juillet dans l’après-midi, à la terrasse du premier étage d’une respectable cafétéria surplombant la Plaza de Colón, l’a été sous une température constante de quarante degrés. Il est possible qu’à cette cuisson-là rien ne soit tout à fait pareil. Possible aussi qu’à cette cuisson-là, la pensée demande de la légèreté. Mais, par ailleurs, cette chaleur, comme la fraîcheur nécessaire qu’elle appelle, est propre à Adolpho, personnage indolent et délicieux.
Un jouisseur doux.
Il se trouve, sinon, que le film d’A. Arrietta qui nous sert ici de fil rouge pour parler de sa vie, de sa méthode, de ses amitiés et de son cinéma s’appelle Flammes. Il a la réputation d’être incandescent. On l’aime pour ce qu’il est : intime, incendiaire. Un petit Fahrenheit 451 à l’adresse des jeunes filles à très forte tendance fétichiste. Et qui ont très chaud lorsqu’elles se mettent à rêver au pompier. Barbara, double possible d’A. Arrietta, croit au pompier comme les enfants croient au Père Noël : avec appétit et sans l’ombre d’un doute.
Enfant, un de mes mots préférés était « Canadair ». Ce mot était aussi chaque été la source d’une peur démesurée : celle d’être aspiré par un Canadair alors que je nageais en Méditerranée et d’être jeté, à quelques kilomètres de là, dans les flammes d’une pinède dévastée.
Ma grande hantise aujourd’hui est que ce livre soit à son tour un Canadair. Qu’il ait, comme toute tentative d’explication vaguement poussée, franchi la barre qui sépare un savoir éclairant, maintenant à chaud le mystère de l’œuvre, et l’erreur irrattrapable de vouloir tout dire, trop en dire, au risque, tel l’avion pompier, de noyer le film sous une parole qui en éteindrait la chaleur et viendrait en éclabousser les ombres.
« On ne voit rien tandis qu’on voit. On ne comprend pas tandis qu’on comprend tout », disait Marguerite Duras à propos d’Arrietta. Pour cela, on peut faire confiance à Adolpho. Il tient ses ombres. Il fait partie de cette fratrie de cinéastes (Cocteau en est le maître) pour qui le cinéma commence là où le travail cède le pas à l’invisible, à la magie, à l’indicible. Cela rend incontestablement la tâche de l’interviewer difficile, et pire encore si l’on a, en bon crédule, fait le voyage Paris-Madrid dans l’espoir déraisonné de savoir comment et pourquoi donc le cinéaste Arrietta a fabriqué ce qu’il convient aujourd’hui d’appeler une œuvre. Mais comme A. Arrietta est un artisan, qui fait ses films à la main, il sait qu’il peut se laisser aller sans risque à dévoiler des choses concrètes : elles ne mettent pas en danger la source secrète qui irrigue son cinéma. « Un prestidigitateur ne révèle jamais ses tours », m’avait dit une fois Philippe Garrel. Il n’en a jamais été question, Adolpho.
Arrietta fait partie de cette fratrie de cinéastes (Cocteau en est le maître) pour qui le cinéma commence là où le travail cède le pas à l’invisible, à la magie, à l’indicible.
À l’en croire, Adolpho Arrietta (lequel, en ce mois d’août 2009 demande que nous l’appelions A. Arrietta, ce que nous ne saurions lui refuser), n’a jamais travaillé de sa vie. Entendre par là, que le cinéma pour lui, comme la peinture qu’il pratique depuis l’enfance, n’est surtout pas de l’ordre du travail, du métier, mais de l’inspiration, de la respiration. Quand il se sent vivre (et ces choses-là, on le sait, ça va, ça vient), A. Arrietta peint, filme, ou tout simplement s’amuse, sort, passe ses nuits dehors, armé parfois d’une caméra, ou partant à la rencontre de gens qui pourraient l’inspirer et devenir en retour ses acteurs. Les films se font, comme naturellement, à l’intérieur du mouvement même de la vie. Ils ne sauraient néanmoins se résumer à cela. On s’en voudrait de les résumer à cela. Surtout quand on soupçonne cette apparente facilité à lier les films, la vie et les amitiés d’avoir beaucoup desservi non pas le cinéaste (qui en avait tiré une sorte d’anti-méthode magnifique et fragile), mais le discours qui aurait dû s’écrire autour de ses films. Dans un magnifique article qu’il lui avait consacré, en introït à un long entretien accordé aux Cahiers du cinéma, et intitulé (en référence à Cocteau) « le Cinéma Phénixo-logique d’Adolfo G. Arrieta », Jean-Claude Biette parlait d’un «dispositif qui mime la négligence – et cette négligence exaspère ». Biette pensait bien sûr à l’immense malentendu que rencontrait déjà ce cinéma de la plus belle désinvolture, qui a fondé sa recherche sur l’expression « à l’état de film du grand désordre rarement exploré de la vie ». Tâche beaucoup moins aisée que certains ne l’imaginent…
Né à Madrid d’une famille bourgeoise et fortunée, A. Arrietta découvre le cinéma à sept ans alors qu’on lui offre un « Cinematik » avec lequel il projetait des dessins animés avec juste deux mouvements. À treize ans, alors qu’il peint de plus en plus sérieusement, encouragé par sa mère, elle-même ancienne pianiste prodige, il découvre Orphée au ciné-club de l’institut français de Madrid, ainsi que Le Cuirassé Potemkine. Avec une caméra Super 8, il commence à réaliser des films de voyage. À vingt-deux ans, en 1964, il réalise un premier court-métrage, El Crimen de la pirindola (Le Crime de la toupie), avec pour acteur son ami Xavier Grandès, qui sera dès lors de tous ses films. Le meurtre d’un frère en est le prétexte pour capter quelque chose de chaotique, une adolescence du Madrid franquiste, où tourner en rond, faire la toupie est une autre façon de se taper la tête contre les murs. De ces plans hachés, tout en colère sourde, excités devant l’idée du mal et innocents à la fois, se met en place un monde onirique non par gentillesse, mais par survie — la fuite, en avant toute ! L’Ange, pauvre ange, a des ailes en papier blanc. La Imitación del ángel (Imitation de l’ange), tourné deux ans après (et qui demandera un an et demi avant d’être achevé, pour une durée de vingt minutes), est un film plus cruel encore (et que Biette qualifiait d’« extraordinaire ») : un ange dérisoire y traîne ses ailes de papier dans un Madrid grand-bourgeois, où les familles se mentent à elles-mêmes (la mère trompe le père avec un voleur à qui elle demande d’étrangler le fils) et refusent en bloc les êtres différents. Sans plus de précision, ce brûlot qui doit à Rimbaud autant qu’à Vigo (et préfigure tellement Théorème) prépare à un exil : ce sera Paris, où Adolpho et Xavier habitent, à l’Hôtel des Pyrénées, situé rue de l’Ancienne-Comédie, à deux pas d’Odéon, du boulevard Saint-Germain et de la rue Saint-Benoît, où vit Marguerite Duras, qui découvre, abasourdie, à Pesaro, Le Jouet criminel, film qu’A. Arrietta tourne en 1969 avec Florence Delay et Jean Marais. Une « distribution » qui n’a pas pour autant modifié sa méthode (les films sont autoproduits, réalisés sans scénario, le montage s’effectue en parallèle au tournage). « Je crois, confiait-il aux Cahiers du cinéma en 1978, que ces films étaient faits dans une excitation très forte et que ça enlevait la préoccupation de l’argent, les préoccupations matérielles. Parce que si j’avais pensé, avant de tourner, à tout ça, peut-être n’aurais-je jamais tourné, c’était une folie de faire les films comme ça.»

Le Château de Pointilly (Adolpho Arrietta, 1972) / Tam Tam (Adolpho Arrietta, 1976)
Dans l’appartement de Duras commence un autre film, une autre folie inspirée de Sade, Le Château de Pointilly, avec pour acteur Dionys Mascolo et une jeune fille du Flore, qui n’a encore jamais joué : Françoise Lebrun. Une petite fille est élevée par son père, avec pour seule interdiction de ne jamais s’approcher du château de Pointilly. La fille quitte le père pour la grande ville, s’y sent désœuvrée, y rencontre un homme (Xavier Grandès) qui lui donne rendez-vous au château de Pointilly. De près ou de loin, le père gouverne sa vie jusqu’au bout, et Pointilly sera l’endroit sombre de son initiation. Duras écrit un texte pour présenter le film, qui dit déjà les enjeux des deux films à venir d’Arrietta (Les Intrigues de Sylvia Couski, et Tam Tam) : « Ainsi, lorsque la jeune fille se mêle à la vie de la cité, marche dans ses rues, boit des cafés, cherche un appartement, etc., nous la percevons en même temps dans cet ailleurs dont elle nous a parlé — à l’ombre du père dont elle est séparée. Autrement dit, la jeune fille en chair et en os se promène comme son principe même se promènerait s’il était visible à l’œil nu. […] La jeune fille ne change pas la cité, c’est la cité qui la change. La magie, c’est cela : c’est le concret qui, avec toute sa charge, de lui-même, s’abstrait. La pureté du récit d’Arrieta à mon avis est d’une rigueur si grande qu’il me paraît difficile de la dépasser.» Arrietta ne la dépassera qu’en filmant désormais des êtres plus purs encore, plus innocents encore, des anges nouveaux tombés sur Paris de la planète Camp, dans le sillage de Mai 68 : ses amis travestis, les Gazolines. Dans Les Intrigues de Sylvia Couski, un artiste (Howard Vernon) dont la sculpture disparaît quelques jours avant le vernissage d’une grande exposition demande à un travesti (Marie France, travesti qui dansait à l’Alcazar) de prendre la place de l’œuvre d’art dérobée. Dans Tam Tam, un écrivain (Xavier Grandès) refuse de quitter New York pour se rendre à la party qui a lieu pour le lancement de son livre à Paris. Son absence devient le lieu de toutes une série de crises ouvertes et de numéros baroques : certains chantent, d’autres pleurent, se battent ou se draguent. On raconte l’histoire terrible des tam-tams (Tam Tam est aussi le titre du livre) et leurs pouvoirs magiques et terrifiants (provoquer des ouragans). Le vide du créateur a laissé place à la magie et à la folie. « Nous vivons dans cet underground encore et toujours clinquant comme un jeu de mots de Lacan, rutilant comme du velours cramoisi sur un brocart de Venise, beau comme la princesse Salomé, celle qui refusa la moitié d’un empire pour obtenir du tétrarque la tête d’un homme sur un plateau d’argent », écrit en 1976 Alain Pacadis dans Libération (quotidien où écrivent nombre des Gazolines et de membres du FHAR (Front homosexuel d’action révolutionnaire), tous acteurs des Intrigues ou de Tam Tam : Hélène Hazera, Michel Cressole, Marc Raynal, Paquita Paquin…).
L’« après-Mai », l’« après-Mai » des faunes, des folles, est à son maximum d’intensité. On sait donc désormais autour de quoi tournent les films d’Arrietta : des artistes rêvent de devenir à leur tour des œuvres d’art, admiratifs encore de ceux qui ont pris le corps comme site d’une nouvelle création, refondant jusqu’à leur identité. En 1978, surprise… Comme s’il voulait dépasser l’état même dans lequel il avait mis lui-même son cinéma, A. Arrietta tourne Flammes. Il n’est plus le producteur (l’INA), même s’il reste derrière la caméra (le débutant Thierry Arbogast est à la lumière), Saint-Germain n’est plus son territoire, un scénario entrepris pour une fois des mois à l’avance (et qui s’est appelé tour à tour «Buenas noches mi amor», puis «Dans les bras du pompier fantôme»), il réapprend ses chers thèmes, l’angélisme, le jeu et le travestissement, le fétiche et la pyromanie propre au désir, mais choisit de situer ce monde fantasmatique dans le désenchantement d’une vielle demeure à la campagne, un endroit hors du monde et hors du temps, un manoir littéraire et fantomal : une jeune fille (Caroline Loeb) échappe à son père (Dionys Mascolo) en faisant le tour du monde, elle revient, s’enferme chez elle et retrouve ses vieux rêves de petite fille, qui tous tournent autour du déguisement de pompier. En feu, elle appelle les pompiers, en capture un (Xavier Grandès) et s’enferme avec lui durant des jours, jouant et jouant encore. Autour d’elle, bientôt, tout le monde (père, frère, préceptrice, ami de passage…) se cherchera un compagnon avec qui jouer. Ou jouir — puisque c’est ici la même chose.
Jouer… Si, se décrivant, A. Arrietta parle de quelqu’un qui n’a jamais travaillé, qui a joué en créant, il est aussi l’exact contraire d’un cinéaste que le cinéma ne travaillerait pas : Flammes est un film habité, hanté par ses fantasmes, visité par ses fantômes, porté par le souvenir d’un héritage littéraire décadent et ramené à la vie par une grâce cinématographique divisée de l’intérieur, double : à la fois sombre, gorgée de ténèbres et joueuse. L’erreur serait de croire que, parce que les habitants de la maison en feu de Flammes (d’un feu bien suave) ont l’habitude d’avoir des jeux de cartes à la main, tout ici serait fruit du hasard. A. Arrietta n’a jamais fait que mimer la désinvolture. La grâce de sa mise en scène est née d’une exigence totale, portée envers une forme qui vise l’ascension, le léger (résultat : on s’y amuse autant que s’amusèrent ceux qui le firent), alors que cette mélodie a demandé une année complète de montage avant de trouver son point d’équilibre. Duras avait raison de parler, dès Le Château de Pointilly, de la « rigueur » d’A. Arrietta : il ne s’agit que de cela. Cela vaut pour ses films des années 1970, comme pour ceux, plus rares, des décennies qui vont suivre : Grenouilles (1983), Merlin (1991).
Flammes, faux film calme, court au danger comme tout film fétichiste : il ne peut que se brûler à son propre jeu. Modifiant la méthode mais ne changeant rien au fond de l’affaire, il est le plus achevé des Arrietta, celui qui rassemble les différentes périodes de son œuvre, et dont l’assurance dans le geste aurait dû rectifier ce faux malentendu né de ses deux précédents films, ceux faits de façon presque documentaire dans le Paris travesti et underground de Saint-Germain au mitan des années 1970 : Les Intrigues de Sylvia Couski et Tam Tam. Des films beaux de partout, beaux par la méthode spontanée qui les a fait naître, beaux par l’étrangeté divine des corps qui les traversent, beaux par leur approche naturelle et en cela d’une intelligence rare de la transsexualité (elle ne fait pas une seconde problème ni même question, chez A. Arrietta, où les corps sont toujours à réinventer ; il en va de la survie de chacun, qu’il soit hétérosexuel, homosexuel, travesti, transsexuel, ange), mais face auxquels la critique de l’époque (clivée dans un débat politique ou social) n’a souvent retenu que les éléments en surface : mondanité, dandysme, snobisme et, pire que tout, l’insolence, sinon l’affront, envers tout professionnalisme. Elle croyait avoir affaire à une forme d’amateurisme, notion qui n’a jamais vraiment eu bonne presse en France et qui, dans le cas d’A. Arrietta, tapait totalement à côté de la plaque : il est le contraire de l’amateur. Si son cinéma est un château, c’est le château du pointilleux. De la plus exacte méticulosité. Mais comme c’est aussi un édifice du silence et de l’ombre, un château du pointillé, du non-dit, de la discrétion et du murmure, on ne vit rien venir. Et continuant à se fier aux apparences (celles d’un cinéaste qui ne travaille pas, ou qui se réveille tard pour rejoindre sa clique au Flore avant d’aller filmer des fêtes), on se pressa de refermer le cas Arrietta en accolant à sa réputation un mot qui fit long feu : «artificialité».
Si le cinéma d’Arrietta est un château, c’est le château du pointilleux. De la plus exacte méticulosité. Il est le contraire de l’amateur.
Un beau mot, mais quand il est articulé dans une jolie bouche. Les bouches qui condamnèrent Arrietta comme cinéaste superficiel ne devaient pas avoir
les traits très harmonieux. Ni les yeux grands ouverts : elles n’ont pas vu que, dans la totalité de
sa démarche, A. Arrietta offrait au cinéma la chance d’un croisement inédit entre la plus grande discipline (courts comme longs, ses films ont une tenue fière, musicale, presque mathématique, née d’un montage qui parfois a pu prendre deux années complètes, Biette parlait d’un «dispositif têtu»…) et le plus libre, le plus désiré des désordres.
Arrietta, appréciant un temps que les apparences soient trompeuses, a joué jusqu’au bout son rôle
de cinéaste qui ne veut surtout pas entendre parler d’intentions, trouvant ce genre de déclaration
à l’emporte-pièce dépourvu d’élégance. Il veut bien jouer, tout le temps et à tout, mais pas à ce jeu-là (ennuyeux à mourir et d’une prétention sans égal)
du cinéaste concerné et admiratif de ses propres prouesses. Il laisse ça aux autres. Résultat, il est aujourd’hui, en Espagne comme en France, méconnu, passion discrète de quelques-uns, éparpillés à travers le monde. Son nom ne figure pas assez à côté de ceux de ses frères en cinéma : Eustache, Garrel, Rivette, Schroeter, Warhol, Anger, Smith. Ses films, comme ceux de Biette, Vecchiali, Guiguet, restent difficiles
à voir et manquent toujours plus ou moins à la liste, même chez les cinéphiles les plus sérieux.
Qu’ils aient fait la couverture des Cahiers du cinéma (qui, à travers Fieschi, Narboni, Biette, le soutenaient depuis 1968), aient été défendus longuement et ardemment par Marguerite Duras, par Alain Pacadis, qu’il ait été en 2003 un des héros du Paris ne finit jamais (Paris no se acaba nunca) de l’écrivain Enrique Vila-Matas (ayant fait en retour quelques caméos dans Tam Tam et dans Flammes) n’y a rien fait. Qu’il ait fait jouer des acteurs et actrices aussi prestigieux que Jean Marais, Dionys Mascolo, Anne Wiazemsky, Florence Delay, qu’il ait découvert au cinéma Françoise Lebrun (deux ans avant La Maman et la Putain), qu’il ait en personne joué, le temps d’un plan inoubliable (une grand-mère tenant dans les rues de Paris la main de son petit-fils de sept ans), le rôle de chef opérateur sur un film d’Eustache (Odette Robert), que Warhol demandât régulièrement à voir ses films, non, cela non plus n’a pas fait rempart à cette méconnaissance. Il y a, du côté des images, des persistances dont on se passerait volontiers. A. Arrietta n’a jamais voulu entrer dans aucun carcan. O.K. On mesure aujourd’hui l’ampleur du gâchis.
Il ne faut pas croire Arrietta quand il dit qu’il n’aime pas Le Château de Pointilly, un de ses plus beaux films, parce qu’il en émanerait une soi-disant tristesse, comparable selon lui à une forme de lourdeur. Il faut entendre là, murmurée, la fierté d’un cinéaste qui sait pertinemment que, s’il avait donné au cinéma d’auteur des années 1970 deux ou trois films de la noirceur de Pointilly plutôt que Les Intrigues ou Tam Tam, ces films de la vitalité folle, de l’amour fou et de l’humour folle, qui ne cédaient à aucun romantisme artistique français, mais au contraire avaient trente ans d’avance sur Paris, il jouirait aujourd’hui d’une tout autre reconnaissance. La France, décidément, a du mal avec les jouisseurs. La critique est nue devant l’humour acerbe. Et l’Espagne, de son côté, ne veut en entendre parler que sous la bannière bigarrée de la Movida. Une Movida qu’il annonçait, un peu seul, et qu’il a ratée seul (quand elle a éclos à Madrid, il était en lutte avec cette ville, et quelques accidents de vie autour de lui ne lui donnaient pas le cœur à la fête).
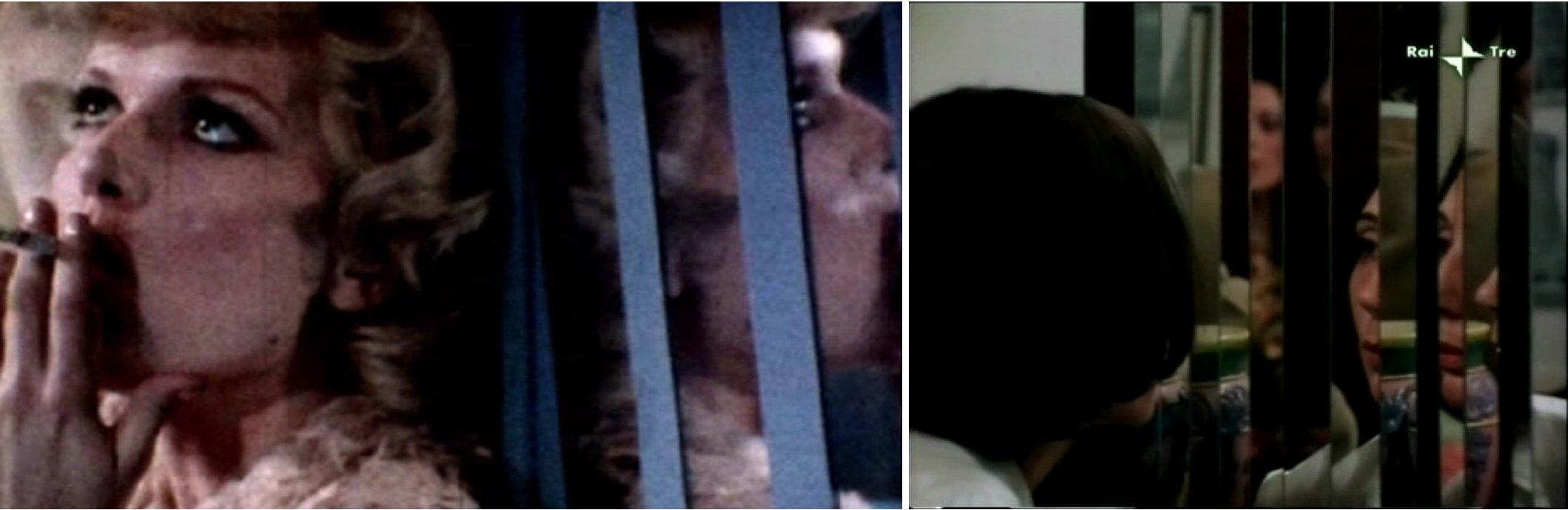
Les Intrigues de Sylvia Couski (Adolpho Arrietta, 1974) / Tam Tam.
Durant le long entretien qu’il a eu la gentillesse de nous accorder, A. Arrietta a montré une seule fois un signe d’incompréhension totale. Je lui posais la question anodine du documentaire : s’il avait, en employant de vrais pompiers, saisi la perche du réel. Il ne voyait pas de quoi je voulais parler. Pour lui, les pompiers étaient comme des acteurs : il y avait la caméra et eux, après tout, étaient déguisés. Costumés. J’avais oublié que dans le délire fétichiste c’est le monde entier qui est ramené au fétiche. Ce dernier est comme un vortex qui avale le monde. Le réel n’est plus qu’un fragment du fétiche, un fragment que le fétiche arrache au néant.
« Fétichiste ? Pour ne pas l’être, il faudrait vivre
seul sur une île déserte », concluait l’écrivain Pierre Bourgeade à la fin d’une vie consacrée aux fétiches. Narboni, dans le texte qu’il avait écrit sur Flammes, avait déjà souligné cela : que pour Barbara, le jeu est sérieux car le jeu avec le pompier est « du même côté que le réel ». Gentiment, A. Arrietta m’a proposé une autre définition du réel, la sienne, où les rêves et les fantasmes, dans la mesure où ils ont une existence, font partie intégrante de la réalité. Le documentaire chez Arrietta n’a pas à tourner le dos à la magie. Je m’aperçois seulement maintenant que ma question était mal posée. Dans la mesure où ce qu’il entend par « réel » rejoint la définition qu’en donnait Lacan — « le réel commence là où le sens s’arrête. » —,
ce n’est pas le réel qui lui fait horreur, il a d’ailleurs suffisamment bien enregistré tout au long des années 1970 un air de Paris qui a existé bel et bien, celui des désirs que Mai 68 avait lâchés dans la ville (désirs qui n’entendaient pas rentrer trop vite à la niche, quoi qu’en pensent les gardes rouges). Non, ce qui horrifie le cinéaste Arrietta aussi bien que l’homme (sans parler de l’ancien étudiant en philosophie), c’est l’idée — désespérante — qu’il puisse exister encore, çà et là, une société qui (se) réclame
de la Vérité.
Ce n’est pas par insolence ou par goût pour
la provocation qu’il a voulu filmer les Gazolines immédiatement après les avoir croisées : avec
elles, il rencontrait de plein fouet la concrétisation, baroque, d’une position philosophique qui était
la sienne depuis ses premières années à Madrid : l’identité (un concept autrement moins restrictif que le vrai) se construit de toutes pièces. Elle se fabrique, lentement, méticuleusement, charnellement. C’est
une construction, une œuvre d’art en soi. Wilde, dans ce sens, avait déjà tout dit. On mène sa vie comme une œuvre d’art. Et, chez A. Arrietta, on rêve son identité, on la rêve avec cette même qualité de rêve qui nourrit les films. Raphaël Bassan a donné aux films d’A. Arrietta des années 1970 le qualificatif
de «cinéma onirogène» (formule heureuse et pleine de sens). Cette onirogéneité (mélange d’onirisme, d’originalité et de grâce érogène) trouve son sens dans une quête passionnée pour l’artifice, le costume. Ce n’est pas seulement le fétichisme de l’étoffe, dont parlait Gaëtan Gatian de Clérambault, mais une dimension supérieure : le simulacre. Le simulacre comme fête identitaire, philosophique, dionysiaque. Renversement, dès lors : là où tout est perçu comme faux, rien n’est plus sincère, rien n’est plus juste, accordé. Le travestissement comme commencement du monde.
Le simulacre comme fête identitaire, philosophique, dionysiaque. Renversement, dès lors : là où tout est perçu comme faux, rien n’est plus sincère, rien n’est plus juste, accordé.
Proximité bien sûr avec Eustache, « le faux Belmondo, désormais devenu plus vrai que le vrai, si bien que c’est maintenant l’autre qui est le faux », dont parle Léaud dans La Maman et la Putain. Mais aussi la référence à Zarah Leander, la « chanteuse que les Allemands ont essayé de lancer pour remplacer Marlene Dietrich après son départ…». Se souvenir de ce que rajoutait l’ami d’Alexandre : « Et, comme toutes les imitatrices, elle est mieux que l’original. Elle ne traîne rien derrière elle.» Les travestis de Tam Tam et des Intrigues ne traînent rien derrière eux. Le pompier est innocent, presque simple. Et avec eux A. Arrietta est allé plus loin encore, envisageant le simulacre comme un programme philosophique. Arrietta dit haïr la morale. Sans doute parce que la morale est toujours du côté de la vérité, donc du jugement. Et Arrietta, qui peut témoigner de ce que c’est que de grandir en homosexuel dans le Madrid du franquisme terminal, sait que l’identité est une construction magique, solitaire, née de jeux sur soi-même. Elle est à la recherche d’un partenaire, mais aussi, souvent, elle ne vaut que pour soi. Les personnages qui peuplent les films d’A. Arrietta n’ont que faire d’un jugement, d’un tribunal : ils ont un fantasme à vivre, une identité à redessiner, des affinités électives à tisser, et c’est autrement plus urgent. Ils ont cette idée fixe qui les maintient au monde et leur permet de zigzaguer entre ses gendarmes. Il n’y a pas de vérité, il n’y a que du devenir, diraient Deleuze et Guattari. Devenir-pompier, devenir-statue, devenir-toupie, devenir-créature, devenir-homme-Grenouille, devenir-ange, devenir-génie : des films n’ont raconté que ça. Arrietta fait le cinéma le moins empêché du monde. Un cinéma qui a fait de la métamorphose son site. Deleuze a toujours décrit le devenir comme « innocent ». Cette semblable innocence est aussi celle que décrit, dans les pages d’interview qui suivent, le cinéaste en parlant des travestis, ou de l’héroïne de Flammes, Barbara. Jamais il ne filme le travesti ou la fétichiste en tant qu’identité en crise. Il donne à voir, au contraire, des identités libérées, retrouvées dans le travestissement, ou dans l’amour du costume. Comme il n’y a pas non plus de hasard, mais juste des affinités, l’une des premières études sérieuses à être écrite sur Gilles Deleuze était signée, en 1973, d’une des Gazolines : Michel Cressole, acteur des Intrigues, auteur d’un doctorat sur le faux en littérature et bientôt pilier du service culture de Libération.
La seule sanction qu’Arrietta semble finalement accepter, c’est celle du beau : le plan trouve dans la force esthétique qui en émane sa raison d’être. Les choses qui l’envoûtent lui semblent étranges, ont cette beauté qui sidère le sens et ne trouve aucune explication, ces choses font l’objet de films. Devant un acteur, il cherche la gamme des plans qui le rendent beau. Sa folie ensuite est de vouloir prêter une suite à ces images, à ces flashs, à ces visions, en faire non pas des photographies, autonomes, mais vouloir lire dans le jeu qui s’établit entre deux sidérations quelque chose comme une trame secrète, un monde à côté du monde — toujours plus libre que celui qu’on nous impose.
Mais que fabrique A. Arrietta ? Des images qui disent tout, ne cachent rien et que l’on continue à trouver mystérieuses parce qu’elles sont belles à faire tourner le sens en toupie.
Mais que fabrique A. Arrietta ? Du jeu. Du jeu comme arme.

Flammes.