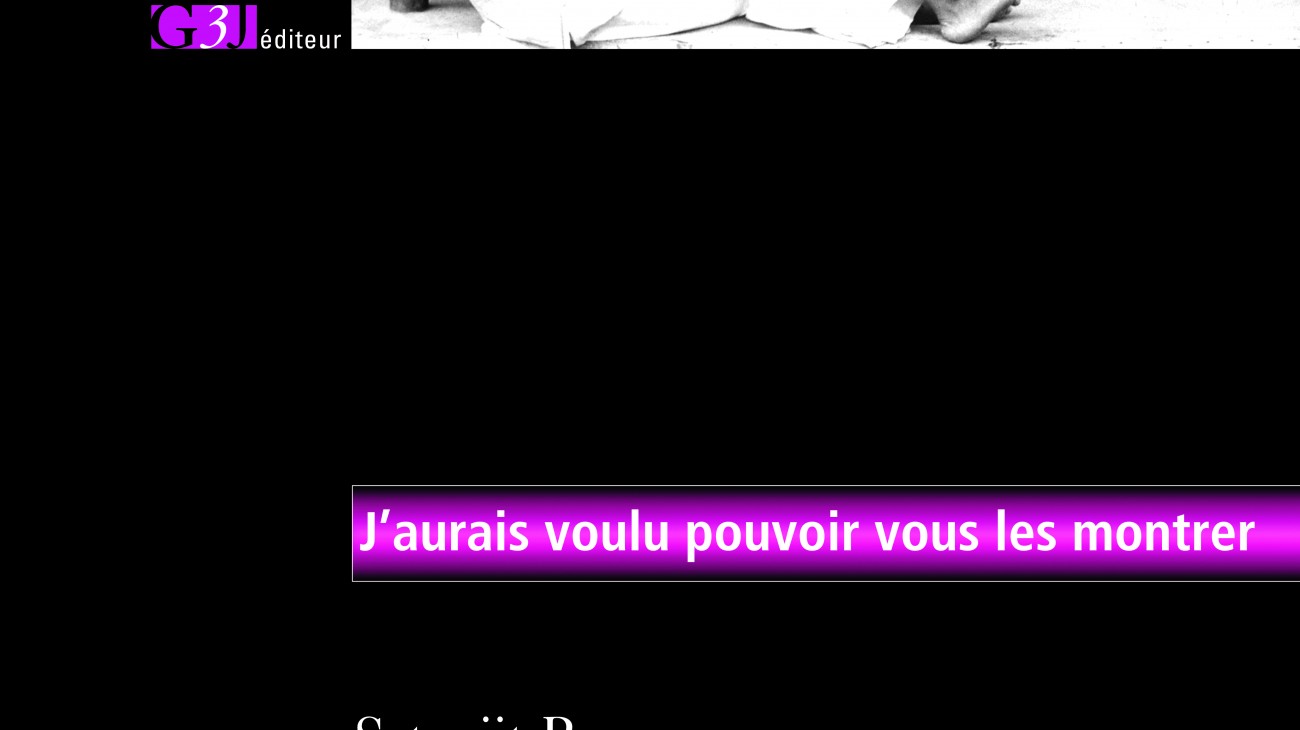Les trois volumes de La Trilogie d’Apu, réalisés par le cinéaste indien Satyajit Ray : La Complainte du Sentier (1955), L’Invaincu (1956) et Le Monde d’Apu (1959), sont programmés, dans des copies restaurées en 2015, sur les écrans du Café des Images jusqu’au mardi 22 mars. Une restauration qui a l’heur de concorder avec la parution prochaine, chez l’éditeur de textes sur le cinéma G3J, de réflexions, inédites en français, rédigées par Satyajit Ray tout au long de sa vie. Extraits de conférences, notes de festivals et dessins sont réunis dans ce précieux recueil intitulé J’aurais voulu pouvoir vous les montrer, à paraître le 16 mars prochain dans une traduction de Christophe Jouanlanne, préfacé par Charles Tesson et Sandip Ray, le fils de Satyajit Ray. Le Café en Revue a le plaisir de vous proposer de découvrir, en avant-première, un texte choisi dans la première partie du livre : « Le métier de cinéaste », où Satyajit Ray évoque notamment le travail d’adaptation des romans qui ont inspiré sa trilogie. Un grand merci à la maison d’édition G3J de nous autoriser à le reproduire.

Tous les grands cinéastes ont réalisé des classiques en partant d’histoires écrites par d’autres. Ainsi Le Monde d’Apu est-il né à partir de situations conçues par Bibhouti Bhoushan lui-même. Et moi, en tant qu’interprète, traduisant ces situations à travers le médium du film, j’ai exercé mon droit de choisir, de modifier et d’arranger. C’est un droit que possède tout cinéaste qui aspire à faire mieux qu’un travail commercial de routine – qui aspire, en fait, à une entreprise artistique. Il peut emprunter son matériau, mais il doit lui donner une couleur grâce à sa propre expérience du médium. Alors, et seulement alors, le film achevé sera son propre film, son film à lui, sans méprise possible, aussi sûrement que le Shakuntala de Kalidasa est celui de Kalidasa et non celui de Vyas1. C’est un fait démontrable qu’une grande majorité des films reposent sur des histoires préexistantes. Il n’y a là rien qui doive susciter l’aversion. En fait, c’est quelque chose d’évidemment admirable, sous deux aspects : le film apporte aux auteurs de ces histoires une source supplémentaire (et souvent inattendue) de revenus, les réalisateurs ont une base tout prête d’où ils peuvent partir. Le réalisateur, en tant qu’artiste consciencieux, doit-il rechigner à l’idée d’utiliser l’idée d’un autre ?

William Shakespeare (dessin de Satyajit Ray)
Non, assurément, parce qu’il est en bonne compagnie. Shakespeare et Kalidasa n’ont pas fait autre chose en littérature. La plupart des grands opéras et des grands ballets reposent sur des idées qui leur préexistaient. À l’exception, peut-être, de Chaplin, qui est obligé de construire ses intrigues autour de l’unique élément de sa propre personnalité (même s’il a, lui aussi, utilisé une idée d’emprunt dans Monsieur Verdoux), tous les grands cinéastes ont réalisé des classiques en partant d’histoires écrites par d’autres. On peut poser la question : puisque la contribution originale de ces cinéastes n’est pas l’histoire ou l’idée, quelle est leur contribution ? Eh bien, on peut tout aussi bien poser la question : quelle est la contribution de Shakespeare dans Hamlet ou de Kalidasa dans Shakuntala ? Ou celle des poètes Vaisnava2, qui n’ont écrit leurs vers qu’à partir d’une seule situation – l’amour de Krishna pour Radha ? Si nous réduisons l’intrigue d’Anna Karénine à l’essentiel, que nous reste-t-il ? La ligne narrative d’un bon millier de romans à deux sous. Mais alors, qu’est-ce qui fait d’Anna Karénine un chef-d’oeuvre ? Avant de répondre à ces questions, revenons un peu en arrière et voyons ce qui guide le cinéaste dans le choix d’une histoire. Si le cinéaste veut en premier lieu gagner de l’argent (une intention parfaitement légitime), il va probablement se tourner vers un best-seller. En en faisant un film, son but sera principalement de coller à la lettre de l’original, parce qu’il se rend compte que le public connaît et aime l’histoire et rejettera toute modification majeure apportée à l’intrigue. Par conséquent, le cinéaste consacre toute son énergie à faire un film dont on dira en fin de compte : « C’est merveilleux ! C’est tout à fait comme dans le livre ! »
Mais bien peu de ces transpositions serviles ont donné des films intéressants, et l’ampleur du succès que le public leur réserve indique combien celui-ci est ignorant des ambitions et des perspectives que doit se fixer une véritable adaptation cinématographique. Comparez un bon film tiré d’un livre au livre lui-même et vous verrez que le livre a été soumis à un processus de transformation approfondie. La raison en est simple, mais elle doit être sans cesse soulignée et répétée : les livres ne sont pas en premier lieu écrits pour être filmés. Si c’était le cas, on les lirait comme des scénarios ; et, s’ils étaient de bons scénarios, on aurait du mal à les lire comme de la littérature, parce qu’un scénario n’est rien d’autre qu’un ensemble d’indications verbales de ce qui doit être transposé en images. Quand je dis « transformé », je ne veux pas dire transformé au point où on ne reconnaîtrait plus le livre. Il y a évidemment des éléments qui restent inchangés ou qui sont du moins reconnaissables. Ce sont probablement ces éléments-là qui, dans l’histoire, ont attiré le cinéaste au départ : peut-être certains personnages, ou certaines relations qu’ils entretiennent ; peut-être seulement une situation forte ou une idée, parfois en totalité ou en partie, une idée noble ou intelligente, ou seulement provocatrice ; peut-être une ligne narrative ou un rebondissement dans le récit… J’ai réalisé une trilogie cinématographique à partir de deux romans bengalis bien connus. La première partie de cette trilogie, La Complainte du sentier, s’appuyait sur le livre qui porte le même titre. C’est un grand livre, un classique de la littérature bengalie, et riche de nombreuses qualités, tant visuelles qu’émotionnelles, qui se prêtent à une transcription cinématographique. J’ai essayé de conserver ces qualités dans le film. La deuxième partie, L’Invaincu, traite de l’adolescence du personnage principal, Apu, et s’appuie sur la fin du premier roman et le début du second qui s’intitule, comme le film, Aparajito. En tant que roman, Aparajito est loin derrière La Complainte du sentier.
C’est un livre plein de méandres et confus.
C’est un livre plein de méandres et confus, il y a trop de personnages et il s’enlise souvent dans une sorte de ronronnement naturaliste. Mais la première partie comporte au moins un aspect remarquable – la profonde vérité du rapport entre la mère devenue veuve et l’enfant qui grandit loin d’elle. Toute la raison d’être du scénario, et du film bien entendu, résidait dans ce conflit particulièrement poignant. La troisième partie de la trilogie, Le Monde d’Apu, basée sur la seconde partie d’Aparajito, soulevait davantage de problèmes. L’orphelin Apu était désormais un jeune homme et, tel qu’il est dépeint par Bibhouti Bhoushan Banerji, les schémas émotionnels auxquels il obéit manquent quelque peu de clarté. Apu, tout juste sorti de l’université, se met à rechercher un travail ; mais son inclination réelle le pousse davantage vers la création. Il est amoureux d’une jeune fille, mais forcé d’en épouser une autre. Cela ne provoque pas chez lui la crise émotionnelle à laquelle on s’attendrait, car Apu tombe amoureux de sa femme, sans que cela lui demande un effort conscient. L’auteur ne tente jamais de faire interférer ces deux relations amoureuses. La femme meurt en couches. Apu est trop abattu pour s’enquérir du bébé, qui a survécu. Il abandonne l’enfant, quitte la grande ville et décroche un travail dans une ville de province3. Il s’en lasse au bout d’un petit nombre d’années et éprouve un besoin urgent de voir son fils si longtemps négligé. C’est une brève rencontre, après laquelle Apu, de nouveau, quitte son fils, part pour les forêts de Nagpur afin de trouver la paix et un travail, revient encore une fois vers son fils, est submergé par une soudaine affection paternelle et décide de s’installer dans la grande ville avec l’enfant.
Intervient alors la dernière rencontre avec la première jeune femme, alors que celle-ci est sur le point de se suicider. Apu écrit un roman, qui lui vaut un certain succès, et, pour couronner le tout, il abandonne l’enfant, désormais âgé de huit ans, le confie aux bons soins d’amis et se lance dans une quête vaguement mystique pour trouver la paix dans une région qui n’est pas nommée. Il est vrai que, dans le cours très relâché des quatre cents pages du livre, les événements ne semblent pas juxtaposés d’une manière aussi absurde qu’il n’y paraît dans mon résumé. Mais il est clair que, dans un film d’une longueur normale, il n’y a pas la place de faire tenir ne serait-ce que le tiers de ce matériau. En réalité, je me suis principalement concentré sur deux aspects. L’un d’eux était la relation entre Apu, intellectuel qui veut se faire un nom, et celle qui est devenue sa femme par hasard, Aparna, simple et illettrée, élevée dans l’abondance mais prête à s’adapter à la pauvreté par amour pour son mari. Le second aspect était encore plus excitant. Aparna meurt en couches. Un écrivain conventionnel aurait montré le père se précipitant vers le berceau de l’enfant survivant. Bibhouti Bhoushan, qui trouve souvent la vérité sous la surface, montre Apu se retournant contre l’enfant qu’il rend responsable de la mort de sa mère. La première rencontre entre le père et l’enfant se situe après un laps de temps de plusieurs années. Un scénariste en quête de situations expressives pourrait difficilement trouver mieux.

1Shakuntala, drame de Kalidasa (IVe-Ve siècle), la première oeuvre de la littérature indienne traduite dans une langue européenne (l’anglais, en 1789) ; la fable est tirée du Mahabharata, l’un des deux grands poèmes épiques sanskrits de l’Inde ancienne (l’autre étant le Ramayana), attribué à Vyas.
2Le vaïsnavisme (vishnouisme) est une branche de l’hindouisme, fondée au Bengale au XVIe siècle par Caitanya. Cf : Madeleine Biardeau, L’Hindouisme. Anthropologie d’une civilisation, Paris, Flammarion, 1995.
3Mofussil town : ce mot, d’origine ourdoue, désignait à l’origine, c’est-à-dire au milieu du XVIIIe siècle, les territoires qui ne dépendaient pas de la Compagnie des Indes orientales, qui administrait trois zones (presidencies) autour des grandes villes de Bombay, Madras et Calcutta. Il désigne aujourd’hui les territoires situés hors des centres urbains.
Ce texte a initialement paru dans la revue Filmfare, le 28 août 1959.
Consulter la page du livre sur le site de l’éditeur.