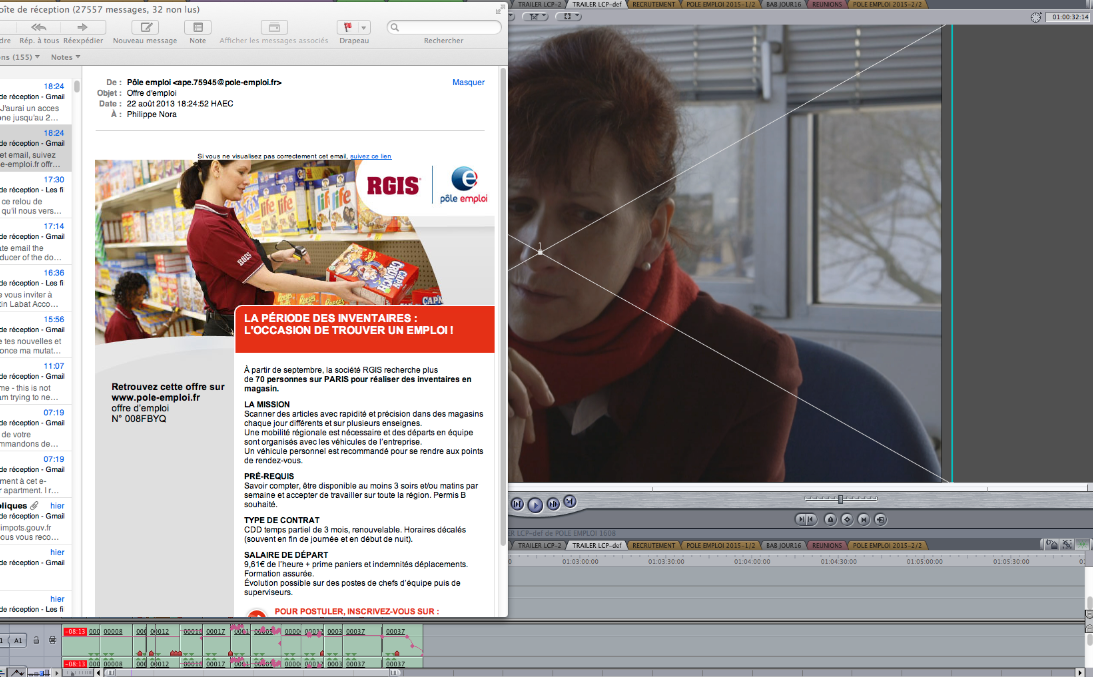« Pôle emploi, ne quittez pas », récit de tournée (5/6)
– par Nora Philippe
Voir les 3 photos
« Est-ce que c’est vrai? » : Les relations du film au réel
« Un film ne doit pas être jugé seulement sur sa valeur absolue, mais sur l’effort qu’il représente, dans les conditions données de la production, et sur les progrès qu’il lui fait réaliser. »
André Bazin, « Pour une critique cinématographique », L’écho des étudiants, 11 septembre 1943.
La campagne du livre d’or
On quitte les grandes villes. Je parcours de longues campagnes à travers la vitre. On ne fait jamais que sillonner des images, des campagnes d’images. A Belley (Ain), le président d’association et programmateur qui a invité le film, désireux de me faire découvrir la région, me conduit dans des chemins accidentés vers un étang aux couleur automnales, et lance: « A chaque fois que je passe ici, ça me rappelle la photo de l’affiche de Mitterand en 1981, tu vois, la Force tranquille. »

Nous dînons pendant la projection du film. J’écoute le récit d’une quinzaine d’années de conflits entre l’association et le cinéma L’Arlequin (thème récurrent de cette tournée : les associations programmatrices, pourtant essentielles dans la vie des petites salles, finissent par être refoulées de celles-ci). Plus tard, je suis invitée à signer un Livre d’or épais comme un bottin entre Bruno Dumont et Anne Consigny. La signature du livre d’or constitue le baptême du feu : nous en sommes, j’en suis ; et le parcourir suscite toujours toutes sortes d’anecdotes sur le comportement des cinéastes (ou acteurs) en tournée, bons points et bonnets d’âne, depuis celui qui est « généreux avec la salle » à celui qui ne pipe mot ou agresse son public, se saoule pendant le dîner voire demande des filles (aucune info ne sera donnée en MP). Au retour du dîner, dans un froid extrême, nous nous cassons le nez sur la porte : il s’avèrera que la projectionniste s’était endormie. Un petit écran insolent nous indique les minutes qui s’écoulent et nous rapprochent de la fin du film. Voilà arrivé le numéro de visa, toujours rien, on tambourine. Mon hôte, hors de lui, y voit malice personnelle de l’exploitant. Pour ma part, j’aime bien ce genre de situation woody-allennienne où on vous empêche d’entrer dans votre propre vernissage ou à la première de votre film (Pascal Tessaud a une anecdote sympathique sur le cas de Ken Loach à Cannes en 2014 interdit par un vigile d’entrer à sa propre fête : « Oh là, circulez… »). Un spectateur nous sauve finalement. Sa femme me demandera: « Est-ce que c’est vrai ce film ? Est-ce que tout est strictement vrai ? » avec un sentiment d’urgence qui laisse à penser que si je lui avais répondu: « Ecoutez, je vous l’avoue : j’ai tout tourné en studio », le soulagement aurait été immense. Je ne trouve rien de mieux que de lui rétorquer qu’elle « pose la mauvaise question ». Ce qui est…faux. C’est une bonne question.
A Tremblay-en-France
Est-ce que c’est vrai ? Voilà bien un des leitmotiv de la tournée : le public profite de la présence du réalisateu, là en chair et en os, pour lui poser la question du « vrai » ; pas le vraisemblable, le vérace, mais bien celle de la vérité. Le réalisateur apparaît comme l’interface entre le film et le réel, censément préexistant et permanent, dans lequel nous existons, et il doit en répondre. Je manœuvre ma barque entre l’écran derrière et le public devant. Je dois absolument les aider à passer.
A Tremblay, au cinéma Jacques Tati, ce samedi soir hivernal, c’est tranquille comme la Nièvre, et loin des reportages de TF1 qui la présentent comme la Géhenne. TF1, cette vérité qui sort des postes tous les jours à 20h (même mes étudiants de Sciences Po considéraient le JT comme la vérité et les documentaires comme des « représentations subjectives »). Que la soirée soit placée sous la protection du grand Tati m’égaye ; je pensais beaucoup à lui lorsque les ordinateurs, les imprimantes et les alarmes de l’agence se déclenchaient tous seuls, hors contrôle.
C’est justement en respectant un pacte documentaire que je peux faire surgir la part de folie, de pseudo-fabulation, du réel.
L’exploitant de la salle, Luigi Magri, qui dirige le cinéma depuis sept ans, me confie : « Tremblay a été régulièrement médiatisée pour sa violence et sa délinquance – je dois concevoir ma programmation en lien direct avec cette réalité-là, et je suis très soigneusement mes chiffres, les réactions du public, l’actualité. Le cinéma a un rôle à jouer dans tout ça. » Il a préparé la séance avec des fiches couvertes d’une écriture fine et précise. Ce soir, le public souligne tant l’importance que la démission des pouvoirs publics sur le territoire, puis plusieurs relèvent la citation « involontaire » du Arbeit macht frei d’Auschwitz par le sénateur lors de la cérémonie à la mairie de Livry, dans la séquence finale du film. Quasiment pas un débat sans qu’un spectateur ne relève la mention et s’en insurge, libérant du même coup la salle d’un malaise planant : « Je n’ai pas rêvé, j’avais bien entendu… » En effet : le vrai, ce fameux « vrai », dépasse la fiction. Si j’avais scénarisé cette scène, aucun spectateur ne l’aurait reçue comme vraisemblable. C’est justement en établissant et en respectant un pacte documentaire dans le film que je peux faire surgir la part de folie, de pseudo-fabulation, du réel. Ce soir à Tremblay, lorsque nous abordons cette séquence municipale, je vois au milieu de la salle deux dames en tailleur jupe chuchoter avec des sourires concernés. Elles viennent me trouver une fois le débat clos. Elles sont contentes du film, il leur a rappelé combien il est bon que la mairie de Livry ait changé de bord. « Bonjour, je suis l’adjointe au Maire. Ce qu’on voit, c’était avant : quand c’était PS. Maintenant la mairie est UMP ! »
Des profs retraités et des vigiles tchétchènes
Les mairies règnent bien souvent sur le destin des cinémas. Ceux-ci n’ont pas de statut juridique unique (entreprise privée, association, délégation de service public…), et les parcours des exploitants divergent énormément d’une structure à l’autre, mais ils doivent tous composer avec les politiques en place. D’ailleurs, je croise sur ma route plusieurs exploitants qui sont des anciens maires ou adjoints à la culture ayant repris le cinéma local à la dérive.
Mais je trouve aussi : la famille fortunée, qui a investi dans différents secteurs et se transmet le cinéma de génération en génération (Côte d’azur). L’ex-industriel du porno qui a racheté des salles (Gard). Le sportif qui s’est enrichi dans le rugby et a voulu s’offrir un multiplexe (Montargis). La branche pro : des jeunes qui ont fait leurs armes chez Gaumont, Fidélité, UGC, et ont voulu revenir à une forme d’artisanat, mais outillés d’un utile savoir en marketing et en management. Ils vantent la valeur de ce qu’ils ont appris en termes d’animation de hall d’entrée, de gestion des ressources humaines, de programmation bien sûr, mais ne manquent pas de souligner la difficulté qu’ils ont, en tant que « petits cinémas », à accéder aux films : aux prévisionnements, aux copies en première ou deuxième semaine, et se plaignent de ces distributeurs qui ne donnent pas accès aux films. Quand je pense à notre difficulté, réalisateurs et producteurs, d’accéder aux distributeurs…
Plus rare : je rencontre un gynécologue-obstétricien en Normandie, une ancienne gérante de salon de coiffure en Ile-de-France, et quelques ex-projectionnistes, qui relatent l’époque mémorable des années 1980 à Paris ou à Bordeaux, les salles associatives ou militantes qu’ils ont connues et qui passaient des films toute la nuit. L’un d’entre eux me raconte qu’il volait des Pléiade pendant l’année scolaire et vendait du cannabis l’été pour financer son ciné-club. Paolo Moretti, directeur du Concorde à La-Roche-sur-Yon, lui, faisait, étudiant, 200 km pour transporter et projeter des copies 35mm de Franco Piavoli dans le Piémont…
Mais surtout : les enseignants à la retraite occupent le haut de mes statistiques. Dans le cas des tout petits cinémas, c’est une figure omniprésente. Profs de physique-chimie, français, histoire-géo, anglais, parfois principal ou proviseur, ils animaient le ciné-club de leur établissement scolaire et n’attendaient que de partir.
Pourtant, le métier n’est pas de tout repos. A Colomiers, Salman, vigile tchétchène impeccable dans son complet, a été envoyé par la municipalité afin de veiller sur le cinéma Le Central suite à des incivilités de jeunes durant des séances de La famille bélier – « mais le sujet du film entre peu en ligne de compte », me précise-t-on. Salman ne serre pas la main aux femmes et s’immisce dans une conversation sur Timbuktu pour dire qu’à son avis ce film est faux et injuste. Une fois la foule rentrée voir Pôle emploi ne quittez pas, je le vois s’abandonner à la lecture des brochures de la puissance invitante, la Ligue des droits de l’homme.
Les rendez-vous ratés avec Pôle emploi
Parmi ces exploitants, beaucoup me racontent avoir tenté d’impliquer l’agence locale dans la projection, en collant des affiches sur le site et en conviant le directeur de l’agence à venir participer au débat : peine perdue. En Midi-Pyrénées et dans le Loiret, les directeurs d’agence répondent qu’ils ont reçu « des instructions » et qu’ils ne peuvent cautionner un film « mensonger ». A la question de savoir s’ils l’ont vu, ils répondent sans ciller : « Non ». Heureusement, les employés de Pôle emploi ne s’arrêtèrent pas là : il n’y eut pas une projection-débat au cours de la tournée sans la présence d’au moins un agent ou un ex-employé. Je les reconnais tout de suite aux sourires ou aux soupirs qu’ils expriment à des moments bien précis du film. Pendant le débat, leurs réactions sont très attendues par le public, car le réflexe commun est encore et toujours de confronter un documentaire à des témoignages de première main afin de mesurer la vérité du film. Evidemment, la très grande majorité des témoignages dans les salles concorde. Lors de séances à l’Espace St-Michel à Paris, au Méliès au Montreuil et au Ciné104 à Pantin, notamment, ce sont plutôt des managers qui prennent la parole — jusqu’à des cadres s’occupant de communication ou de « la qualité service client » à la Direction générale —, avec ce mélange de lucidité aiguë et de résignation qui ne cessera jamais de m’étonner. Ils abondent dans le sens du film, vont aussi beaucoup plus loin (ils auraient voulu que je remonte la courroie, que j’aille me promener à la direction nationale), apportent des illustrations et des explications extrêmement fines, des récits plus surréalistes encore. Le public est saisi : la fiction qui semble à l’œuvre dans le film serait la vérité vraie. Dans certaines salles plus généreuses que d’autres, des spectateurs à la fois curieux et solidaires posent la question : « Mais pourquoi diable restez-vous? » La réponse est systématique : « Parce que nous voulons continuer à œuvrer pour le service public de l’emploi…»

Syndicats
Et puis, parmi les défenseurs radicaux de la « vérité du film », qui l’utilisent comme document coup de poing, il y a les syndicats. L’une des projections-débats au cinéma Lux, à Caen, est organisée par des délégués syndicaux CGT de la région (d’autres débats, notamment au Havre et à Toulouse, seront accompagnés par des syndicalistes). L’exploitant me rappelle que nous nous trouvons dans un cinéma qui fut à l’origine construit par l’Eglise. L’abbé Villain y officiait comme projectionniste et maniait un petit clapet protecteur de vertu lorsqu’il s’agissait d’obstruer aux yeux des ouailles des images pas catholiques. Les représentants syndicalistes bouillent de rage de voir le film lui aussi occulté par l’abbé Pôle emploi et le plébiscitent d’autant plus qu’ils ont appris que certains agents ayant participé au tournage ont fait l’objet de représailles (question jamais vraiment élucidée, certains les ont niées, d’autres m’ont parlé de « pressions »). La réception du film par la direction devient pour eux l’emblème de l’omerta et du malaise qui règne à Pôle emploi. Un délégué syndical de Nantes m’énumère tous les suicides ou tentatives de suicide sur le lieu de travail qui sont étouffés. Il a l’air de penser que le film est presque une bluette. Le rapport à la « vérité » s’inverse….Le film est vrai, mais pas assez. Il pourrait l’être plus. Un délégué de l’entreprise qui sous-traite les plateformes téléphoniques de Pôle emploi décrit des conditions de travail infernales – Métropolis, vous voyez ?
Ces projections syndicales prennent le visage d’un théâtre au 18e siècle : on entre, on sort, on mange. Les employés fument des cigarettes dehors dans le froid : « J’ai l’impression de faire des heures sup’, c’est dur de voir notre souffrance sur grand écran, j’ai fait une pause là. » Dehors, dedans, dehors, dedans. Hors de l’écran, hors du réel qui y est projeté, réfugié sur le seuil du cinéma. On voudrait pouvoir changer les choses. Et moi, je voudrais pouvoir agir sur les machines informatiques qui projettent les films. A chaque séance, la même rengaine : les projectionnistes me disent que si l’on veut modifier quoi que ce soit à l’image, la colorimétrie par exemple, « il faudrait appeler le prestataire. Ce sont les réglages standard ». Et pouvez-vous me dire ce qu’est un film standard ?
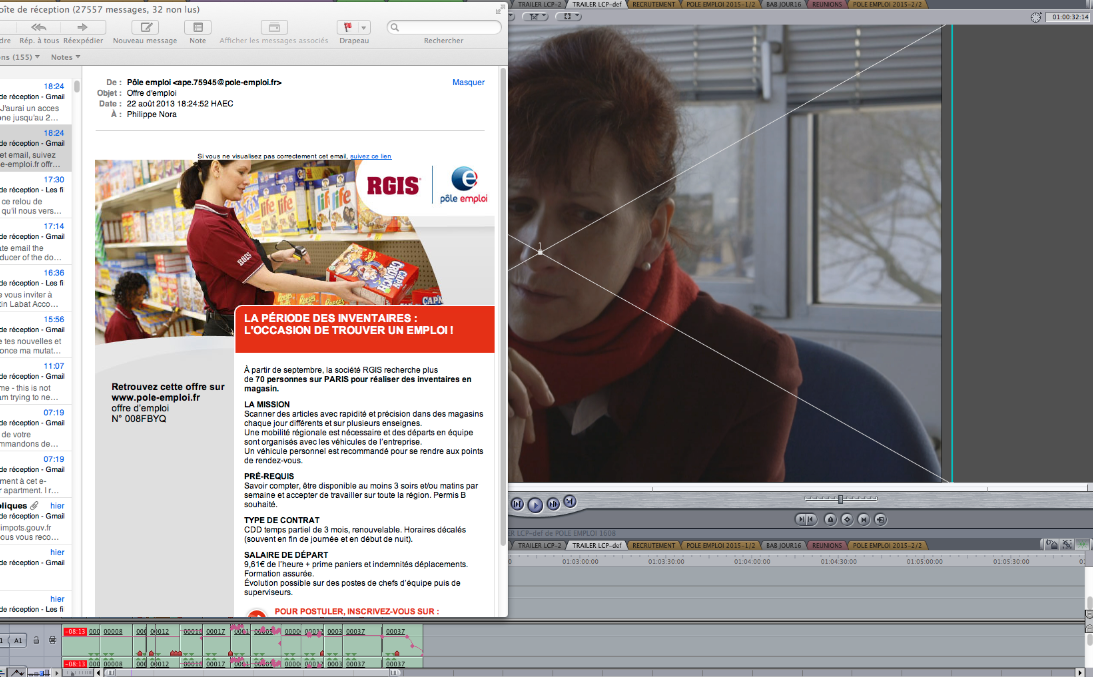
Un mail ‘standard’ de Pôle emploi, m’invitant à saisir l’occasion des inventaires en supermarché, reçu pendant le montage de « Pôle emploi ne quittez pas ».
Voile de Maya
Alors que la tournée arrive à sa fin, des courriers et des mails et des messages sur Facebook s’accumulent, perçant sans arrêt la surface de l’écran du film. « Pouvez-vous raconter mon histoire, je suis en procès avec mon employeur Pôle emploi depuis un an… » La partie cachée de l’iceberg fait surface : des récits de harcèlement, de dépression, de démarches prud’hommales, des appels à l’aide…On me demande presque de faire un second film. Je dois guérir Pôle emploi, en tout cas ses malades.
Les spectateurs me demandent souvent : « Que sont-ils devenus ? » Je donne des nouvelles des uns et des autres, d’Alberte, de Thierry, de Gabrielle. Via Facebook, le jeune homme qui devait partir pour Miami (lire l’épisode 4) m’a refait signe. Il passe maintenant un certificat d’animateur à Villepinte. A la suite de la diffusion d’extraits du film au JT de France 2, des chefs d’entreprise de Boulogne se manifestent auprès de la chaîne pour demander le contact de la famille de malentendants et leur proposer du travail. Ils veulent les aider en vrai parce qu’ils sont devenus des personnages de cinéma.
La situation « Pôle emploi ne quittez pas » a créé un matériau pléthorique qui débordait tellement qu’il fallait continuer à chercher d’autres formes. Le livre des courriers de chômeurs adressés à Pôle emploi, qui est paru aux Editions Textuel en mai 2015 (Cher Pôle emploi), en est une. Nous avons aussi légué une centaine d’heures de rushes aux sociologues du Centre d’études de l’emploi. Je crois que le film a contribué à identifier le « réel » comme une zone de fiction (parfois délirante) dans lequel, pourtant, on peut encore et toujours agir. Je finis d’écrire cet épisode sur le campus de la Columbia University à New York, où la moitié des gens en Film Studies semblent travailler sur Rancière. Finissons donc sur ce qu’en dit Nico Baumbach: « Facts or documents, as Jean-Marie Straub has reportedly declared, are the tools of the police. Politics, as Rancière has argued, is that which interrups the police. The documentary might be understood as a type of fictional film that is centrally engaged in the gap between police and politics. »[1] Et cette faille s’ouvre grand dans la salle ! Lieu d’action plus que lieu d’hypnose.
[1] In « Jacques Rancière and the fictional capacity of documentary », New review of Film and Television Studies, 8:1, 57-72, 2010.